Anabases 6 (2007) varia .......................................................
Anabases 6 (2007) varia ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bertrand Prévost Rome-Babylone. Ruine, corruption, colosse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Avertissement Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de l'éditeur. Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue, l'auteur et la référence du document. T oute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l'édition électronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV). ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Référence électronique Bertrand Prévost, « Rome-Babylone. Ruine, corruption, colosse », Anabases [En ligne], 6 | 2007, mis en ligne le 01 janvier 2012, consulté le 11 octobre 2012. URL : http://anabases.revues.org/3436 Éditeur : PLH-ERASME (EA 4153) http://anabases.revues.org http://www.revues.org Document accessible en ligne sur : http://anabases.revues.org/3436 Ce document est le fac-similé de l'édition papier. © Anabases L’ART A-T-IL QUELQUE CHOSE À VOIR avec l’idée de corruption ? Les œuvres d’art ont- elles à nous apprendre, du moins à nous faire sentir, quant à la corruption ? A priori, pas grand-chose. Et pour une raison bien précise, dont les conséquences sont très importantes pour toute idée à se faire de l’art. C’est que la corruption trouve sa place dans un régime foncièrement naturel ou naturaliste : maladie, pathologie d’un corps vivant non pas causée par un facteur exogène mais en tant que c’est le corps lui-même qui se corrompt. Cela suppose l’action de dynamismes internes, le jeu de puissances, de rapports de force. Or ce régime naturel semble précisément contrevenir au régime passant pour le plus culturel qui soit : le monde de l’art. Plus exactement, c’est à la prétendue autonomie de la fonction symbolique, à son caractère isolé que s’opposerait le régime naturel continuiste. Pour autant, le discours critique en art – comme discours (donc langage) – s’est souvent plu à mélanger les genres. Certes, le thème ou topos de la « corruption de l’art » n’est pas aussi fréquent que dans le domaine politique, mais le modèle organiciste de l’œuvre d’art (« l’œuvre d’art est comme un corps », qui remonte au moins à Aristote) aussi bien que le modèle organique de l’histoire de l’art (enfance, maturité, vieillesse – un schème historique prégnant dans la critique d’art, au moins depuis Vasari à la Renaissance), donc ces deux modèles ont pu parfois permettre une métaphorique de la corruption. Il est intéressant de ce point de vue que le livre XXV de l’Histoire Naturelle de Pline – celui consacré à la peinture – s’ouvre sur le déclin (osera-t-on dire la corrup- tion ?) de l’art contemporain (Pline l’Ancien écrit dans les décennies centrales du Ier * J’adresse mes plus vifs remerciements à Michel Weemans sans l’aide duquel cette contri- bution n’aurait jamais vu le jour. Anabases 6 (2007), p. 17-31. Rome-Babylone. Ruine, corruption, colosse * BERTRAND PRÉVOST siècle ap. J.-C.). Pline regrette l’ancien temps des portraits (imagines) supplanté par le luxe débridé, voire débauché de la marqueterie de marbre : « La peinture, art illustre jadis […] aujourd’hui totalement supplanté par les marbres et en fin de compte égale- ment par l’or, au point que non seulement les parois entières en soient couvertes, mais qu’on utilise le marbre découpé et ciselé ou des plaques incrustées dont le dessin contourné représente objets et animaux 1. » Plus proche de nous, on pensera encore à l’idéologie nazie de l’art dégénéré, qui transposait explicitement l’art sur le terrain de la pathologie : les Demoiselles d’Avignon sont des débiles attardées. Pour ne rien dire, enfin, de ce topos d’un certain discours critique qui depuis presque trente ans consiste à dire : « l’art contemporain, c’est de la merde ! », avec Fountain de Marcel Duchamp ou la Merda d’artista de Piero Manzoni en contre-page. Il est important que ces exemples soient pris dans la critique artistique, autrement dit dans l’élément du langage : c’est dans la bouche de celui qui parle qu’il y a corrup- tion. Cela signifie que l’opposition entre les deux régimes est toujours conservée, et seulement réunie dans l’élément du langage sous forme de métaphore : un simple déplacement. La question – théorique – que je voudrais maintenant poser serait donc celle-ci : la corruption en art doit-elle toujours s’entendre comme une métaphore, un simple déplacement ou bien comme une effectivité, autrement dit, comme une méta- morphose ? Argument Il faut peut-être chercher la corruption ailleurs que dans l’organique, la dénicher dans le règne apparemment le plus opposé : le minéral, la pierre. Dans l’histoire de l’art, la corruption minérale s’est cristallisée en une figure plastique : il s’agit de la ruine. C’est parce que dans la ruine le monument se délite, se décompose, se désagrège, qu’elle aura pu donner sa figure plastique à la corruption. Il faut tout de suite replacer cela dans l’agencement XVe-XVIe siècles – Rome – Réforme. Dès la fin du XVe siècle, l’anathème lancé contre la corruption de la Rome pontificale par les milieux bientôt réformés ou sensibles aux idées de la Réforme aura pu trouver un riche matériau figural dans le vaste champ de ruines que présentait la Ville. Hypothèse difficile : il ne s’agit pas de dire simplement que la ruine est la conséquence de la corruption, comme si l’une succédait à l’autre. Certes, la Bible fournit plusieurs exemples où la ruine est la conséquence d’un châtiment divin, telle la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans tous ces cas, on ne peut associer véritablement la ruine à la corruption, parce que l’altération (radicale puisqu’il s’agit de la destruction de toute la ville) dépend d’un facteur exogène ou exté- rieur, et non de l’action d’un processus interne. La ruine ne peut donner à la corrup- 18 BERTRAND PRÉVOST 1 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXXV, 1, 1, trad. J.M. Croisille, Paris, Les Belles Lettres, 1997, p. 3-5. Les incrustations de marbre coloré sont en réalité bien plus anciennes. tion sa plasticité minérale que si ruine et corruption sont en quelque sorte « co- présentes », autrement dit si la ruine est une manifestation ou une expression de la corruption. En d’autres termes, je voudrais montrer que, pour une certaine sensibilité chrétienne, la corruption morale de l’Église de Rome, était visible dans la plastique de ruine minérale de son siège. Qui plus est, les ruines romaines n’étaient pas n’importe quelles ruines, mais bien celles d’un Empire païen qui portait la corruption dans son cœur, par son idolâtrie, ses mœurs, ses coutumes, son esthétique. Qu’on se le dise : cette conception de la ruine n’est en rien moderne et humaniste. Elle est même essentiellement réactive. Pourquoi ? Parce que c’est justement à l’huma- nisme renaissant que l’on doit le tournant décisif qui aura conféré à la ruine une valeur esthétique, et aura permis aux artistes d’en faire un motif artistique. Or, cette invention de la ruine allait de pair avec l’émergence d’une nouvelle conscience historique 2. La ruine – celle de la Rome antique – n’est pas le fait d’un châtiment divin mais des aléas du temps historique, qui fait et défait les cités. Poggio Braccioloni, par exemple, inti- tule sa description archéologique des ruines de Rome De varietate fortunae (Les aléas de la fortune) (1448) : « […] devant l’ancienne grandeur des monuments effondrés et l’im- mensité des ruines de la cité antique, devant l’ampleur de la chute d’un tel empire, nous admirions du fond de l’âme la stupéfiante et affligeante inconstance de la fortune. […] Voilà qui est d’autant plus étonnant à décrire et pénible à contempler que la cruauté du sort a bouleversé la forme et la beauté de la Ville au point que, privée de tout ornement, elle gît à terre comme un immense cadavre décomposé et rongé de partout (iaceat instar gigantei cadaveris corrupti) 3. » Cette corruption est désormais conçue comme un processus immanent – une sorte de « temps de la pierre » évoluant au rythme du « temps de la cité » – et non comme une plaie envoyée par Dieu. Si l’on voit bien le rapport de la ruine à la corruption, on remarque également que se dégage une tension dialectique entre deux types de corruptions pour expliquer la ruine : l’une naturelle, physique et interne ; l’autre surnaturelle, divine et morale. Or je crois que les deux sont profondément liées, et que l’invention des ruines à la Renaissance et le nouveau goût pour la culture archéologique ont pu avoir un effet – pervers et rétroactif – sur la conception chrétienne de la ruine. La « renaissance » de l’antiquité païenne par la promotion de ses ruines pouvait, de manière très perverse, alimenter de surcroît la croyance en une destruction prochaine (c’est une question de puissance) : « Vous, les corrompus, vous serez ruinés ; voyez uploads/s3/ anabases-3436-6-rome-babylone-ruine-corruption-colosse-16.pdf
Documents similaires


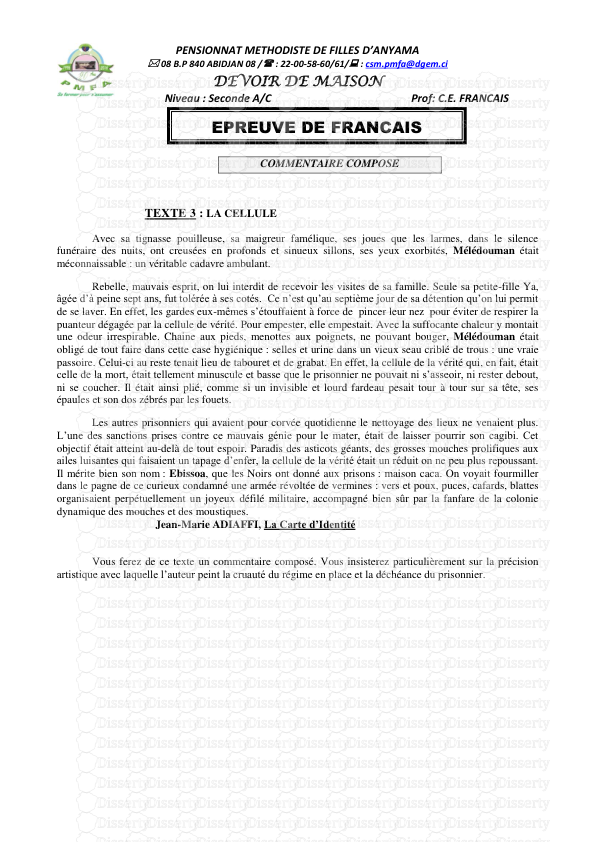







-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2023
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 4.1887MB


