1 L’art du jardin, du début du XXe siècle à nos jours Hervé Brunon & Monique M
1 L’art du jardin, du début du XXe siècle à nos jours Hervé Brunon & Monique Mosser Extraits du dossier à paraître au Centre national de documentation pédagogique Novembre 2010 2 1 – Sommaire détaillé du dossier à paraître Avant-propos Introduction : Des œuvres entre nature et culture Un art paradoxal Statut complexe, voire ambigu, du jardin dans la culture occidentale. Le jardin comme processus Conception, réalisation et entretien d’un jardin. Espace, formes et sens Approcher le jardin du point de vue plastique (composition, couvert et découvert, circulations, ambiances, palette végétale, iconographie, etc.). Des formes retrouvées puis réinventées (1900-1940) Avatars du symbolisme Diversité des esthétiques dans la première décennie du XXe siècle (symbolisme : Villandry ; Art Nouveau : Parc Güell ; Arts and Crafts : Bois des Moutiers ; Orientalisme : Maulévrier, etc.). Historicisme et nationalismes Réinventions des « styles » nationaux, à dimension idéologique : « à la française » (Achille Duchêne), « à l’italienne » (Cecil Pinsent), etc. 3 Expérimentations modernistes L’exposition « Arts Déco » de 1925 (Guévrékian, Mallet-Stevens) ; les frères André et Paul Vera ; Jacques Greber (Italie, Portugal) ; le « modern garden » en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L’émergence internationale du paysagisme (1940- 1970) La structuration d’une profession La reconnaissance du métier de paysagiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (création de l’International Federation of Landscape Architecture) ; la formation professionnelle ; les conditions et la pratique de la maîtrise d’œuvre (concours, programmes, projets, fonctionnement en agence, etc.). Figures de maîtres d’oeuvre Aperçus sur quelques grandes figures internationales du XXe siècles : Fletcher Steele , Garrett Eckbo et la Harvard Graduate School of Design (États-Unis) ; Carl Theodor Sørensen (Danemark) et le paysagisme scandinave ; Geoffrey Jellicoe (Grande-Bretagne) ; Russell Page (Grande-Bretagne, France, Italie) ; René Pechère (Belgique) ; Pietro Porcinai (Italie) ; Mirei Shigemori (Japon) ; Isamu Noguchi (Japon, Etats-Unis, France) ; Roberto Burle Marx (Brésil) ; Luis Barragán (Mexique) ; etc. Enjeux de l’espace public (1970-2010) La réinvention du parc urbain L’importance des grands concours parisiens : La Villette (1982), parc André-Citroën (1985), etc. ; le développement des parcs urbains et périurbains en France et en Europe. 4 Diversification typologique : les espaces publics plantés Émergence de nouveaux types de « jardins », s’insérant dans le tissu de la ville et sa périphérie : promenades, « coulées vertes », « jardins de poche » ; développement de politiques urbaines globales (Barcelone, Londres, New York, etc.). La stratégie urbaine de l’agglomération lyonnaise (étude de cas) Parc de Gerland (Atelier Corajoud), parc des Hauteurs, jardins de proximité, etc. Approches artistiques, expressions personnelles (1970- 2010) Minimalisme, art conceptuel, postmodernisme Les renouvellements du langage du jardin induits par des démarches très diverses (Jacques Simon, Bernard Lassus, Martha Schwarz, Maya Lin, Yves Brunier, Jenny Holzer, James Turrell, Charles Jencks, Wolfgang Laib, etc.) ; les festivals de jardin éphémères (Chaumont- sur-Loire, Lausanne-Jardins, etc.) confrontés à la logique de l’installation temporaire (Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger). Les « néo-arcadiens » Un courant poétique nourri par les références à l’histoire et la tradition des jardins : Ian Hamilton Finlay, Gianni Burattoni. Créations intimes et autobiographiques Le jardin comme « atelier à ciel ouvert » et « récit de vie » : Derek Jarman, Érik Borja, Max Sauze, Niki de Saint-Phalle, démarches relevant de l’Art brut, etc. Land Art et musées de sculpture Le paradigme du jardin étendu à l’échelle du paysage ; les parcs de sculptures (Kröller- Müller, etc.) ; les collections d’ « art environnemental » (Vassivière, Barbirey, etc.). 5 La collection Gori à la Fattoria di Celle en Toscane (étude de cas) Une collection privée d’art environnemental crée à partir de 1982 sur le site d’un jardin historique. Expériences sociales et écologiques (1970-2100) Le regain des jardins collectifs Des jardins ouvriers et familiaux aux Green Guerillas, jardins de squat, jardins partagés et jardins d’insertion. Le nouveau « naturalisme » L’esthétique induite par la sensibilité écologique (marais, prairie fleurie, graminées etc.) et le travail sur la palette horticole (collections végétales spécialisées, nouveaux jardins botaniques). Conscience environnementale et défis planétaires Développement des jardins et parcs conçus et gérés selon des modes écologiques (Emscher Park, jardins du Marais à Herbignac, etc.) ; de nouvelles pratiques en réponse au changement climatique (jardins « secs », diversification végétale chez Pascal Cribier, etc.). La figure de Gilles Clément (étude de cas) Théories et pratiques du « jardin en mouvement » (La Vallée), du « jardin planétaire » (domaine du Le Rayol, musée du Quai Branly), du « tiers paysage » (parc Matisse à Lille). Jalons pour une exploitation pédagogique Glossaire Bibliographie Présentation du DVD 6 2 – Introduction du dossier (repères théoriques) Des œuvres entre nature et culture Parler du jardin en tant qu’art ne va pas forcément de soi, car cette forme d’« œuvre », si ancienne soit-elle – ses premières traces documentaires remontent à la Mésopotamie sumérienne et à l’Égypte pharaonique … –, ne semble pas avoir donné lieu, dans la culture occidentale, à une reconnaissance esthétique aussi enracinée que pour d’autres domaines, d’autant qu’elle possède de nombreuses spécificités qui la singularisent nettement. Néanmoins, le processus indéfini de conception et de réalisation du jardin repose sur des principes et produit des effets qui peuvent légitimement être analysés en termes de création artistique. Un art paradoxal Le lexique actuel reflète cette situation relativement marginale des jardins. Ce que l’on désigne aujourd’hui en français comme « art du jardin » ou « art des jardins » – et naguère encore comme « architecture des jardins » – ne correspond pas dans de nombreuses autres langues à un terme unique mais plutôt à des groupes de mots, tels garden design en anglais, arte dei gardini en italien, etc., ou à des mots forgés par agglutination, dans le cas par exemple de Tuinkunst en néerlandais ou Gartenkunst en allemand – cette dernière langue offrant néanmoins le néologisme Gartenkultur, qui implique que le jardin se rapporte à une sphère culturelle et pas seulement artistique. Quant à « paysagisme », substantif d’emploi encore récent en dehors de l’activité littéraire, il désigne un domaine plus large que le seul jardin, celui des projets de paysage, dont l’échelle peut s’avérer beaucoup plus vaste. De même, alors que l’on parle banalement de quelque chose de « musical » ou de « cinématographique », nous n’avons pas non plus d’adjectif pour qualifier ce qui se relèverait directement ou métaphoriquement du jardin en tant qu’art : « horticole » renvoie à la culture des jardins au sens technique, voire plus spécifiquement encore à la production des végétaux alimentaires et ornementaux. Depuis une dizaine d’années, certains spécialistes ont d’ailleurs 7 proposé de combler ce vide en forgeant le terme « hortésien »1, calqué sur le nom de la fée Hortésie, personnage inventé vers 1660 par La Fontaine dans le Songe de Vaux. En accordant à cette « muse » moderne des jardins – afin notamment de célébrer le travail de Le Nôtre – la même dignité que ses trois compagnes allégoriques régnant respectivement sur la peinture (Apellanire), l’architecture (Palatiane) et la poésie (Calliopée), le fabuliste conférait explicitement un statut « artistique » à une activité placée jusqu’alors plus volontiers du côté des savoir-faire, de l’humble geste du jardinier. Cette activité donna cependant lieu, à partir du XVIe siècle, à un vaste effort de codification à travers une multitude de traités, tels La Théorie et la Pratique du jardinage de Dezallier d’Argenville (1709), pour devenir même l’objet, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de débats passionnés sur le nouveau goût pittoresque et sur les relations entretenues par le jardin, auparavant inféodé essentiellement à l’architecture, avec la peinture et la poésie, considérées en tant que pratiques artistiques « sœurs » (Horace Walpole). Toutefois, aux zélateurs du jardin s’opposent de puissants pourfendeurs à l’instar de Hegel, qui, au sein du système des arts exposé dans ses cours d’esthétique, le rejette avec la danse parmi les « genres mixtes », assimilables à ce que la biologie distingue comme « les espèces mixtes, les amphibies, les êtres de transition », pouvant « offrir encore beaucoup d’agrément et de mérite, mais rien de véritablement parfait2 » : ces arts intermédiaires seraient irrémédiablement prisonniers de la matière même de la nature, incapables d’accéder au rang de langage autonome. Une telle critique met en exergue l’un des traits paradoxaux du jardin, œuvre combinée de nature et de culture, création profondément humaine et pourtant tissée dans la matière même du monde, façonnée à l’aide du vivant, indissociable des substances « élémentales » que sont la terre, l’eau, les végétaux, la lumière. Ce caractère hybride s’apparente à la greffe et fut désigné à la Renaissance par un couple d’oxymores croisés : « nature artificielle », « artifice naturel »3. D’autres aspects contribuent à la spécificité du jardin. Il s’agit d’une œuvre « ouverte », au sens d’Umberto Eco4, indéfiniment en devenir et perpétuellement inachevée – comme le cycle même de la vie –, puisqu’il est planté pour croître lentement au rythme des 1 Voir notamment l’entrée « Jardins » de uploads/s3/ art-du-jardin-repres-novembre-2010-2.pdf
Documents similaires








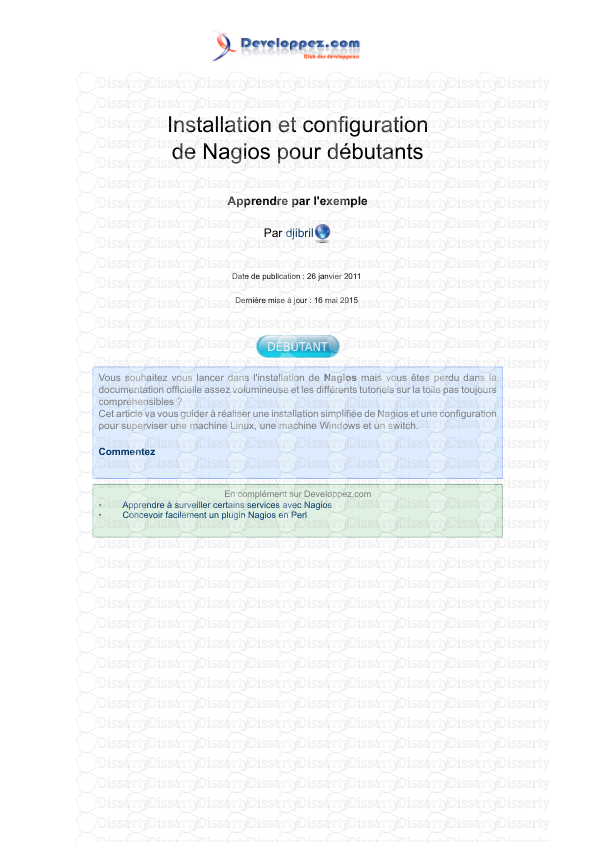

-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 25, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.9443MB


