C elui qui s’adresse ici à des musi- ciens ne l’est lui-même en aucune manière.
C elui qui s’adresse ici à des musi- ciens ne l’est lui-même en aucune manière. C’est donc de la créativité en général que nous parlerons, mais en tentant d’isoler et de décrire celle qui est à l’œuvre dans toute pratique artistique. La créativité est à la mode. Dans nos sociétés impatientes, elle fait l’objet d’une injonction inlassablement recon- duite, tout particulièrement et paradoxa- lement dans les domaines d’activités où, comme celui du travail et de l’entreprise, les contraintes sont maximales. Mais, à l’autre extrême, la capacité à créer, qu’on peut nommer également « créativité », semble être au centre de l’activité artistique. Peut-on distinguer les sens multiples et peut-être divergents dont ce terme est chargé ? Une tentative de clarification de ce qu’est la créativité devient urgente, dès lors que l’enseignement reçoit, dans dif- férents secteurs de nos institutions, la mission de la développer. En outre, le rapprochement de ces deux termes, enseignement et créativité, fait naître de nouvelles interrogations. Car, prise dans son acception la plus large et la plus immédiate, la créativité semble impli- quer la liberté et la possibilité de s’affir- mer personnellement, alors que l’enseignement est souvent perçu, à tort ou à raison, comme un monde de pres- criptions, de règles et d’obéissance. Ce que nous tenterons ici, dans un pre- mier temps, c’est justement d’examiner les tensions qui semblent apparaître entre enseignement et créativité. Ce pre- mier travail nous permettra, sinon de sai- sir tous les sens possibles du terme « créativité », du moins de distinguer quelques-unes de ses figures. Dans un deuxième temps, nous ver- rons à quelles conditions on peut envisa- ger une conciliation entre les impératifs d’une démarche enseignante et l’accès à la créativité. Il s’agira de voir s’il peut exister une règle séminale des actes créa- tifs, condition nécessaire pour qu’on puisse les enseigner. Enfin, dans un troisième moment, nous voudrions examiner le rôle que l’acte d’enseignement peut occuper par rapport à une pratique artistique, en tentant de prendre à la lettre le mot « création ». Créativité et enseignement : une relation en tension Précisément parce qu’elle est l’objet d’un usage inflationniste et omniprésent, la notion de créativité est foisonnante ; chacun peut y mettre ce qu’il veut. Elle est porteuse d’idées et d’implications diverses, parfois opposées. À l’occasion de la confrontation entre créativité et enseignement, nous tenterons de distin- guer quelques-unes d’entre elles, car selon le sens qu’on donne à la notion, la question de son caractère enseignable se pose différemment. Sans prétention à l’authenticité, trois implications de la notion de créativité nous paraissent devoir être examinées : le lien entre créativité et don personnel, le lien entre créativité et spontanéité et le lien entre créativité et nouveauté. La conception charismatique de la créativité Par son suffixe commun à bien d’autres mots (disponibilité, générosité, émoti- vité, combativité, etc.), le terme « créati- vité » désigne non pas un évènement ou une chose, mais une potentialité ou une faculté d’un sujet. Au sens premier, elle n’est donc pas l’acte de création, mais plutôt ce qui, au sein du sujet, le rend possible. Lorsqu’on constate qu’il y a eu création (artistique ou autre), on est Bernard Rey Directeur honoraire du Service des Sciences de l’Éducation, Université Libre de Bruxelles Peut-on enseigner la créativité ? Une tentative de clarification de ce qu’est la créativité devient urgente, dès lors que l’enseignement reçoit, dans différents secteurs de nos institutions, la mission de la développer. 18 Orphée Apprenti Éclairages conduit à supposer qu’il y avait chez son auteur une faculté de créer ou une dispo- sition à le faire ; c’est cette disposition qu’on nomme « créativité ». Ainsi conçue, elle semble inhérente au sujet, ou plutôt à certains sujets. Là où une saisie plus scientifique du processus de création verra en elle l’ef- fet conjugué d’une multiplicité de fac- teurs, les uns tenant aux caractéristiques (psychologiques, sociologiques, etc.) du créateur, les autres à son environnement social, historique, technique, relationnel, etc., la notion de créativité, dans ce pre- mier sens, invite à y voir l’effet d’une faculté unique et mystérieuse qui habite- rait le sujet créateur. Non pas l’effet de causes, mais l’expression d’un charisme. La créativité est alors ce que possède- raient en propre certains individus et non d’autres. Elle serait un don, c’est-à-dire au sens propre quelque chose qu’on a reçu sans rien avoir à donner en échange, sans effort, sans apprentissage, sans être entré soi-même dans un processus de construction. Le don est souvent pensé comme inné. Il reproduit sous une forme adulte le mythe des bonnes fées qui entourent le berceau dans les contes enfantins et proclament le talent et le destin. Sous une forme moins fictionnelle, la créativité peut être pensée, non plus tout à fait comme un don inné, mais comme le résultat d’une histoire personnelle, sans toutefois chercher à en analyser les facteurs et les processus. Il s’agit donc encore d’un caractère singulier, propre à un individu ; et, même si l’on admet qu’il est acquis au cours de l’existence, il reste considéré comme non reproduc- tible et on ignore les enchaînements de situations ou d’évènements qui ont pu le faire advenir. Or, à l’inverse, il ne peut y avoir ensei- gnement que si l’acquisition d’une faculté échappe à l’aléatoire des histoires singulières, si on a porté au jour les conditions qui la permettent, si on a rendu publique la démarche qui y conduit. Dès lors que cette démarche est connue, le credo fondamental de l’ensei- gnement est qu’on peut faire acquérir cette faculté à quiconque, doué ou non doué : c’est une question de travail et de patience. Comme l’écrit Meirieu 1 (1991), l’éthique enseignante consiste à poser comme postulat que tout individu est éducable. N’importe qui peut apprendre. Dans cette première conception, l’idée de créativité semble liée à un élitisme pessimiste : certains ont le don de créati- vité, ils seront créateurs ; d’autres ne le seront jamais. Au contraire, ce qui est enseignable est accessible à tous. L’enseignement est lié aux valeurs de démocratie et d’égalité. À vrai dire, ceux qui adhèrent à cette conception de la créativité comme carac- tère singulier et mystérieux, possédé par naissance ou par la singularité d’une his- toire personnelle, n’excluent pas que les pratiques créatives puissent faire l’objet d’un « enseignement ». Car si la créati- vité est donnée, il faut la développer et l’affiner. Mais ce qui est, dans ce contexte, désigné sous le terme d’ensei- gnement est très différent du modèle scolaire. Il s’agit pour l’individu doué de travailler avec un maître renommé, et grâce à une longue fréquentation et à une sorte d’allégeance globale vis-à-vis de ce personnage, de s’approprier ses qualités particulières. L’enseignement sous sa forme aujourd’hui majoritaire, qui est la forme scolaire, ne consiste pas pour l’élève à s’approprier, par une sorte de mimé- tisme, le talent du maître, mais d’ap- prendre de lui des démarches et des procédures qui, loin de lui appartenir en propre, sont codifiées et impersonnelles. Ainsi, si la créativité est cette qualité à la fois rare, mystérieuse et impossible à codifier, ancrée au plus profond de l’in- dividu créateur au point de se confondre avec lui et de n’être rien d’autre que sa singularité, alors sans doute, elle peut bien se développer dans une relation maître-élève ou, mieux, maître-disciple. Et on peut, si on y tient, appeler « ensei- gnement » cette relation. Mais elle est radicalement différente de l’enseigne- ment au sens scolaire, dans lequel l’en- seignant transmet avec des mots et d’une manière explicite des connaissances, des procédures et des façons de faire qui ne lui appartiennent pas en propre et qui ont été stabilisées et standardisées. Mais d’autres figures de la créativité sont possibles, comme nous allons le voir. La créativité comme expression authentique de soi Cette deuxième conception pourrait être vue comme la version démocratique et bienveillante de la précédente. Comme elle, elle situe la créativité au plus pro- fond du sujet : c’est en étant soi-même que l’on est créatif. Mais à la différence de la précédente, elle consiste à dire que chacun peut être créatif, dès lors qu’il s’exprime d’une manière spontanée. L’élitisme disparaît : la créativité est l’apanage de tous, au prix de l’authenti- cité. Ce que cette conception pense sai- sir dans la singularité du sujet, ce n’est pas seulement la créativité, mais aussi la source de toute valeur. En effet, la créati- vité ainsi pensée comme liée à la sponta- néité exclut qu’il y ait des normes ou des valeurs préétablies extérieures à l’indi- vidu. La seule valeur est l’authenticité. Tout individu peut être créatif, dès lors 19 20 Orphée Apprenti Éclairages qu’il est capable d’échapper aux confor- mismes et aux contraintes. Bien sûr, cette conception est, comme la précédente, en rupture avec l’idée d’enseignement. Si la créativité passe par l’échappement aux contraintes, aux consignes, aux ordres, alors elle ne sau- rait se développer dans un univers où, comme c’est le cas dans l’enseignement, toute production d’élève doit être conforme à des normes et des règles préétablies. Malgré l’opposition uploads/s3/ peut-on-enseigner.pdf
Documents similaires

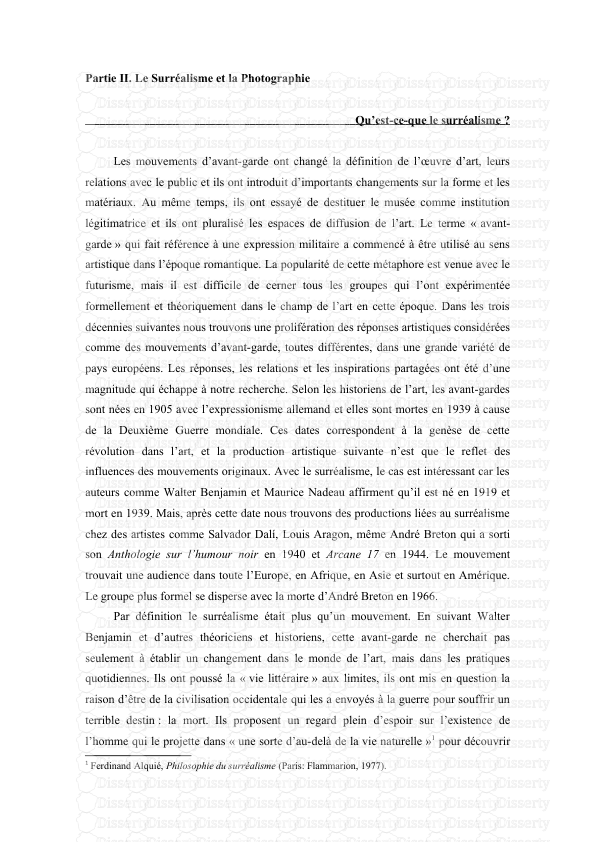

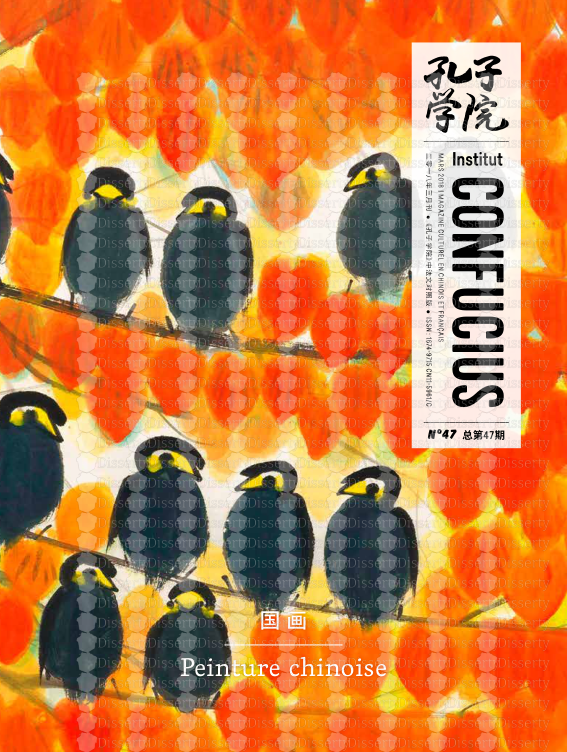






-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 31, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1148MB


