Anne Beyaert-Geslin L'image ressassée. Photo de presse et photo d'art In: Commu
Anne Beyaert-Geslin L'image ressassée. Photo de presse et photo d'art In: Communication et langages. N°147, 2006. pp. 119-135. Résumé Selon Anne Beyaert-Geslin, la photographie de presse ressasse toujours les mêmes motifs qu'elle emprunte aux genres majeurs de la peinture et au portrait. Pieta, Nativité ou modèle épique inspiré de Delacroix, ces motifs ont un usage rhétorique. Outre le fait qu'ils ont une fonction d'emphase et de mémorisation, ils contribuent à la lisibilité de l'événement et agissent tels des « convertisseurs de croyance » qui « permettent d'y croire ». Pourtant, à viser ainsi l'exemplarité, ces motifs sacrifient l'événement à une vérité typique qui écrase toutes les réalités individuelles. L'auteur soumet donc la photo de presse à la critique et analyse les propositions des artistes afin de rendre compte du passage entre les deux pratiques photographiques. Dès lors, deux questions se posent : « y a-t-il ou non une alternative aux stéréotypes de la photo de presse ? », partant « comment parvenir à représenter l'événement?». Citer ce document / Cite this document : Beyaert-Geslin Anne. L'image ressassée. Photo de presse et photo d'art. In: Communication et langages. N°147, 2006. pp. 119- 135. doi : 10.3406/colan.2006.4584 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2006_num_147_1_4584 119 L'image ressassée Photo de presse et photo d'art « Ce n'est pas le passé qui nous obsède, ce sont les images du passé. » Georg Steiner « Poreuse et dynamique », la photographie est un lieu de passage pour toutes les pratiques artistiques contempor aines1. Cette avidité témoignée au monde lui-même (« pas une seule chose du monde qui n'ait été photographiée », affirme Sontag) autant qu'aux autres genres de l'image en fait un domaine d'investigation exemplaire pour une étude des pratiques. Mon idée n'est pourtant pas d'observer toutes ces circulations mais de me concentrer sur les tran sformations qui se produisent entre deux pratiques, la photographie de presse et la photographie artistique. Le choix de celles-ci suit tout d'abord les commentaires de la critique qui, faisant état d'une « crise de l'activité journalis tique », soutient qu'une « autre information » est produite aujourd'hui avec « les moyens plastiques et théoriques de l'artiste » 2, ce que confirme, en maints endroits, l'actualité artistique3. Cette limitation à deux pratiques exemplaires manifeste également un souci heuristique et observe le précepte sémiotique selon lequel le sens apparaît dans la 1. Voir Alexandre Castant, La photographie dans l'œil des passages, Paris, L'harmattan, 2004. La constatation prolonge celle de Sontag qui, dans son ouvrage, Sur la photographie, observe que depuis son invention en 1839, il n'est « pas une seule chose (du monde) qui n'ait été photographiée ». Avec la photographie, « le monde entier peut tenir dans notre tête, sous la forme d'une anthologie d'images », dit-elle. 2. Pascal Beausse, « La photographie, un outil critique », Art press, n° 251, p. 44. Voir également Natacha Wolinski, « La vérité flouée », Beaux-arts magazine, n° 246, novembre 2004, p. 63-64. La question est également posée par André Roullé, La photographie, Entre document et art contempor ain, Paris, Gallimard, « Folio », 2005, notamment dans le chapitre intitulé Crise de la photographie-document. 3. La proposition la plus argumentée est sans doute l'exposition proposée à l'automne 2004 au musée départemental d'art contemporain de Roche- chouart et intitulée Paysages invisibles. PHOTOGRAPHIE ANNE BEYAERT-GESLIN Selon Anne Beyaert-Geslin, la photographie de presse ressasse toujours les mêmes motifs qu'elle emprunte aux genres majeurs de la peinture et au portrait. Pieta, Nati vité ou modèle épique inspiré de Delacroix, ces motifs ont un usage rhétorique. Outre le fait qu'ils ont une fonction d'emphase et de mémor isation, ils contribuent à la lisibi lité de l'événement et agissent tels des « convertisseurs de croyance » qui « permettent d'y croire ». Pourt ant, à viser ainsi l'exemplarité, ces motifs sacrifient l'événement à une vérité typique qui écrase toutes les réalités individuelles. L'auteur soumet donc la photo de presse à la critique et analyse les propositions des artistes afin de rendre compte du passage entre les deux pratiques photographiques. Dès lors, deux questions se posent : « y a-t-il ou non une alternative aux stéréotypes de la photo de presse ? », partant « comment parvenir à représenter l'événement?». communication & langages - n° 147 - Mars 2006 120 PHOTOGRAPHIE transformation. Un tel principe devrait me permettre de fixer quelques règles de codification du texte et donc, de préciser les termes de l'accord pratiques-textes. Pratiques en production, pratiques en réception Avant toute investigation, il convient de distinguer trivialement deux types de pratiques : les pratiques en production, dues au photographe, et les pratiques en réception qui traduisent la perception sociale de la photographie. Pour les premières, différents statuts sont envisageables. Par exemple, lorsqu'Henri Cartier-Bresson délaisse le monde de l'art dans les années 1930 à la suite de montée du fascisme, et se voue au photo-journalisme, il opère un déplace ment de sa pratique et offre ses photographies à un autre univers de signification. C'est sans doute la « déviation » la plus simple. L'incidence pour les textes photo graphiques est tout autre lorsque Warhol s'approprie des portraits anthropométri ques (face/profil) réalisés par la police pour en faire des tableaux4 car il opère alors une reprise énonciative qui soumet les images à une nouvelle signification. Les exemples de déviation de la pratique de réception abondent. Les polaroïds pris par Warhol pour ses albums personnels en sont un témoignage intéressant puisqu'ils s'inscriraient très résolument dans le genre de la photo d'amateur si le statut d'artiste de Warhol et la célébrité des modèles (J. Nickolson, J.-C. Brialy, J. Lennon et Y. Ono...), n'avaient modifié la perception sociale des photograp hies, les situant d'emblée dans le registre de l'art sinon dans celui de la « presse people ». En pareil cas, l'identité des sujets a infléchi la trajectoire. Si la diversité des exemples limite la description, on retient que la signification d'une image ainsi « déviée » subit l'influence d'univers de sens hétérogènes, la détermination de supports et de scènes typiques différents et apparaît nécessair ement complexe et polémique. Ainsi, et pour suivre certaines propositions de Sontag relatives à la photographie de presse, des images des camps de concentra tion prises en 1945 qui circulent entre un musée de la photographie, une galerie d'art contemporain, un catalogue d'exposition, les pages d'un quotidien, d'une revue culturelle ou d'un livre, y trouvent-elles des significations toujours nouvelles. « Toute image est vue à l'intérieur d'un cadre particulier », note-t-elle5, ce que traduirait aisément cet adage sémiotique : tout texte appartient à son corpus. Un tel principe mérite d'ailleurs commentaire dans la mesure où l'actual ité révèle, au lieu de ces cadres de réception séparés, parfaitement identifiables, une certaine confusion des pratiques dont témoignent les campagnes de Toscani pour Benetton, toujours aux confins du photo-journalisme et de la publicité. Si « les cadres se multiplient aujourd'hui » (Sontag), les pratiques se croisent aussi plus intimement et l'on s'étonne à peine qu'une photographie d'un malade du sida ou d'un soldat mort soit exposée dans une boutique de vêtements6. 4. Une illustration exemplaire est proposée par Most wanted man n° 1, 1963. 5. S. Sontag, Devant la douleur des autres, idem, p. 128. 6. Sontag revient à plusieurs reprises sur la photographie de Capa représentant un milicien espagnol frappé par une balle, publiée pour la première fois le 12 juillet 1937, en pleine page, dans le magazine Life face à une publicité pleine page pour Vitalis montrant en tennisman en plein effort. La différence entre image « de presse » et image publicitaire était alors considérable, irréductible, affirme-t-elle, indiquant ainsi un franc partage des univers de sens et l'univocité de la signification. Voir sa descrip tion dans Devant la douleur des autres, p. 41 et p. 128. communication & langages - n° 147 - Mars 2006 L'image ressassée 121 Pratiques en production, pratiques en réception, une telle typologie est bien entendu extrêmement rudimentaire et ne permet pas de décrire les mutations sémantiques aventureuses dont témoigne l'actualité. Elle esquisse toutefois certaines perspectives heuristiques. Tout d'abord, ces premiers exemples tendent à montrer qu'au-delà du simple brouillage catégoriel entre un texte et un corpus, le passage d'une pratique à l'autre produit un changement de trajectoire impliquant différents niveaux de perti nence, du texte à la situation et aux stratégies. La photographie originale de la police new-yorkaise qui, reprise par Warhol, devint Most wanted man n° 1, mesurait quelques centimètres à peine. Illustration pour une fiche de carton, sans doute se trouvait-elle rangée dans un dossier de commissariat7. La prise en charge artistique en a donc considérablement augmenté les dimensions, modifié le support (c'est désormais une toile) et la scène typique, troquant la boîte de rangement pour une cimaise de musée. De tels chan gements -format, support, et scène typique - s'accordent à une nouvelle construc tion sociale et déterminent des rapports très différents vis-à-vis du corps du sujet percevant. Ils occasionnent notamment un changement de distance de percept ion, une possibilité de collectivisation due à l'entrée de l'œuvre au musée mais aussi, et plus radicalement, un changement de uploads/s3/ article-colan-0336-1500-2006-num-147-1-4584.pdf
Documents similaires






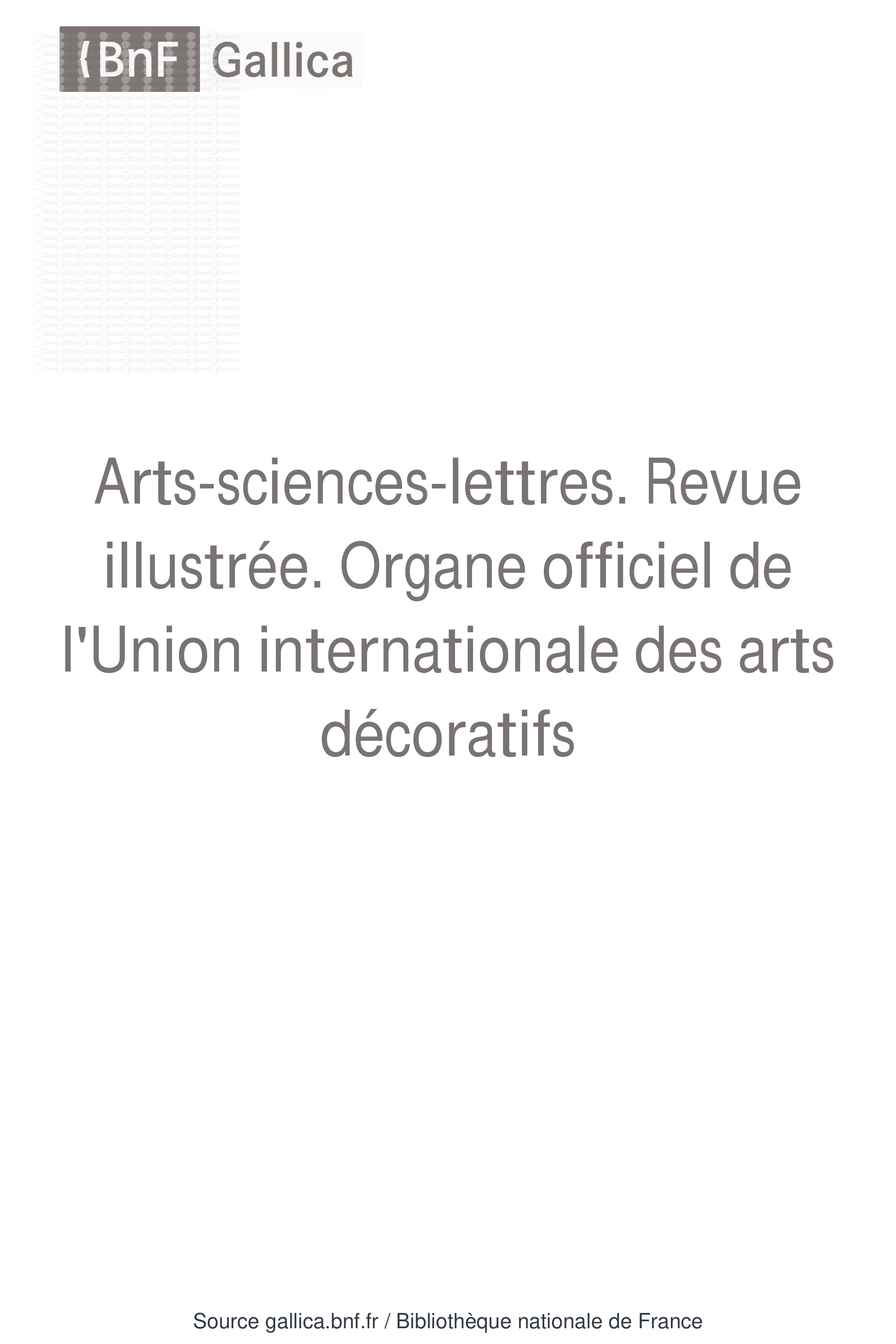


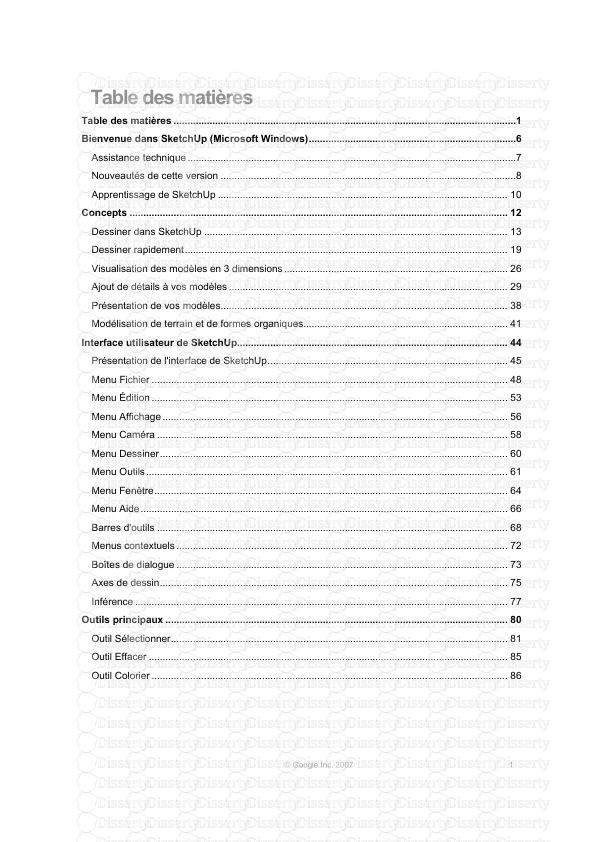
-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4515MB


