L’interaction entre les aspects « grammatical », « lexical » et « phasal » en b
L’interaction entre les aspects « grammatical », « lexical » et « phasal » en berbère Samira MOUKRIM Université de Fès, LLL, Université d’Orléans Chaque langue a sa propre sélection de notions grammaticalisées et sa manière spécifique de les organiser en un système. (Lazard, 2006 : 10) Introduction Le découpage des catégories grammaticales dans le domaine temps/aspect/ mode est variable, car il est propre à chaque langue, ce qui se reflète dans l’organisation du système verbal de chacune d’elles. Si en français, on distingue une vingtaine de formes verbales, qui sont toutes classées en fonction des deux catégories du ‘mode’ et du ‘temps’, le système verbal du berbère, lui, repose sur une opposition purement aspectuelle qui consiste en trois paradigmes de conjugaison : l’aoriste, l’accompli et l’inaccompli. Pour exprimer des valeurs temporelles en berbère, plusieurs paramètres interagissent les uns avec les autres. Dans ce papier, nous examinerons l’interaction entre trois types d’aspects : l’aspect grammatical, l’aspect lexical et l’aspect phasal. Après une présentation de l’aspect « grammatical » en berbère, aspect autour duquel s’organise tout le système verbal dans cette langue (section 1), nous passerons à la manière dont le temps est exprimé, le temps « présent » comme exemple (section 2). Nous verrons ensuite comment les aspects lexical, grammatical et phasal interagissent les uns avec les autres (section 3). Revue de Sémantique et Pragmatique. 2014. Numéro 35-36. pp. 195-209. Samira Moukrim 196 RSP • 2014 • n° 35-36 1. L’aspect « grammatical » en berbère Basset, A. (1952) a été le premier à identifier la nature aspectuelle et non temporelle des oppositions fondamentales du système verbal berbère. Cette conception aspectuelle est désormais admise par la totalité des berbérisants (Penchoen (1973), Galand (1977), Bentolila (1981), Cadi (1981), Chaker (1983), Leguil (1987), Ouhalla (1988), entre autres)1. Il est également admis, à la suite de Basset (1929, 1952), que le système verbal berbère repose sur une opposition ternaire opposant trois thèmes verbaux : aoriste, accompli (prétérit), inaccompli (aoriste intensif)2. Ces thèmes reçoivent plusieurs appellations selon les auteurs : Cadi (1987) Basset (1929) Galand (1977) Hebaz (1979) Prasse (1972-74) Sudlow (2001) Thème I Aoriste Aoriste Aoriste Imparfait Imperfective Thème II Aoriste intensif Inaccompli Extensif Imparfait intensif Cursive Thème III Prétérit Accompli Prétérit Parfait Perfectif Nous adopterons ici la terminologie de Galand (1977) aoriste, accompli et inaccompli, et présenterons ci-dessous les trois paradigmes de conjugaison en berbère, en prenant à titre d’illustration le verbe amz « tenir » : 1 Seul Abdel-Massih, E.T. (1968) a étudié le système verbal (tamazight des Ayt-Ndir) d’un point de vue exclusivement temporel renvoyant à la division du temps dans les systèmes temporels. 2 Il existe deux autres thèmes, l’accompli négatif et l’inaccompli négatif qui n’ont pas d’existence fonctionnelle en synchronie (Chaker, 1997 : 2) et qui n’apparaissent que dans un contexte négatif. Pour Bentolila (1981 : 116), Galland (1977 : 288) et Penchoen (1973 : 42), l’accompli négatif (ou prétérit négatif) n’est qu’une variante de l’accompli conditionnée par l’adverbe de négation ur « ne... pas » ou l’une de ses variantes. Par ailleurs, le touareg présente un thème verbal supplémentaire formé sur celui de l’accompli (prétérit) : le thème de «prétérit intensif», marqué par un allongement vocalique. Ce thème est défini comme un «accompli résultatif» par Galand (1974 : 23). Il réfère à un état durable/stable par opposition à l’accompli qui renvoie à l’accomplissement unique et ponctuel d’un procès (Chaker, S. 1997 : 3). L’interaction entre les aspects «grammatical», «lexical» et «phasal» en berbère 197 RSP • 2014 • n° 35-36 Aoriste Accompli inaccompli Glose amz-x t- amz -t y- amz t- amz n- amz t- amz -m t- amz -mt amz -n amz -nt umz-x t- umz -t i- umz t- umz n- umz t- umz -m t- umz -mt umz -n umz-nt ttamz-x t- ttamz -t i- ttamz t- ttamz n- ttamz t- ttamz -m t- ttamz -mt ttamz -n ttamz -nt « je- tenir» « tu- tenir» « il- tenir» « elle- tenir» « nous- tenir» « vous- tenir (masc.)» « vous- tenir (fem.)» « ils- tenir» « elles- tenir» Le thème de l’aoriste est considéré par les linguistes comme une forme « non marquée » (Basset (1952 : 14), Penchoen (1973 : 42), Galand, (1977 : 298), entre autres). Pour Bentolila (1981 : 116), l’aoriste est la « forme nue » du verbe3. Il n’exprime en lui-même aucune valeur temporelle, aspectuelle ou modale, de ce fait polyvalent et déterminé par le contexte. Il ne peut apparaître seul dans un énoncé. Il est soit précédé de la particule ad pour exprimer une valeur futur, modale ou complémentaire selon le contexte, soit précédé par une autre forme verbale « marquée » pour revêtir la valeur conférée par cette dernière4. Quant à l’accompli et à l’inaccompli5, il est généralement admis que le premier est employé pour désigner une action achevée dans le passé, tandis que le second est utilisé pour dénoter une action habituelle, durative, itérative ou modale. 3 Le thème de l’aoriste permet de distinguer entre deux formes verbales qui ont la même racine consonantique : à partir d’une même racine consonantique comme s, par exemple, nous pouvons distinguer à l’aoriste plusieurs formes verbales distinctes : asi « prendre », as « convenir », asu « tousser ». 4 L’aoriste est une forme qui ne connaît pas d’occurrence à l’initiale absolue d’un énoncé, il a besoin de la présence d’une autre forme verbale ou d’un morphème pour acquérir une valeur, ce qui explique sa dépendance syntaxique et la dénomination d’« enchaîné » par laquelle Bentolila puis d’autres linguistes ont l’habitude de le désigner. C’est dans le même sens que Leguil (1983) affirme que l’aoriste ne peut apparaître qu’en position « appuyée ». 5 Chaker (1997 : 186) affirme que l’inaccompli « est une ancienne forme dérivée (une « dérivation de manière », cf. D. Cohen 1968) à valeur durative ou itérative : sa formation à partir du thème primitif d’aoriste trahit immédiatement sa nature originelle de forme secondaire ». Samira Moukrim 198 RSP • 2014 • n° 35-36 Dans le parler étudié (tamazighte du Moyen Atlas), les thèmes de l’aoriste et de l’inaccompli peuvent être accompagnés des particules préverbales ad et la (ou sa variante da). La tradition berbérisante a longtemps considéré ad comme la marque du futur. Quant aux travaux les plus récents, ils hésitent entre aspect (Penchoen 1973, Chaker 1984, 1995) et modalisation (Bentolila 1981)6. Quant à la particule préverbale la7, elle se combine avec l’inaccompli pour donner à cette forme verbale la valeur de déroulement concomitant, co-incidant, synchrone (= « en train de »)8. 2. L’expression du « temps » en berbère : le « présent » comme exemple Pour voir comment cette langue aspectuelle exprime le temps, nous avons adopté le principe de la compositionnalité holiste (Gosselin, 1996 : 180), principe selon lequel: « l’ensemble des marqueurs de l’énoncé, et plus généralement du texte, interagissent les uns avec les autres pour déterminer leurs effets de sens »9. En effet, les marques aspectuelles et temporelles se répartissent sur divers éléments de l’énoncé (le verbe, le temps/aspect verbal, les compléments du verbe, les circonstanciels, les constructions syntaxiques, etc.) lesquels interagissent les uns avec les autres. 6 Dans certains parlers du Rif (Qarya, Aklim) et dans le parler de Figuig (Kossmann, 2000), on trouve, à côté de la particule ad, d’autres particules comme sa(d) et xa(d) qui sont probablement la forme abrégée de ∂xs ad « vouloir que ». Dans le dialecte tachelhite, l’aoriste peut être combiné aussi bien à rad qu’à ad. La première permet d’exprimer exclusivement le futur alors que ad sert à exprimer des valeurs modales ou aspectuelles. Par ailleurs, à côté de la particule préverbale la qui accompagne l’inaccompli en tamazight et en kabyle, on trouve d’autres particules préverbales, selon les parlers, comme les particules qa (/qay/aqqa) et ttuγa en rifain, et ar et da en tachelhite. 7 La particule préverbale la, serait d’origine verbale d’après E. Laoust (1924), hypothèse à laquelle souscrit également P. Galand-Pernet (1973-1979) et Chaker (1997 : 195). Ce dernier affirme que ce préverbe peut avoir pour origine le verbe ili « être » dont elle pourrait être une forme réduite (y-lla « il est/existe » (y-lla > lla > la > a ( ?))) et qu’il se serait agi au départ d’un usage du verbe ili « être » en tant qu’auxiliaire d’actualité/ concomitance, spécifiant l’existence actuelle et effective du procès. 8 (Chaker, 1984 : 170). 9 (Gosselin 1996 : 10-11) avance que la compositionnalité holiste adoptée était déjà affirmée par F. de Saussure (1978 : 177) : « le tout vaut par ses parties, les parties valent aussi en vertu de leur place dans le tout » ; et aussi par le principe ‘contextuel’ de G. Frege (1969 : 122). L’interaction entre les aspects «grammatical», «lexical» et «phasal» en berbère 199 RSP • 2014 • n° 35-36 Concernant l’expression du temps, il a été montré dans Moukrim (2010), à partir d’un corpus authentique et situé10, que toutes les formes verbales de base du berbère tamazight uploads/s3/ aspect-temps-en-amazighe-moukrim-2014.pdf
Documents similaires









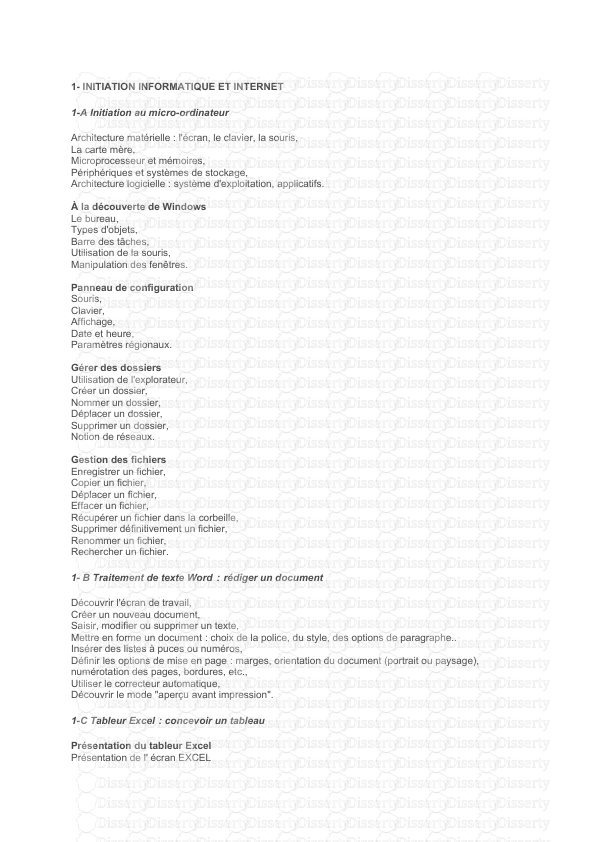
-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 24, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4214MB


