1 UNIVERSITE DE TOAMASINA DEPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE (Centre de Mandri
1 UNIVERSITE DE TOAMASINA DEPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE (Centre de Mandritsara) Le bal manjôfo en pays Tsimihety : entre ambiance et sociabilité. (Dossier technique, cours de méthodologie de recherche) RAKOTONAVORY Jimmy Hilarion Année Universitaire Master II 2012-2013 2 A- La problématique Fahitako azy tokony ho hita taratra amin’ity texte ity ny zavatra hafa mety ahitana ambiance sy sociabilité. Ohatra Rite traditionnels ahitana io ambiance sy sociabilité io, ny tambiro dia toraka izany ihany koa. Ny mythe dia ahitana hanatranatra momba ny sociabilité. Tsy velabelarina fa ambara fotsiny fa tsy ny bal manjôfo irery no ahitana azy fa ireo koa. Fa ny hataontsika dia ny momba irepo zavatra roa ireo ao anaty bal manjôfo. Zavatra tokony ho hita ao koa dia tokony ho sarahinao ny problématique mikasika ny ambiance hita ao amin’ny bal manjôfo sy ny sociabilité ao. Avy eo dia hita taratra @ plan izay. Mbola tsy dia hitako mazava loatra ny gianao ahatongavana. Satria tokony ho ambiance sy sociabilité ary bal manjôfo no tokony hita taratra mibaribary @ exposé nao. Ny rouge dia azo alana, fa ny manga koasa dia soso-kevitra. Le bal manjôfo est l’un des moyens universels (non) pour manifestation la joie dans le pays tsimihety. Un proverbe tsimihety confirme bien cette tendance : « ravoravo tsy mandihy lahy tsy ankahiako ai », (littéralement, manifester ma joie sans danser me paraît incomplet inhabituel ). Le bal manjôfo est incompatible avec le deuil, la tristesse et la saison de pluie pendant la période de pluie. En tant qu’être humain, le désir de l’ambiance et de la sociabilité est humain capital. Les gens riches pensent qu’ils sont plus heureux que les gens pauvres. Mais cela n’empêche que ces derniers veulent et peuvent aussi s’amuser, et le bal manjôfo fait partie des moyens pour le montrer reste le seul moyen efficace pour y accéder chez les tsimihety. Si Pour les riches, organiser un bal nécessite la mobilisation d’une somme colossale pour que la fête soit rassurée réussie à savoir (somme d’argent pour la sonorisation, l’approvisionnement en boissons alcooliques ou hygiéniques avec tous ce qui vont avec, sans oublier la décoration de la salle et même l’état de la salle en question). L’organisateur doit tenir compte du minimum de détail afin que la fête réussisse pour éviter les critiques des invités pour que chacun y trouve de l’ambiance (je ne trouve pas l’utilité de ce passage). Par contre, dans le cas de bal manjôfo, l’organisateur n’aura pas besoin d’avoir beaucoup d’argents pour s’y préparer, il lui suffit d’avoir un bon sens d’organisation. D’habitude, il suffit 3 d’avoir un cadre emplacement simple et spacieux, souvent en plein air. L’essentiel c’est que ceux qui vont venir seront ceux qui espèrent y trouver de l’ambiance. Inconsciemment, ils participent à la création puis à la transmission de l’ambiance sans se rendre compte qu’ils sont les membres à part entière pour la mise en place de la sociabilité pendant l’événement car le bal manjôfo par sa définition c’est une réunion dansante rythmée par un orchestre ; et danser en plein air ensemble c’est déjà un signe de la sociabilité. Et la création de l’ambiance dépend de la symbiose entre le trio : Public – Instruments – Musiciens. Chacun tire son profit, économique ou psychologique, raison pour laquelle les tsimihety sont plus ou moins épargnés par la maladie causée par le stress contrairement aux occidentaux où le taux s’élève à vive allure. Le bal manjôfo priorise donc naturellement l’ambiance et la sociabilité. Au début de la soirée d’un bal manjôfo notamment chez les tsimihety, l’organisateur et les autorités locaux préviennent toujours le public que celui qui perturbe l’ambiance et qui ose interrompre la sociabilité sera « voatady » (1) au poteau. Cela veut dire qu’ambiance et sociabilité sont de nécessité absolue du pour le bal manjôfo. Pendant le bal manjôfo, l’ambiance arrive lorsque les musiciens répondent aux besoins musicaux du public (le salegy est le plus dansé par les Tsimihety: ce rythme est le préféré (de préférence) dans la grande partie nord de Madagascar mais à part cela, leurs attentes se basent sur les rythmes typiquement tsimihety comme : les antosy, bawejy, malesa, etc.) et viennent ensuite quelques rythmes étrangers comme: les reggae, dance, sud africain). La hauteur de la poussière sur la piste causée par les mouvements des danseurs avec l’ambiance ainsi crée donne son nom au bal manjôfo. En plus de la condition climatique chaude s’ajoute la diffusion du rythme qui fait bouger tel le salegy et surtout avec le kaoitry(2)) la montée de poussière devient de plus en plus importante. Etant donné que la Région de la Sofia (3) ne possède pas du bord de la mer (de part sa situation géographique) avec la dégénération de la pratique des sports traditionnels comme (1) Une personne qui a les mains ligotées par derrière (2) Danse du salegy où les gestes sont très proches de rapport sexuel qui fait bouger particulièrement le bassin. Des critiques émanant des notables et des responsables religieux ont été adressées à l’endroit des musiciens qui chantent des musiques profanes vis-à-vis des danseuses vêtues de mini-jupe à moitié nues (3) Région qui se trouve au nord ouest de Madagascar où les Tsimihety sont majoritaires 4 le morengy (4) et les autres sports comme le football, le basketball n’étant pas populaire, le bal manjôfo est l’unique activité qui attire le plus de monde en matière de distraction. Néanmoins, des mesures devraient être prises pour préconiser certaines disciplines afin que la société vive paisiblement avec le bal manjôfo sans se soucier de l’insécurité et de la délinquance juvénile. Ce projet de mémoire de master II, en anthropologie sociale, présente une modeste contribution pour la promotion de la musique traditionnelle tsimihety voire musique malgache. Nombre d’auteurs ont essayé d’écrire sur la musique malgache mais non sur la musique tsimihety. Notre projet de mémoire se veut un travail de pionnier dans le domaine musical tsimihety. La problématique de ce travail sera formulée ainsi : comment le bal manjôfo contribue-t-il à l’harmonie de la société tsimihety ? Quels sont les problèmes que le bal manjôfo doit faire face à la société qui se veut moderne de Tsimihety actuelle ? La société tsimihety à l’état actuel pourra – t – elle se passer du bal manjôfo ? B- Mots ou groupes de mots clés Ambiance, loisirs, sociabilité, la musique et danse, instruments de musique, artistes chanteurs, joie, breuvage, sexualité, distraction, salegy, domination culturelle. C- Esquisse de plan de rédaction Tsara jerena indray mandeha ny plan satria misy répétition satria @ première partie anao manambara histoire bal manjôfo, hita ihany koa izany ao à deuxième partie @ alalan’ny Etude organologique sy ny moment opportun ary ny description. Tokony ho @ partie iray no ahitana azy ireo. Sosokevitry nihinahy fa tsy haiko ny tena marigny ay, samby mpianatra atsika fa zaho milaza ny fahitako azy fotsiny ; Première partie : Approche historico-géographique du bal manjôfo I- Localisation du pays tsimihety II- Histoire du bal manjôfo (4) Boxe traditionnel malgache 5 III- Les Tsimihety en général Deuxième partie : Etudes descriptives du bal manjôfo I- Etude organologique II- Les moments opportuns du bal manjôfo chez les Tsimihety III- Les Artistes du bal manjôfo IV- Déroulement et légitimité du bal manjôfo Troisième partie : la compréhension de bal manjôfo vis-à vis de l’ambiance et la sociabilité I- Le bal manjôfo, distraction numéro un des Tsimihety L’ambiance dans le bal manjôfo, source de bonheur L’ambiance source de la sociabilité dans la société tsimihety II- Les débouchés pendant l’organisation d’un bal manjôfo III- Les danses tsimihety IV- Le sexe pendant le bal manjôfo D- Ebauche de recherche bibliographique a- Revues BELROSE (Huyghes), « La musique de l’histoire », Ambario (Antananarivo), vol. II, n°1-2, pp, 71-86, 1980. DOMENICHINI (Ramiaramanana Michel), « Des instruments de musique de Madagascar », Ambario 2, 1980. RAKOTOMALALA (Mialy Mireille), « La musique à Madagascar, son évolution selon divers 6 Courant d’influence » in Taloha, n°12, pp.203-216, 1994. RAFETY, « Ny ôsika tsimihety », Revio Ambario, Vol II N°1-2, Antananarivo, Imprimerie Catholique, 1980, pp. 135-150. SAUVENET (Pierre), L’ethnomusicologue et le philosophe : quand ils se rencontrent sur le phénomène « rythme », Cahiers de musique traditionnelle, vol. 10 (Rythmes), Paris, Ateliers d’ethnomusicologie Georg., 1997. b- Ouvrages BOUTILLIER (Sophie), GOGUEIL D’ALLONDANS (Alban), UZUNIDIS (Dimitri), Méthodologie de la thèse et du mémoire, Paris, Studyrama, 2007. COMBARIEU (Jules), La musique et la magie, Paris, Picard, 1909. DÔVY, Haisoratra Tsimihety, SÔVA SY OHABOLANA, Fianarantsoa, Ambozontany, édités par P.Manfred M.MARENT ofmcap, 2003. DRHUILE (Paule), Histoire de la musique, Paris, Hachette, 1949. DUVELLE (Charles), Musique Malgache. Commentaire accompagnant le disque OCR (Ocara) 24, Paris, 1965. ESCAL (Fr.), Espaces sociaux, espaces musicaux, Paris, Payot, 1979. FAUBLEE (Jacques), La musique à Madagascar, Paris, Collection du laboratoire d’ethnologie, 1999. KHE (Tran Van), « Musiques traditionnelles et évolution culturelle » in Cultures, vol.I, n°1, Paris, Unesco La Baconnière, 1973. KHE (Tran Van), Vietnam, les traditions musicales, Paris, Buchet-Chatel, 1967. 7 LANFANT(Marie-Françoise), Les théories du loisir, Paris, PUF, 1972. LAVIGNAC, Encyclopédie de la Musique, Paris, Delagrave, 1921. LE ROUX (Maurice), La uploads/s3/ dossier-technique-r-jimmy-hilarion.pdf
Documents similaires






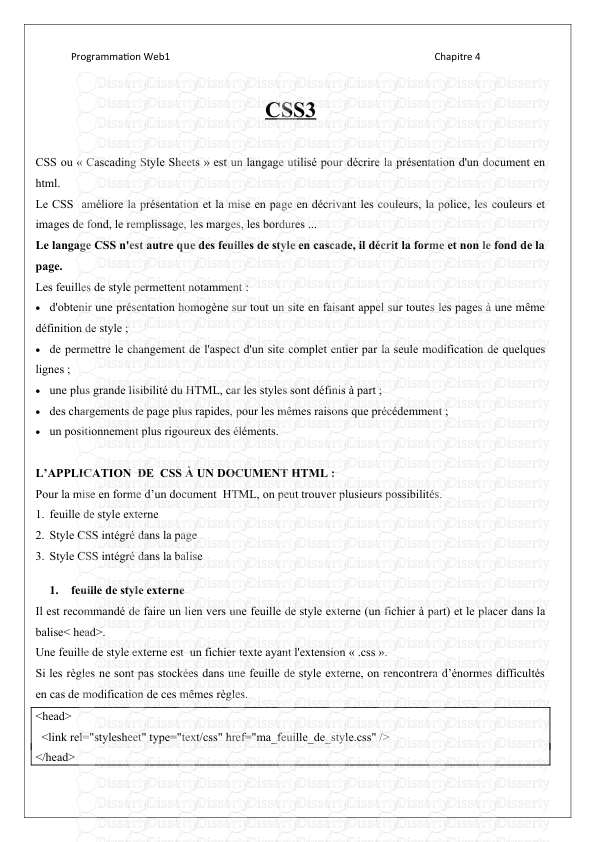
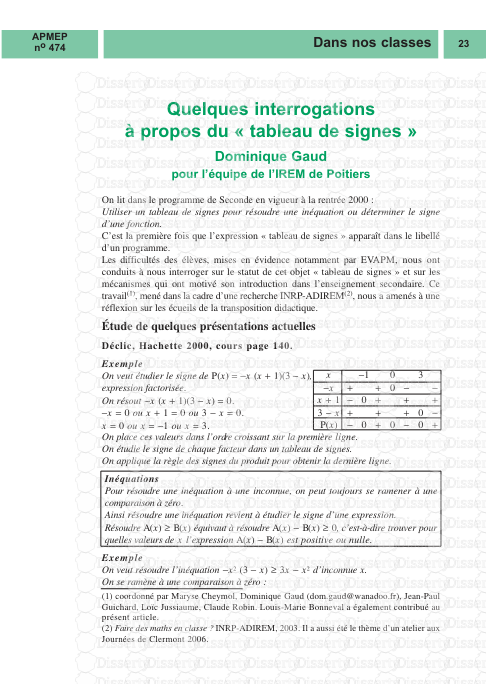


-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 10, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2920MB


