Musée du Louvre : Son histoire et ses œuvres I. Histoire du Musée du Louvre Le
Musée du Louvre : Son histoire et ses œuvres I. Histoire du Musée du Louvre Le musée du Louvre est un musée situé dans le 1er arrondissement de Paris, en France. Il est l’un des plus grands musées du monde, recensant près de 35 000 objets, de la préhistoire jusqu’au XXIe siècle. Ces derniers sont exposés sur une superficie de 60 600 m². Le musée du Louvre est situé dans le Palais du Louvre. Cependant, ce dernier n’a pas toujours été un musée. En effet, pendant la Révolution française, l'Assemblée Nationale a décrété que le Louvre devait être utilisé comme un musée, afin d'afficher les chefs-d'œuvre de la nation. Ainsi, il ouvre le 10 Août 1793 avec une exposition de 537 peintures, la majorité des travaux étant royal et les biens confisqués à l'église, c’est alors que le Louvre devient, le « Muséum central des arts » en 1793. Le Palais du Louvre était jadis une forteresse, construite à la fin du XIIe siècle, sous Philippe II, septième roi de la dynastie des Capétiens. En effet, en 1190, craignant des invasions anglaises, le roi décide de faire construire une enceinte fortifiée autour de Paris et de protéger l’ouest de la cité par une forteresse, le Louvre. Les vestiges de la forteresse sont visibles dans le sous-sol du musée. Le bâtiment a été agrandi plusieurs fois pour former l'actuel Palais du Louvre. En 1682, Louis XIV choisit le château de Versailles pour y loger, laissant le Louvre principalement comme un endroit pour afficher la collection royale. En 1692, le bâtiment a été occupé par l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres et l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, qui a tenu la première d'une série de salons en 1699. L'Académie est restée au Louvre pendant 100 ans, jusqu’à la création du musée à la Révolution française. Cependant, en raison de problèmes structurels de l'immeuble, le musée a été fermé en 1796, jusqu'en 1801. En 1802, sous le pouvoir de Napoléon Bonaparte, le Louvre devient le “musée Napoléon” et s’agrandit avec la construction d’une aile supplémentaire au nord. À la chute de l’Empire en 1815, avec la bataille de Waterloo, la plupart des biens saisis par Napoléon Ier sont restitués à leurs pays d’origine. Sous le Second Empire, Napoléon III donne une nouvelle vie au musée en détruisant les habitations entre le musée et le château des Tuileries. Il fait construire deux grandes ailes, l’aile Richelieu et l’aile Denon au sud. En 1981, le président de la République François Mitterrand lance le projet “Grand Louvre” qui vise à développer le musée dans le palais et de restructurer les espaces autour d’un hall d’accueil central, c’est à ce moment que la pyramide est conçue par l’architecte Leoh Ming Pei. En 2008, la collection est répartie entre huit départements de conservation : Antiquités égyptiennes, Antiquités orientales, Antiquités grecques, étrusques et romaines, Arts de l'Islam, sculpture, les arts décoratifs, des peintures, estampes et dessins. Le mot « musée » (du latin museum, lui-même emprunté au grec mouseîon) signifie, au sens le plus ancien, « temple des Muses », D’après la mythologie grecque, les Muses sont les filles de Zeus et de Mnémosyne, Elles auraient été engendrées au terme de neuf nuits d'amour. Ces neuf sœurs sont chanteuses, instrumentistes et porteuses de joie entre les dieux et les hommes. Si la musique, l’art des Muses, (la « Mousikê » comme l’appelaient les Grecs) est avant tout l’art de Enluminure tirée du calendrier du manuscrit "Les très riches heures du duc de Berry" (représentation datant de Charles V) Le Louvre au XIIIe siècle chanter et jouer d’un instrument, elle est aussi la porte ouverte sur les connaissances : la poésie, la danse, le théâtre, l'astronomie, l’arithmétique… Ainsi, Un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société́ et de son développement, ouverte au public et qui effectue des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, acquiert ceux-là̀, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d’études, d’éducation et de délectation. Le musée a plusieurs missions : -conserver c’est-à-dire assurer la pérennité́ des objets. Pour cela il faut contrôler l’air (pollution, insectes), la température (risques de moisissures, craquelures...), la lumière, la poussière, les risques d’incendie, d’inondation et l’homme (vol, vandalisme), c’est la conservation préventive. Certains objets sont présentés dans les salles d’exposition, d’autres sont conservés dans des réserves, pour des raisons de place, de choix ou de conservation, c’est le cas des œuvres graphiques particulièrement sensibles à la lumière. -restaurer les objets. -inventorier c’est-à-dire lister, nommer, caractériser, photographier... -étudier les objets. On peut faire appel à des scientifiques, à des laboratoires (radiographies, études sous microscope...) pour connaitre la matière dont ils sont faits par exemple et d’une manière générale à des spécialistes selon le type d’objet, son origine et sa date. -publier les résultats des recherches. -enrichir la collection par des achats, en suscitant des dons ou des prêts. -exposer les collections et organiser des expositions temporaires, c’est-à-dire présenter, organiser, confronter les œuvres. -informer les visiteurs dans le musée au moyen de cartels (petites étiquettes placées près des objets), de fiches explicatives, dépliants, guides... et hors du musée par des dépliants, livres, guides et par les moyens médiatiques... L’information passe aussi par le libre accès du public à la documentation des œuvres (documentation et bibliothèque). -organiser la médiation des œuvres auprès des différents publics au moyen d’écrits, d’audioguides ou en organisant des visites guidées, des conférences, des animations, des ateliers... Le musée est cependant avant tout un lieu d’éducation. Lieu de mémoire, il conserve le patrimoine collectif et doit permettre à tous d’y accéder. Le musée met alors à la disposition du public, et tout particulièrement des artistes, des œuvres patrimoniales qui sont proposées comme modèle. Cependant, il apparaît que les visiteurs des musées sont des personnes disposant de temps et d’un certain bagage culturel. Ainsi, quand Zola fait entrer une noce au Louvre, il nous offre le spectacle, trop réel et toujours d’actualité, d’un public qui entre avec beaucoup d’espoir, qui voit mais n’ose regarder, qui se perd et s’angoisse, et qui ressort avec soulagement et surtout avec la sensation d’avoir été bafoué. Ce constat a engendré l’idée, qui perdure encore aujourd’hui, d’un lieu poussiéreux, austère et ennuyeux, un lieu réservé à une élite possédant les clefs de la compréhension des œuvres. Si c’est bien autours de ces clefs que se joue l’avenir du musée, elles ne sont pas faites de ce qui est véhiculé par l’imaginaire collectif. En effet, l’œuvre n’est pas seulement constituée d’un contenu narratif. L’image est d’abord un vecteur d’émotions, elle parle à notre vécu, à notre imaginaire et à nos sens. En tant que lieu public, le musée, comme la bibliothèque, la salle de cinéma ou de concert, nécessite l’apprentissage d’un comportement. Comme pour lire ou pour écouter de la musique, il faut disposer de temps et de silence, afin de rentrer en communication avec l’œuvre. Ainsi, la première finalité de tout activité culturelle est le plaisir et non l’acquisition de connaissances. L’apport des œuvres italiennes en France remonte à Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498. En effet, ce dernier s'était pris d'enthousiasme et de passion pour l'Italie. Sur la route de Naples, dès qu'il avait été reçu à la Sforzesca, une vaste et agréable villa édifiée par les ducs de Milan, le souverain fut fasciné par ce « très plaisant et délectable lieu ». Tout au long de son périple latin, il apprécia les cités prospères et policées où les demeures patriciennes n'avaient plus besoin de se prendre pour des forteresses, il goûta aussi à un art de vivre dans des palais lumineux et des jardins en terrasses, à leur féerie mouvante animée par des jets d'eau, où tout ne paraissait qu'abondance, richesse et beauté. Aussi, au retour de sa courte campagne de Naples, en 1495, le souverain rapporta avec lui à titre de trophées, comme l'avaient fait les Vénitiens après la conquête de Byzance en 1204, non seulement un riche butin, mais aussi des œuvres. D’autres rois de France jouèrent également un rôle important dans l’apport d’œuvres italiennes en France. De tous ces rois, c’est François Ier qui tombe le plus profondément amoureux de l’Italie et de son art. Déjà, Charles VIII et Louis XII avaient ramenés des artistes d’Italie, et introduit l’art nouveau dans l'ornementation des châteaux d'Amboise et de Blois. En effet, à partir 1515, date de la victoire de la bataille de Marignan, le roi a rapporté de ses campagnes d’Italie le mouvement artistique et culturel qui s'y était développé. Le château de Fontainebleau, qui a fait l'objet de chantiers d'embellissements conduits par des artistes italiens, en est la plus belle démonstration. Cependant, François Ier sera le premier souverain à constituer une collection de statues et de tableaux dus aux maîtres italiens. S'il ne put parvenir à persuader Michel-Ange de venir en France, il lui acheta une statue d’Hercule. Il eut plus de succès avec Léonard de Vinci et Benvenuto Cellini. En effet, uploads/s3/ muse-e-du-louvre-son-histoire-et-ses-oeuvres.pdf
Documents similaires




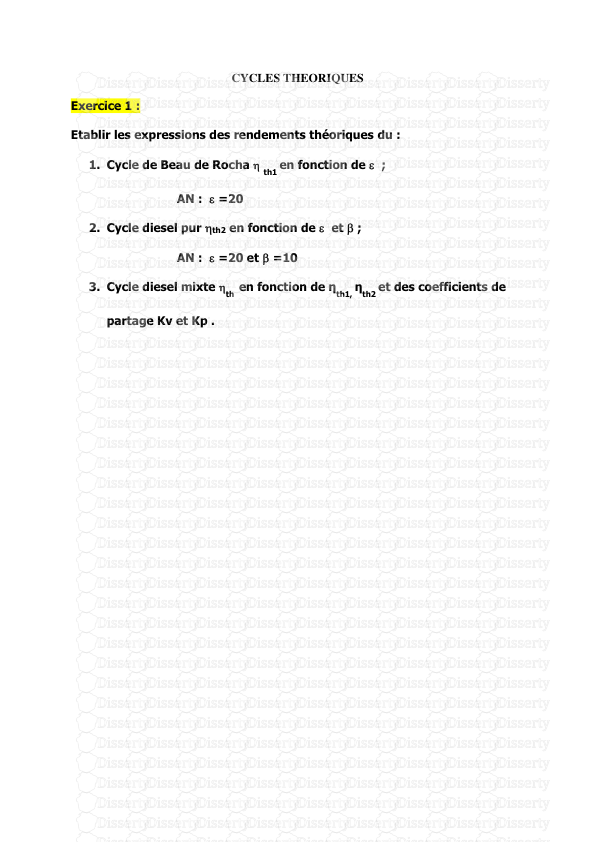





-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4707MB


