Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (
Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) L’examen neurologique pour les internes L’examen neurologique doit faire partie de tout examen clinique, il doit être complet et orienté par les données de l’interrogatoire. I/ l’interrogatoire : 1- Les signes fonctionnels suivant sont systématiquement recherchés : - Les algies cranio faciales - Les troubles sensitifs subjectifs - Les troubles sphinctériens et génitaux 2- Vigilance et fonctions cognitives : a. La vigilance Elle est évidemment appréciée lors de l'entretien lorsque celui-ci est possible (tendance à l'endormissement ?) et plus précisément avec l'échelle de GLASGOW (voir le cours sur les troubles de la conscience). b. Les fonctions cognitives (ou intellectuelles) Elles recouvrent : A. Les fonctions instrumentales a. Examen du langage Expression orale : dénomination. L'expression orale est largement évaluée durant l'entretien, mais plus précisément lors des épreuves de dénomination d'objets usuels présentés visuellement. Il peut s'agir d'objets concrets (Ex: stylo, ciseaux, montre, crayon, lunette, etc.) ou d'images d'objets. Compréhension orale : désignation et ordres. En tenant compte d'une éventuelle hypoacousie, l'examen repose sur une désignation d'objets usuels (« montrez moi le stylo, la porte »...) et l'exécution d'ordres (mettez l'index de la main gauche sur l'oreille droite, par exemple). Expression écrite : écriture spontanée, copiée, dictée, de mots réguliers, irréguliers et ambigus. Compréhension écrite : lecture à voix haute de syllabes, de mots, de phrases, et exécution d'ordres écrits. 1 Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) En cas de troubles du langage on distingue 2 grands types d’aphasie : L’aphasie motrice (de Broca) : réduction du langage qui est quantitativement diminué avec hésitation et lenteur de l’élocution, il s’agit d’une difficulté d’expression de la pensée par les mots : le malade parle peu, il emploie un petit nombre de mots. Il n’existe pas de trouble majeur de la compréhension du langage parlé ou écrit L’aphasie sensitive (de Wernicke) : l’expression orale est facile et abondante mais le sujet emploie des mots inappropriés, ce qui réalise une paraphasie ou une jargonophasie, il existe des trouble de la compréhension du langage parlé et écrit. b. Examen des gestes et du schéma corporel. On demande au sujet d'exécuter des gestes significatifs : pantomimes (planter un clou), gestes symboliques (salut militaire, « V » de la victoire avec les doigts de la main) de désigner et dénommer des parties de son corps c. Examen des fonctions visuo spatiales Réalisation d'un dessin (marguerite) ou d'une figure géométrique (cube), sur ordre et sur copie Dessin du plan de la pièce, positionnement des grandes villes de l’Algérie sur une carte d. Calcul mental et écrit B. La mémoire L’examen de la mémoire repose sur l'entretien avec le patient et son entourage proche, dont le témoignage est essentiel. On examine successivement : La mémoire en situation de vie quotidienne (celle dont se plaignent les malades et/ou leur entourage) : présence d'oublis dans les activités courantes. On fait préciser les modalités d'installation, la durée d'évolution, la progression éventuelle, le retentissement en terme d'autonomie (simple gêne, nécessité d'aide-mémoire, nécessité d'une supervision des activités par un tiers). La mémoire autobiographique, tant les faits récents (« Qu'avez-vous fait le week-end dernier ? ») que les faits plus anciens (ex : « Où avez-vous passé vos dernières vacances » ?) La mémoire sociale ou collective (actualité politique nationale et internationale, journal local) La mémoire sémantique (capitale de l'Italie, connaissances professionnelles) 2 Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) C. Les fonctions exécutives Il existe des tests spécifiques pour tester les fonctions exécutives du patient I I/ Examen physique : A/ Examen des nerfs crâniens : -I: nerf olfactif Faire respirer au malade des odeurs caractéristiques (tabac, café, savon) Parmi les anomalies rencontrées, on retrouve : - l'hyposmie ; - l'anosmie. L’examen du nerf olfactif prend une importance particulière lors de certaines pathologies tumorales - II : nerf optique : Explorer la vision : a - L'acuité visuelle On désigne sous ce terme le pouvoir qu'a l'œil de distinguer l'un de l'autre deux points plus ou moins distants : on parle aussi de pouvoir discriminatif. D'un point de vue neurologique, on ne considère les déficits visuels qu'après correction des troubles de la réfraction. On désigne sous le terme d'amblyopie, toute diminution de l'acuité visuelle ; et sous celui d'amaurose, l'absence de toute perception lumineuse (l'usage réserve ce mot au déficit complet monoculaire et/ou transitoire). La cécité désigne plutôt une absence définitive et complète de vision d'un ou des deux yeux. La dyschromatopsie signifie : trouble de la perception des couleurs. b - Le champ visuel L'étude du champ visuel permet d'étudier le fonctionnement de la rétine fonctionnelle centrale mais aussi périphérique et celui des voies optiques. 1. Le champ visuel au doigt On procède d'abord à une étude d'ensemble en demandant au malade de fixer le nez de l'examinateur. Ce dernier place ses index latéralement un peu en avant du plan des yeux du malade. Celui-ci reçoit pour consigne de saisir le doigt qui bouge. 2. Les hémianopsies Sous le terme d'hémianopsie, on désigne la perte de la vision dans un hémichamp (et non d'un seul œil) ; le trouble affecte habituellement un hémichamp visuel au niveau des deux yeux. Les hémianopsies altitudinales sont très rares : le sujet ne voit pas l'hémichamp supérieur ou l'inférieur. Dans les hémianopsies latérales, la limite entre les deux hémichamps (celui qui est vu 3 Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) et celui qui ne l'est pas) est vertical : Dans l'hémianopsie latérale homonyme (H.L.H.), l'atteinte affecte les deux hémichamps droits ou gauches ; ainsi dans l'H.L.H. droite, sont atteints l'hémichamp temporal de l'œil droit et l'hémichamp nasal de l'œil gauche, et inversement pour l'H.L.H. gauche. Dans l'hémianopsie bitemporale, le patient ne perçoit pas les deux hémichamps temporaux (le malade a des « œillères »…) Dans l'hémianopsie binasale, le patient ne voit pas les deux hémichamps nasaux (le malade a un « poteau » devant le nez…). lorsque l'hémianopsie se limite à l'atteinte d'un quadrant (on parle de quadranopsie ou d'hémianopsie en quadrant), il s'agit plutôt d'une lésion des radiations optiques : la quadranopsie est supérieure, si la lésion touche le faisceau ventral ou inférieur (temporal) ; elle est inférieure, si la lésion intéresse le faisceau dorsal ou supérieur (pariétal). 4 Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) 3. Les scotomes Ce sont des lacunes affectant le champ visuel central ; elles correspondent à des atteintes du faisceau maculaire et entraînent donc une baisse précoce et importante de l'acuité visuelle : la lecture est très vite impossible, alors que la vision périphérique est relativement conservée. Parfois le scotome est hémianopsique. 4. La cécité corticale Il s'agit en fait d'une double hémianopsie à laquelle s'ajoute souvent une anosognosie qui explique que le malade semble négliger les déboires qu'il rencontre du fait de son trouble. Ce trouble correspond habituellement à des lésions corticales bilatérales. Le réflexe photo-moteur est conservé. - c- fond d'œil : qui doit faire partie de tout examen clinique. - III, IV, VI : Nerfs moteurs de l'œil : Leur examen comporte : - l’examen de la motilité oculaire extrinsèque par l'étude des mouvements des yeux, chaque œil séparément, puis des mouvements conjugués des 2 yeux - l'étude de la motricité oculaire intrinsèque, - l'inspection des pupilles (recherche d'une anisocorie), - l'étude des réflexes : photomoteur et d'accommodation convergence. III : nerf moteur oculaire commun : nerf oculo-moteur (selon la nouvelle dénomination anatomique) Le nerf moteur oculaire commun innerve les droits supérieur, inférieur et interne, et le petit oblique, mais il transporte aussi l'innervation sympathique de la pupille et l'innervation du releveur de la paupière. Sa paralysie complète entraîne un strabisme externe (divergent), une diplopie, un ptôsis et une mydriase aréactive. IV : le nerf pathétique (trochléaire) innerve le grand oblique. Sa paralysie entraîne une diplopie dans le regard vers le bas. VI : le -nerf moteur oculaire externe (abducens) innerve le droit externe. Sa paralysie entraîne un strabisme interne (convergent) avec diplopie en cas de constitution rapide de la paralysie. - V : Nerf trijumeau : Le nerf trijumeau est un nerf mixte, avec une petite branche motrice qui innerve le masséter, et trois branches sensitives qui assurent la sensibilité cutanée et muqueuse de la face ainsi que la sensibilité d'une partie du cuir chevelu ; On distingue : le V-1, nerf ophtalmique le V2, nerf maxillaire supérieur le V3, nerf maxillaire inférieur, 5 Karim T service de neurologie Annaba Ajouter moi sur Facebook : Karim touaref (neurologie) Chercher : Hypoesthésie ou anesthésie d'une ou de plusieurs branches du nerf Déficit de la contraction des masseter Abolition des réflexes masséterien et coornén. - VII : Nerf facial : Le nerf facial est un nerf mixte, essentiellement moteur, il innerve les muscles peauciers de la face et du uploads/s3/ observation-et-examen-neurologique 1 .pdf
Documents similaires




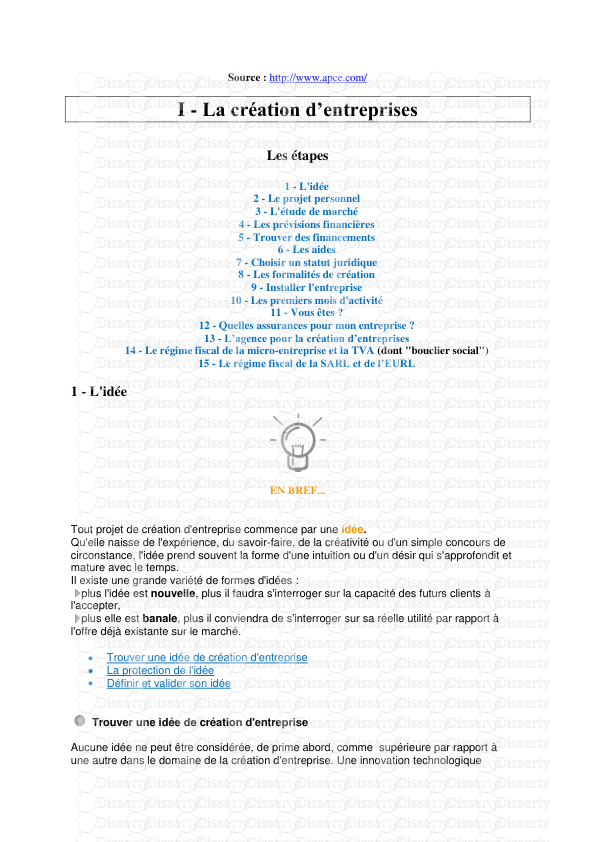





-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 13, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1768MB


