© Tania Collani 2004 L’art surréaliste et le fantastique cérébral Séminaire d’A
© Tania Collani 2004 L’art surréaliste et le fantastique cérébral Séminaire d’Art et Lettres : Les Phantasmes et les Icônes du fantastique Tania Collani Università degli Studi di Bologna © Tania Collani 2004 2 Sommaire Introduction 1. Suggestion pour une définition d’art fantastique 2. Le fantastique et le merveilleux chez les surréalistes 3. L’art surréaliste : fantastique, magique et merveilleux 4. L’art surréaliste et le fantastique cérébral Conclusion Bibliographie © Tania Collani 2004 3 Introduction Si on rencontre plusieurs difficultés à définir une littérature fantastique, en ce qui concerne les recherches et les théories au sujet de l’existence d’un art fantastique, on est encore bien loin de trouver une solution non pas univoque, mais même acceptable et cohérente du début à la fin. Si au niveau littéraire la thèse de Todorov semble être encore la plus solide, au niveau des arts visuels on n’a pas une étude de la même pertinence. Bien qu’accusée d’être un simple résumé des théories antécédentes, renfermant le fantastique dans l’écart entre la sphère du merveilleux et celle de l’étrange, la théorie todorovienne arrive à considérer la littérature avec des notions qui ne ressortent pas du champ formel, sans retomber dans des classifications thématiques assez superficielles. On voudrait donc affronter la définition d’art fantastique avec la rigueur démontrée par Todorov en parlant de la littérature. Mais le problème est bien plus vaste que celui littéraire considéré car, dans l’espace d’un tableau, est souvent exclue la dimension de la durée (mais on cherchera à démentir ce point au cours du travail), qui est l’élément essentiel pour la création de l’effet fantastique, c’est-à-dire de l’hésitation. La théorie de Caillois à propos de l’irruption de l’inattendu pourrait être appliquée au domaine de l’art, mais elle ne serait qu’un petit grain dans une mer de sable, vu qu’on pourrait démonter cette conception seulement en introduisant la variante temporelle et historique : si Dada et les surréalistes créaient un sentiment de désarroi, d’angoisse ou de surprise chez les spectateurs du début du siècle, leurs œuvres pourraient ne créer aucune stupéfaction chez un spectateur cultivé du XXIe siècle, qui voit bien d’autres étrangetés, à la télévision par exemple. On considère assez superficiel de déplacer toute l’attention dans le domaine du spectateur : même si c’est très à la mode aujourd’hui de centrer tout art au niveau de la réception (la biennale d’art de Venise de 2003 a été intitulée « la dictature du spectateur ») on risque d’exclure la volonté de l’artiste et de l’œuvre en soi. La jouissance d’un certain type d’art ne peut pas être réduite à un seul fait de courage ou de sensibilité du spectateur. Il faut respecter aussi la dimension ‘indépendante’ d’une œuvre d’art. © Tania Collani 2004 4 Rapprocher le genre fantastique, qui maintient, aussi au XXe siècle, les modalités formelles qui le caractérisent à l’époque romantique, et l’avant-garde surréaliste, qui prend en charge un acte de rupture avec un système artistique et littéraire vétuste, comporte un enrichissement du champ des applications possibles de la catégorie du « fantastique », mais peut représenter une constriction pour le champ d’action du mouvement surréaliste. Cependant on voudrait essayer de prouver qu’il existe une évolution formelle du fantastique au XXe siècle et on voudrait justifier cette prise de position en utilisant une portion de l’art surréaliste qui s’avère, dans sa totalité, très varié et liée à la période1, aux artistes et au développement des recherches surréalistes. Certes on ne pourra jamais réduire le surréalisme au fantastique ; on est conscient que, dans ce travail, on négligera l’essence du surréalisme (liberté et amour) pour n’en prendre que des manifestations limitées, telles que les jeux gratuits entre mots et peinture. Le surréalisme prévoit, en outre, une réception ‘élitiste’ de son art, dans le sens que le spectateur est entraîné du point de vue intellectuel, la compréhension de l’art surréaliste étant adressée à un public élu, qui connaît les recherches surréalistes ; tandis que le fantastique comporte une participation plutôt émotionnelle, destinée à une réception populaire. On aurait pu affronter directement la question de l’art fantastique à l’intérieur du mouvement surréaliste, mais on a cru indispensable de partir avec une définition approximative d’un art fantastique. Le travail continuera avec un aperçu sur l’emploi des termes « fantastique » et « merveilleux » dans le cadre de cette avant-garde, trop souvent comptée parmi les rangs du « merveilleux » sans une vraie justification préalable. Et, enfin, on appliquera la théorie et les définitions données, qui ne se veulent pas définitives ou exhaustives au sujet, à un mini-corpus arbitraire d’images surréalistes tirées du peintre René Magritte. 1. Suggestions pour une définition d’art fantastique On voudrait ici adopter une approche plutôt historique, en considération du fait qu’on ne dispose pas encore d’une théorie cohérente qui permette d’imposer une thèse 1 Les années qui précèdent l’engagement du surréalisme au sein de la révolution communiste voient une production artistique assez différente de la période subséquente. © Tania Collani 2004 5 univoque et de la justifier dans cette étude. À ce propos il est très important de remarquer que, si l’on peut parler de littérature fantastique au XIXe siècle sans être contesté, en justifiant cette position avec la documentation du débat théorique au sujet, qui naît précisément à cette époque, on rencontre beaucoup plus des difficultés dans le domaine artistique. D'abord parce que, par le terme « fantastique » appliqué à l’art, on a toujours désigné des notions très différentes et un champ très hétérogène incluant, certaines fois, l’art à partir de la Préhistoire et, dans d’autres cas, arrivant jusqu’à soutenir l’inexistence du « fantastique » en art (c’est le cas de nombreux critiques littéraires qui n’arrivent pas à appliquer la notion de « fantastique » littéraire au champ artistique). Secondement on aperçoit une imperfection sous-jacente et, précisément une imperfection de forme : on ne peut pas prétendre de parler d’art seulement en termes littéraires, faisant recours aux moyens que l’on dispose pour le texte écrit, même si le concept de « fantastique », tel qu’on l’entend dans le milieu de la critique contemporaine, naît à l’intérieur du domaine littéraire. L’art peut être ou non considéré à l’instar d’un langage, d’un système imaginaire ou réel mais, en aucun cas il ne serait réductible à une translittération d’un concept littéraire. Comme Roland Barthes le dit : « Le tableau, quiconque l’écrit, il n’existe que dans le récit que j’en donne ; ou encore : dans la somme et l’organisation des lectures que l’on peut en faire : un tableau n’est jamais que sa propre description plurielle »2. Ou encore, selon Jean-Louis Schefer, cité à l’intérieur de l’article de Barthes : « L’image n’a pas de structure a priori, elle a des structures textuelles… dont elle est le système »3. La description d’un tableau, donc, ne rentre ni dans le champ de la pure dénotation linguistique ni dans le champ de l’élaboration mythique naissant de l’œuvre même. Utilisant encore une fois les mots de Barthes : L’identité de ce qui est « représenté » est sans cesse renvoyée, le signifié toujours déplacé (car il n’est qu’une suite de nominations, comme dans un dictionnaire), l’analyse est sans fin ; mais cette fuite, cet infini du langage est précisément le système du tableau : l’image n’est pas l’expression d’un code, elle est la variation d’un travail de codification : elle n’est pas dépôt d’un système, mais génération de systèmes4. 2 BARTHES, R., La peinture est-elle un langage ? (1969), in BARTHES, R., L’obvie et l’obtus, Paris, Éd. du Seuil, coll. « Points », 1982, p. 140. 3 Ibidem. 4 Ibidem. © Tania Collani 2004 6 Pour envisager la solution du problème définitoire au sujet de l’existence d’un langage pictural, il faut absolument franchir le seuil de l’ ‘inter-disciplinarité’, « tarte à la crème de la nouvelle culture universitaire »5 et aboutir à l’annulation de « la distance (la censure) qui sépare institutionnellement le tableau et le texte »6. Revenant à la définition d’un possible art fantastique, du point de vue historique, si aujourd’hui l’on considère en tant que « littérature fantastique » ce qu’au XIXe siècle les auteurs mêmes définissaient comme des compositions fantastiques (c’est durant ce début de siècle que les recueils de contes fantastiques rejoignent la plus grande expansion) on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même démarche avec l’art. Si Baudelaire au XIXe siècle, dans les écrits du Salon de 1846 et dans les considérations esthétiques concernant les caricaturistes, ressent l’exigence de parler de certains artistes, tels que Goya ou Manzoni, explorant leurs œuvres d’une optique « fantastique », on ne voit pas l’empêchement à prendre en considération ces indices pour une datation vraisemblable de ce type d’art. Si l’on pose la naissance de la littérature fantastique à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle, subséquemment à une sensibilisation historique, qui ne pouvait pas se faire auparavant, en conséquence des romans terrifiants anglais d’Ann Radcliffe et de Lewis, de l’inversion morale et de l’affranchissement du vice du Marquis de Sade, de la veine frénétique uploads/s3/ collani-artfantastique.pdf
Documents similaires









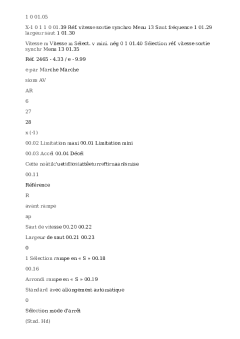
-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 15, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1958MB


