PROGRAMME PROGRAMME • Chap 1 : SYSTEMES AUTOMATISES • Chap. 1 : SYSTEMES AUTOMA
PROGRAMME PROGRAMME • Chap 1 : SYSTEMES AUTOMATISES • Chap. 1 : SYSTEMES AUTOMATISES – 1) ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT 2) TECHNOLOGIE DES CONSTITUANTS – 2) TECHNOLOGIE DES CONSTITUANTS • Chap 2: EQUIPEMENTS ELECTRIQUES – 1) APPAREILLAGES – 2) DEMARRAGES DES MAS • Chap 3 : OUTILS 1) GRAFCET – 1) GRAFCET – 2) API 1 Chap 1 p SYSTEMES SYSTEMES AUTOMATISES AUTOMATISES 2 Leçon 1 ç ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT 3 I DESCRIPTION I. DESCRIPTION 1) GENERALITES On appelle matière d’œuvre (MO) tout élément pouvant être transformé par 1) GENERALITES On appelle matière d œuvre (MO) tout élément pouvant être transformé par un système. Ce peut être de la matière première, de l’énergie, un produit non fini, de l’information, des êtres humains. La valeur ajoutée (VA) est l’objectif global pour lequel le système est défini. Cette VA peut être un bien ou un service. Système MO MO + VA Fonction globale d’un système 4 5 Deux progrès technologiques marquent l’évolution des systèmes l é i ti t l’ t ti ti : la mécanisation et l’automatisation. A t l é i ti • Avant la mécanisation L’opérateur fait parti du système. Il apporte l’énergie (force physique) nécessaire et gère la succession des opérations. Ex : un enrouleur de store à commande par manivelle. • Après la mécanisation p L’opérateur fait parti du système. Il gère la succession des opérations mais sa force physique est remplacée par un apport d’énergie externe au système. au système. Ex : un enrouleur de store électrique muni de boutons « montée » et « descente » du store. • Après l’automatisation L’opérateur ne fait plus parti du système. Un apport d’énergie externe au système remplace sa force physique et il ne gère plus la succession des système remplace sa force physique et il ne gère plus la succession des opérations. Son rôle se limite à surveiller le système. 6 2) DEFINITIONS Un système automatisé (SA) est un ensemble d’éléments permettant 2) DEFINITIONS Un système automatisé (SA) est un ensemble d éléments permettant d’accomplir des tâches bien définies sans ou avec peu d’intervention humaine. Ex : • Distributeur automatique de billets. B iè t il t ti • Barrière ou portail automatique. • Arrosage automatique. • Feux tricolores Feux tricolores. 7 La structure générale d’un SA est la suivante : La structure générale d un SA est la suivante : Tout SA est composé de deux parties : 8 • La partie opérative (PO) qui assure les modifications de la MO afin d’élaborer la VA désirée. Elle représente le processus physique à automatiser. • La partie commande (PC) qui gère de façon coordonnée les actions de la PO afin d’obtenir les effets souhaités. Cette gestion se fait à de la PO afin d obtenir les effets souhaités. Cette gestion se fait à partir d’un modèle de fonctionnement et de diverses consignes. PO et PC échangent entre elles des informations : • Des comptes-rendus dans le sens PO Æ PC. • Des ordres dans le sens PC ÆPO. Un dialogue également s’établit entre l’opérateur et la PC. 9 10 3 OBJECTIFS ET CONSEQUENCES 3 OBJECTIFS ET CONSEQUENCES L SA d l l b d i Les SA sont de plus en plus nombreux dans notre environnement. Ils remplacent l’action de l’homme pour : • Accomplir des tâches pénibles et répétitives. • Intervenir dans des lieux dangereux et inaccessibles. A li d tâ h d d é i i • Accomplir des tâches de grande précision. • Augmenter les cadences de production diminuer les coûts de Augmenter les cadences de production, diminuer les coûts de production, uniformiser la production (cas des SAP). • Renforcer la sécurité. 11 E i il En contre partie, ils : • Ont une incidence sur l’emploi Ont une incidence sur l emploi. • Nécessitent un investissement. • Consomment de l’énergie. • Ont un coût de maintenance. • Exigent la présence d’un personnel plus qualifié. 12 II FONCTIONNEMENT II. FONCTIONNEMENT Le schéma suivant traduit l’organisation fonctionnelle d’un SA. Cette organisation fait ressortir 3 fonctions : l’acquisition des informations, leur traitement puis leur exploitation. 13 14 1) ACQUISITION 1) ACQUISITION Ces informations émanent : 9 Des capteurs et sont relatives à l’état du système. 9 De l’interface H/M et sont les consignes de l’opérateur. Un capteur est un dispositif transformant une grandeur physique observée (ex : température, position, vitesse) en une autre grandeur utilisable (ex : température, position, vitesse) en une autre grandeur utilisable (ex une tension, un courant, une hauteur de mercure, la déviation d’une aiguille). L’interface H/M désigne l’ensemble des dispositifs permettant à l’opérateur de communiquer avec la machine. On distingue les éléments d’acquisition (boutons pédales manettes ) et les éléments de restitution (écran voyant (boutons, pédales, manettes…) et les éléments de restitution (écran, voyant, sirène…). 15 2) TRAITEMENT 2) TRAITEMENT Elle génère des signaux de commande ou ordres en direction de la PO. Cette fonction est assurée par l’unité de traitement ou centre de décision. Elle peut être en logique câblée ou en logique programmée. La technologie câblée C’est l’ancienne technologie des automatismes. Elle met en œuvre des séquenceurs électromécaniques ou pneumatiques. Dans cette technologie, la loi de commande est figée dans le câblage la loi de commande est figée dans le câblage. La technologie programmée Elle fait appel à des outils d’informatique industrielle que sont les automates programmables, les microcontrôleurs ou les cartes dédiées. Elle est de plus l l é C tt T h l i t f il t d t bl b i en plus employée. Cette Technologie est facilement adaptable aux besoins et aux évolutions du processus. 16 3) COMMANDE 3) COMMANDE C’est l’exécution par la PO des ordres émis par la PC. elle met en œuvre 3 types d’objets techniques : l’effecteur, l’actionneur et le préactionneur. ¾ L’effecteur est le dispositif terminal qui agit directement sur la MO pour obtenir l’effet désiré. ¾ L’actionneur est l’organe qui fournit la force nécessaire à l’exécution d’une tâche ordonnée par la PC d une tâche ordonnée par la PC. ¾ Le préactionneur est un élément de gestion de l’énergie. Il commande l’établissement et l’interruption de la circulation de l’énergie entre une source et un actionneur. 17 O di ti l ti On distingue les actionneurs : • Electriques: alimentés en énergie électrique. q g q Ex: moteur, résistance, électroaimant, électrovanne. • Pneumatiques: alimentés par de l’air sous pression • Pneumatiques: alimentés par de l air sous pression. Ex: vérin, ventouse, moteur. • Hydrauliques: alimentés par un liquide sous pression. Ex: vérin. Les actionneurs les plus courants sont le moteur électrique, le vérin pneumatique, l’électrovanne, l’électroaimant, la résistance. 18 Leçon 2 ç TECHNOLOGIE DES CONSTITUANTS 19 I CHAINE D’ACQUISITION I. CHAINE D ACQUISITION 1 INTERFACE H/M L’interface est constituée de boutons poussoirs de voyants Le contact 1. INTERFACE H/M L interface est constituée de boutons poussoirs, de voyants… Le contact électrique reste l’organe privilégié pour l’entrée des informations sous forme de logique binaire. On distingue 2 types de contact : Le contact à fermeture Le contact à ouverture F ou NO O ou NC 20 L’ ti l b t i (B ) l h t d’ét t d • L’action sur le bouton poussoir (Bp) provoque le changement d’état du contact. Dès que le l’action cesse, le contact revient à son état initial. • l’interrupteur possède 2 états stables, il conserve la position prise quand l’action cesse. • Le commutateur (sélecteur) possède plusieurs états stables. Il peut Le commutateur (sélecteur) possède plusieurs états stables. Il peut Actionner un ou plusieurs contacts. 21 Symbole Exemples de commandes y Désignation poussoir tirette rotative Coup de poing Symbole poing Désignation volant pédale levier Levier avec poignée poignée Exemple : Exemple : Bp, NO 22 2) CAPTEURS Les capteurs prélèvent une information sur le comportement de la partie 2) CAPTEURS Les capteurs prélèvent une information sur le comportement de la partie Opérative et la transforment en un signal exploitable par la PC. ce signal est généralement de nature électrique ou pneumatique. L’information donnée par un capteur peut être: • Logique (2 états) • Logique (2 états) • Numérique (valeur discrète) • Analogique g q On peut caractériser les capteurs selon 2 critères: La grandeur mesurée: on parle alors de capteur de position, de vitesse… Le caractère de l’information: on parle de capteur logique ou TOR, de Capteur analogique ou numérique Capteur analogique ou numérique 23 On peut classer les capteurs en 2 catégories: • Les capteurs à contact qui nécessitent un contact direct avec l’objet à détecter • Les capteurs de proximité qui ne nécessitent pas de contact direct. Pour choisir correctement un capteur, il faut définir: le type d’événement Pour choisir correctement un capteur, il faut définir: le type d événement à détecter, la grandeur à mesurer et l’environnement de l’événement. D’autres éléments permettent de cibler précisément le capteur à utiliser : D autres éléments permettent de cibler précisément le capteur à utiliser : Ses performances, son encombrement, sa fiabilité, la nature du signal Délivré, son prix… 24 On peut classer uploads/s3/ controle-commande-2.pdf
Documents similaires



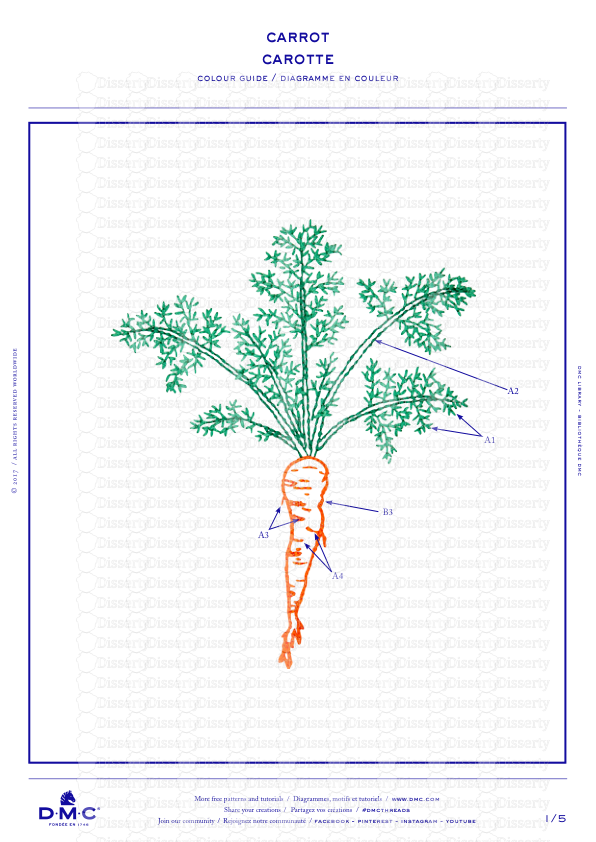





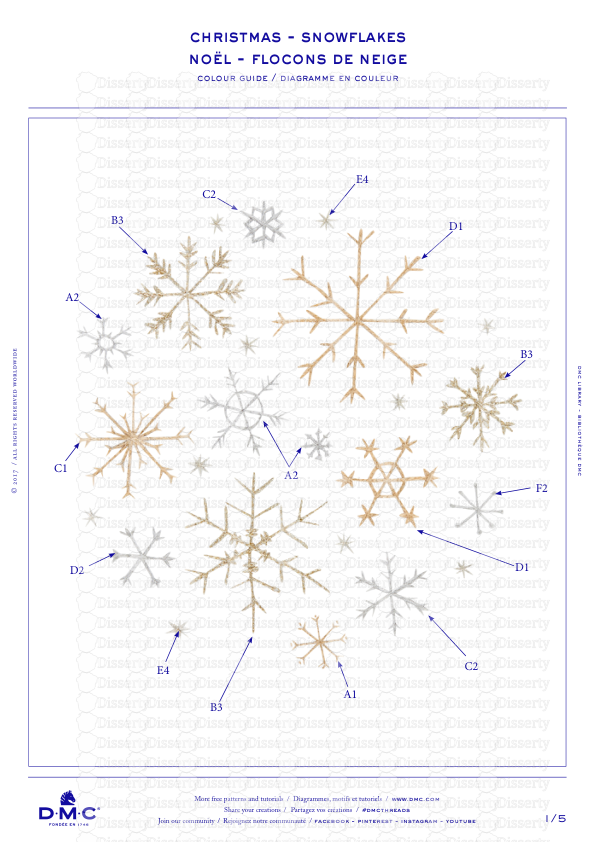
-
115
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 06, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 4.2805MB


