ND 2250 - 203 - 06 HST INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes
ND 2250 - 203 - 06 HST INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2e trimestre 2006 - 203 / 67 Les sons dont le spectre est partiellement ou totalement en dehors de l’intervalle 20 Hz – 20 kHz sont classiquement qualifiés d’inaudibles. Pourtant, la sensibilité de l’oreille s’étend en dehors de cet intervalle, même si elle est beaucoup plus faible pour les infrasons (basse fréquence) comme pour les ultrasons (haute fréquence). De plus, l’être humain peut percevoir les infrasons comme les ultrasons par d’autres voies que le seul chemin auditif. En milieu industriel, les sources émettant des sons dont le spectre se situe en dehors de l’intervalle 20 Hz – 20 kHz sont nombreuses. L’existence d’effets nuisibles ou désagréables à l’homme de ces sons quasi-inaudibles est un fait prouvé dès lors que leurs niveaux sont suffisamment élevés. L’article propose, au moyen d’une revue bibliographique, de préciser la physique de la transmission des infrasons et des ultrasons, la sensibilité humaine aux fréquences associées, les effets physiologiques constatés lors d’une exposition à des niveaux élevés et les mesures de prévention possibles. Les valeurs limites d’exposition proposées par plusieurs pays sont discutées et, en l’absence de réglementation, des recommandations sont proposées. LIMITES D’EXPOSITION AUX INFRASONS ET AUX ULTRASONS Étude bibliographique h Jacques CHATILLON, INRS, Département Ingénierie des équipements de travail 3 Noise 3 Infrasound 3 Ultrasound 3 Limit value alors qu’en réalité, la sensibilité de l’oreille humaine s’étend dans les gammes extérieures à l’intervalle 20 Hz - 20 kHz dès que les niveaux reçus sont suffisamment élevés. Les seuils de sen- sibilité sont très variables d’un individu à l’autre. De plus, les bruits en général, mais aussi les ultrasons comme les infrasons, peuvent être ressentis par une transmis- sion de l’énergie vibratoire à d’autres organes (peau, yeux, muscles, puis crâne et squelette ou organes internes). Cette transmission peut être directe (contact de la peau avec une source d’ultrasons par exemple) ou aérienne quand les vibrations de l’air atteignent l’oreille ou la peau. Comme la sensibilité de l’oreille humaine s’étend de part et d’autre de la limite basse de 20 Hz, et avec une varia- bilité importante selon les sujets, la 3 Bruit 3 Infrason 3 Ultrason 3 Valeur limite INFRASONIC AND ULTRASONIC NOISE EXPOSURE LIMITS - A BIBLIOGRAPHICAL STUDY Sounds whose spectra fall partially or wholly outside the 20 Hz - 20 kHz range are traditionally termed inaudible. Yet, ear sensitivity extends beyond this range, even though it is much weaker for both infrasound (low frequency) and ultrasound (high frequency). Moreover, the human being can perceive both infrasound and ultrasound by means other than only the auditory path. In industrial environments, there are many sources emitting sounds with spectra falling outside the 20 Hz - 20 kHz range. Existence of effects harmful or unpleasant to man due to these virtually inaudible sounds is a proven fact, when their levels are sufficiently high. Based on a bibliographical review, this paper aims to clarify infrasound and ultrasound transmission physics, human sensitivity to the related frequencies, the physiological effects noted during exposure to high levels and possible prevention measures. Exposure limit values proposed by several countries are discussed and, in the absence of regulations, recommendations are proposed. L es bruits dont le spectre se situe totalement dans la bande des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz sont considérés comme des bruits audibles. Les dangers pour l’audition d’une exposition sonore quotidienne à ces bruits audibles lorsqu’ils dépassent certains niveaux sont connus et la réglementation prévoit des seuils d’action bien définis [1] qui seront modi- fiés en 2006 par l’application en droit français de la nouvelle directive européenne sur le bruit au travail [2]. Le mesurage des niveaux d’exposition est normalisé [3] et utilise la pondération A afin de tenir compte de la courbe de sensibilité de l’oreille humaine. Quand le spectre des bruits se situe partiellement ou totalement en deçà de 20 Hz, on parlera d’infrasons [4] tandis que s’il se situe au-delà de 20 kHz, on parlera d’ultrasons [5]. On admet généra- lement que ces bruits sont inaudibles, deux fréquences pures non-infrasonores assez proches peuvent provoquer l’appa- rition d’infrasons par des battements à la fréquence différence (différence entre les deux fréquences de départ) en raison des non-linéarités du milieu. On peut citer aussi des sources d’infrasons moins répandues comme cel- les servant à des applications thérapeu- tiques (massages) ou militaires (armes non létales [11]). Les niveaux de ces der- nières sources ne sont pas publiés. PROPAGATION Comme les bruits audibles, les infrasons sont des ondes sonores se propageant dans un milieu élastique fluide (air) ou dans les solides (sol, struc- tures). Leur gamme de fréquence très basse fait que l’absorption par les milieux traversés est relativement faible. Par exemple, dans l’air, l’énergie d’une onde infrasonore de fréquence 10 Hz diminue seulement de l’ordre de 0,1 dB par kilomètre, à comparer avec une absorption de l’ordre de 10 dB par kilo- mètre pour un son de fréquence audible à 1 kHz. L’atténuation due à la propagation en ondes sphériques (- 6 dB par double- ment de la distance) s’applique aussi aux infrasons et représente souvent le seul terme significatif de diminution de l’énergie des ondes infrasonores avec la distance. La localisation des sources infra- sonores est rendue difficile par la faible absorption : les sources peuvent être très éloignées du lieu où la nuisance est mesurée (plusieurs centaines de mètres). De plus, la gamme de fréquence implique de grandes longueurs d’onde, de l’ordre de 34 m, par exemple, à 10 Hz. La directivité d’une source étant liée à sa grandeur mesurée en longueur d’onde, beaucoup de sources industrielles sont petites devant la longueur d’onde. Elles émettent alors des infrasons dans toutes les directions de l’espace avec une éner- gie à peu près équivalente : les sources infrasonores sont généralement omni- directionnelles. Ces caractéristiques font qu’il sera souvent illusoire de vouloir se protéger des infrasons par des procédés classiques d’isolement et d’absorption acoustique. INFRASONS GÉNÉRATION Les sources infrasonores sont nom- breuses, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Les sources naturelles sont les mouvements violents de l’air (vents, tempêtes, jusqu’à 135 dB à 100 km/h), les fluctuations rapides de la pression atmosphérique (< 1 Hz à 100 dB), les mouvements de l’eau (vagues océa- niques, < 1 Hz) et les vibrations du sol provoquées par des éruptions volca- niques ou des tremblements de terre, qui comportent des composantes basse- fréquence à leur tour ré-émises dans l’air. De même, les sources émettant sur une large bande de fréquence (tonnerre, chutes d’eau) peuvent émettre des composantes de haute énergie se situant dans la partie infrasonore du spectre. Tous les moyens de transport (auto- mobiles, camions, hélicoptères, avions, bateaux, trains) sont des sources de bruit comportant souvent des composantes vibratoires basse-fréquence et infra- sonores [8]. Les passagers d’une auto- mobile ou d’un train peuvent être soumis à des niveaux de 120 dB entre les fréquences 1 Hz et 20 Hz et les niveaux peuvent atteindre de 115 à 150 dB, pour la même gamme de fréquence, dans une cabine d’hélicoptère. En milieu industriel, ce sont princi- palement les machines tournantes lourdes qui sont connues pour leur émission infrasonore [9]. Les ventila- teurs, pompes, compresseurs, machines à sécher, machines à air conditionné, broyeurs, centrifugeuses à béton, etc. produisent couramment des niveaux élevés d’infrasons. Le développement des éoliennes comme source d’énergie électrique renouvelable a amené récemment des polémiques sur leur potentialité à produire des infrasons dangereux pour la santé. Les rares données provenant de mesurage [10] montrent que les niveaux émis sont de l’ordre de ceux des sources naturelles (vent). Les sources impulsives (explosions, chocs) peuvent aussi émettre des compo- santes de haute énergie se situant dans la partie infrasonore du spectre. De plus, certaines sources cohérentes émettant INRS - Hygiène et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 2e trimestre 2006 - 203 / 68 bande de fréquence de 20 Hz à 40 Hz représente une zone de transition entre les infrasons et les sons audibles [6]. Au-delà de 40 Hz et jusqu’à 100 Hz, on admet que l’on a affaire à des sons audibles basse fréquence. De la même façon, la sensibilité de l’oreille aux sons de haute fréquence (gamme 8 kHz – 20 kHz) est très varia- ble d’un individu à l’autre, avec, géné- ralement, une diminution de l’acuité auditive avec l’âge, et plutôt dans cette gamme de haute fréquence, appelée presbyacousie. La zone de transition est, pour cette gamme, généralement considérée à partir de l’octave 16 kHz (première octave non mesurée lors des tests d’audiométrie [7]) qui s’étend d’environ 11,3 kHz à 22,6 kHz, et pour laquelle on parle alors de sons « très haute fréquence » ou d’ultrasons de « basse fréquence ». La sensibilité de l’oreille humaine étant beaucoup plus faible en dehors de la gamme 20 Hz – 20 kHz, les bruits de la gamme infrasonore ou ceux de la gamme ultrasonore sont supposés moins dangereux pour l’audition que les bruits audibles de niveau équivalent. Pourtant, l’existence uploads/s3/ inrs-limites-d-x27-exposition-aux-ultrasons-et-infrasons-nd2250-203-06.pdf
Documents similaires



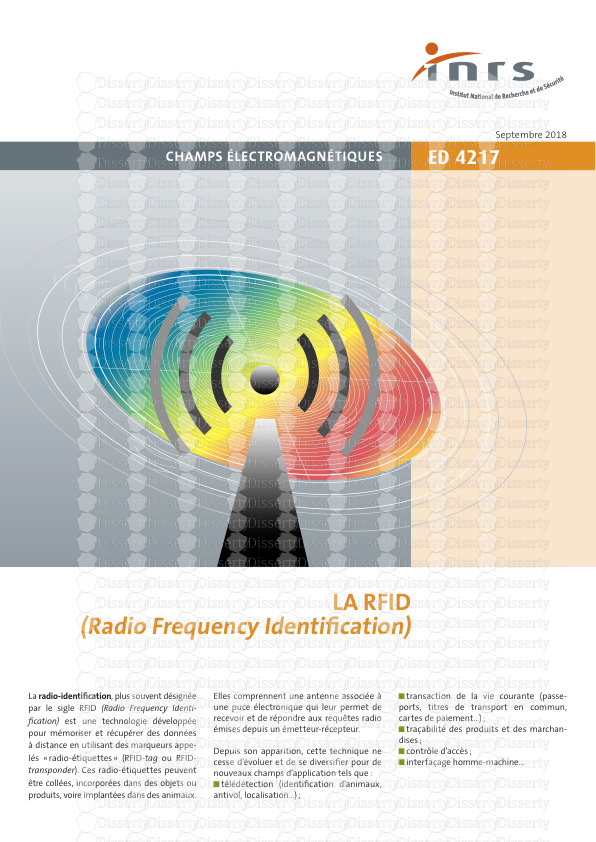

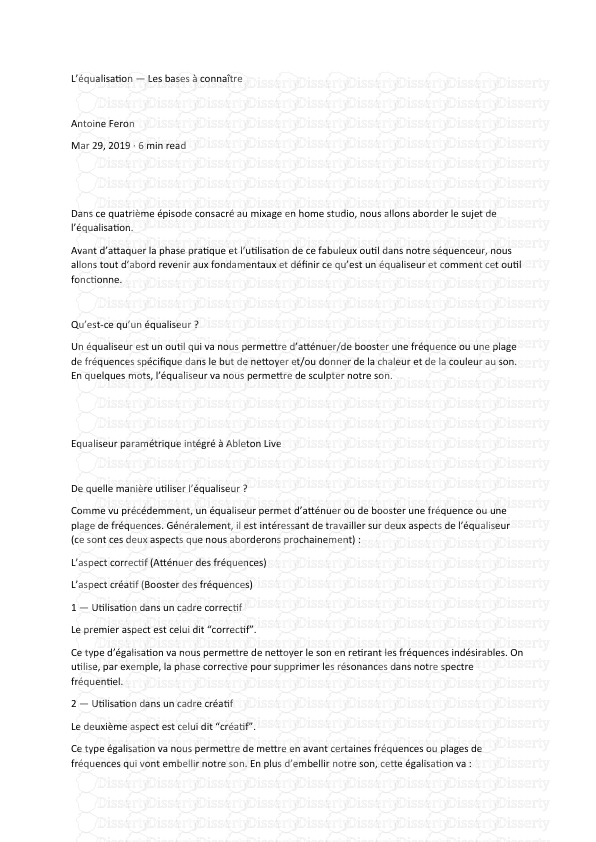




-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 11, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2542MB


