De quels moyens le professeur d'instrument dispose-t-il pour enseigner aux élèv
De quels moyens le professeur d'instrument dispose-t-il pour enseigner aux élèves à entendre la musique avant de la jouer ? Mémoire réalisé pour l’obtention du Master en pédagogie musicale, orientation enseignement instrumental Kevin PAYET, trompette Tuteur du mémoire : M. Fabrice VERNAY Année académique 2017-2018 HEMU – Haute École de Musique de Lausanne Remerciements Je remercie : Mon tuteur Fabrice Vernay qui m'a suivi et encouragé dans la réalisation de cette recherche. Mon professeur, Oliver Theurillat, qui m'a enseigné une vision de la musique qui m'a amené à réfléchir sur ce sujet. Pascal Geay pour le néologisme et son aide de rédaction. Ma femme et ma fille pour leur amour, leurs encouragements, leur soutien et leur patience au quotidien. Résumé Nous pensons qu'entendre la musique avant de la jouer est ce à quoi les artistes musiciens devraient aspirer. En s'inspirant des grands pédagogues musicaux, notamment Edgar Willems et Edwin Gordon, nous tentons dans ce travail de mettre en place des moyens di- dactiques inspirés de leurs concepts et applicables dans l'enseignement de la trompette, tels que l'éveil auditif et l'audiation. Une partie pratique nous permettra de discuter l’évolution de trois élèves grâce à ces méthodes, et de leurs apports dans l'enseignement de la trompette. Mots-clefs : éveil musical, éveil auditif, audiation, domaines d'apprentissages, di- dactique de la trompette. 1 Table des matières Remerciements.....................................................................................................1 Résumé................................................................................................................1 Table des matières...............................................................................................2 Introduction...........................................................................................................3 1. Cadre théorique................................................................................................6 1.1. Edgar Willems...........................................................................................6 Les gammes................................................................................................7 Les intervalles mélodiques...........................................................................7 L'improvisation mélodique............................................................................8 La justesse..................................................................................................8 1.2. Edwin Gordon............................................................................................9 Intraudition : audiation..................................................................................9 Les types d'intraudition............................................................................9 Les stades d'intraudition........................................................................11 Les méthodes et concepts d'enseignement...............................................11 Motif......................................................................................................11 Contexte................................................................................................11 Cycle global/détails/global : « Whole/part/whole cycle »........................12 Contraste..............................................................................................13 Rythme et mouvement..........................................................................13 2. Moyens didactiques........................................................................................14 2.1. Son..........................................................................................................15 2.2. Chant/embouchure..................................................................................16 2.3. Mélodie....................................................................................................16 Imitation................................................................................................17 Les chansons........................................................................................18 Écriture..................................................................................................18 2.4. Rythme....................................................................................................19 2.5. Harmonie.................................................................................................19 3. Mise en pratique.............................................................................................19 3.1. Présentation des élèves..........................................................................19 3.2. Évolution des élèves................................................................................20 Grille de suivi.........................................................................................20 Élève A..................................................................................................21 Élève B..................................................................................................22 Élève C.................................................................................................23 4. Réflexions.......................................................................................................24 Conclusion..........................................................................................................25 Bibliographie.......................................................................................................26 Annexes..............................................................................................................27 2 Introduction La musique est l'art de combiner les sons. Par conséquent, le musicien est un ar- tiste qui s'exprime grâce aux sons. Dans le processus de création musicale, nous avons tout d'abord le compositeur qui imagine des sons, les organise et les écrit le plus souvent sur une partition. Puis nous avons l’interprète, qui a pour rôle de comprendre, d'assimiler ce que le compositeur a imaginé et de le transmettre aux auditeurs. J'ai pu constater, tout d'abord chez moi-même et ensuite chez des instrumen- tistes de tous niveaux, que ce rôle d’interprète est secondaire voire jamais ensei- gné avant un niveau avancé, en dépit de l'enseignement de la technique instru- mentale et du solfège, qui est un enseignement principalement cognitif de la mu- sique. On peut donc déduire qu'une telle formation crée des techniciens, voire, permettez-moi le terme, des « partitionistes », plutôt que de véritables musiciens. En effet, les véritables musiciens utilisent la musique comme un moyen d'expres- sion, un langage. Cela implique qu'ils comprennent et structurent ce qu'ils jouent et qu'ils conçoivent intérieurement la musique avant de la jouer. Willems catégorise les musiciens de la manière suivante : Les mauvais musiciens ne peuvent pas entendre ce qu'ils jouent ; Les médiocres pourraient l'entendre, mais ils n'écoutent pas ; Les musiciens moyens entendent ce qu'ils ont joué ; Seuls, les bons musiciens entendent ce qu'ils vont jouer1. Cette réflexion sur le processus musical n'est pas nouvelle. Dans son ouvrage, Willems cite de grands compositeurs à ce sujet2 : – Dans ses « conseils aux jeunes musiciens », Robert Schumann disait : « Même si tu as peu de voix, exerce-toi à déchiffrer sans l'aide d'un instru- ment ». – Claude Debussy : « Je le dis en tremblant, je crois bien que la musique a reposé jusqu'ici sur un principe faux. On cherche trop à écrire, on fait de la musique pour le papier alors qu'elle est faite pour l'oreille... On fait de la métaphysique, on ne fait pas de la musique. » Dans son article sur la pédagogie d'Edgar Willems, Alain Boudet écrit : Ce n'est donc pas le solfège que l'éducateur cherchera à enseigner d'abord : la musique s'acquiert comme la langue maternelle. On chante sans avoir conscience des sons ni des rythmes. Peu à peu, on distingue les divers éléments. Enfin, on cherche à les écrire. Ainsi le solfège apparaît en dernier. Il est la transcription de quelque chose de vivant. À la lecture, il faut retrouver derrière les notes la vie, et non pas déchiffrer de manière mécanique. Débuter par le solfège est un non- sens : processus mental et abstrait, il est vide de signification s'il n'est pas précédé de la pratique3. 1 Willems, E. (1956). Les bases psychologiques de l’éducation musicale. Paris, France: Presses universitaires de France, p. 62. 2 Willems, E. (1976). L’oreille musicale. 2, La culture auditive, les intervalles et les ac- cords. Fribourg, Suisse: Pro Musica, p. 20. 3 Boudet, A. (1973). Selon Edgar Willems. Routes nouvelles, (n°62). 3 De bien belles paroles, me direz-vous ! Mais quels sont les moyens dont dispose le professeur d'instrument pour enseigner aux élèves à entendre la musique avant de la jouer ? Au début du XXe s., plusieurs pédagogues s'interrogent sur les questions d'éveil et d'éducation musicale : Émile Jaques-Dalcroze et Edgar Willems en Suisse, Carl Orff en Allemagne, Zoltán Kodály en Hongrie. C'est en constatant les lacunes rythmiques de ses élèves qu’Émile Jacques Dal- croze imagine un mode d'enseignement par la musique et pour la musique. Il s'intéresse à la perception physique de la musique : les liens entre rythmes et mouvements. Son influence est au cœur de nombreuses démarches artistiques, telles que la musique, la danse et le théâtre, et également thérapeutiques princi- palement dans le domaine de la psychomotricité. Les travaux d'Edgar Willems traitent principalement des relations unissant les éléments essentiels de la musique (son, rythme, mélodie, harmonie) avec la per- sonnalité humaine (sensorialité, motricité, affectivité, intellect). Selon lui, la musique est à considérer comme un facteur important de la forma- tion de la personnalité humaine. Non seulement parce qu’elle crée un climat particulièrement favorable à l’éveil des facultés créatrices, mais encore parce qu’elle peut vivifier la plupart des facultés humaines et favoriser leur développement4. Le Orff-Schulwerk est une méthode qui s'inscrit dans le courant des recherches psychopédagogiques de grands pédagogues comme Piaget, Decroly et Montes- sori. La philosophie de cette méthode est de favoriser un développement harmo- nieux de l'enfant grâce à la musique dite élémentaire et le mouvement. Elle est ouverte à tous les âges et se veut « non élitiste et ludique ». Elle se pratique en groupe et utilise un ensemble de petites percussions (xylophones, métallo- phones, etc.), appelé instrumentarium Orff. Dans son article de la Revue musicale suisse, Nadia Coppey nous parle de la pédagogie Orff : Le corps [...], la voix [...], et l'instrument [...] sont les trois moyens de base qui aident la progression musicale et développent la musicalité et la créativité. En pédagogie Orff, la percussion corporelle est fonda- mentale car elle fait appel à un travail global de grande portée : maî- trise du geste, psychomotricité, synchronisation, écoute, jeu d'en- semble, etc.5 Dans son article paru dans L'éducation musicale, Jérôme Bloch résume la philo- sophie de la méthode Kodály en ces termes : La méthode Kodály s’adresse tout d’abord aux enfants entre trois et six/sept ans. Pour Kodály, le chant est à la base de tout enseignement musical, avant même l’étude du langage verbal et littéraire. Kodály est persuadé que l’esprit de l’enfant peut acquérir au mieux les fondamen- taux musicaux par des méthodes amusantes, avec l’aide de mouve- ments du corps et des jeux de rythmes. Kodály était aussi convaincu que l’étude d’un instrument devait être précédée par l’apprentissage ludique du chant dans le but de distinguer l’assimilation naturelle, inté- 4 Coppey, N. (2008). La musique habite l’être tout entier. Revue musicale Suisse, (n°9). 5 Coppey, N. (2011). Corps, voix et instrument : la pédagogie de Carl Orff. Revue musi- cale Suisse, (n°9). 4 rieure et physique de la musique, du mécanisme et de l’apprentissage liés à la technique propre de l’instrument6. Kodály va jusqu'à écrire dans l'ouvrage « Selected Writings » : « To teach a child an instrument without first giving him preparatory training and without developing singing, reading and dictating to the highest level along with the playing is to build upon sand. »7 En résumé, même si la forme et les chemins empruntés sont différents, tous ces pédagogues s'accordent sur le fond : l'apprentissage de la musique passe avant tout par le corps, le mouvement et le ressenti avant d’être conscientisé et intellec- tualisé. Au fil de mes recherches, le concept d'audiation, développé par Edwin Gordon, a retenu mon attention. Il le définit comme la capacité à entendre des sons sans qu'ils soient physiquement présents. Par analogie, on peut dire que l'audiation est à la musique ce que la pensée est au langage. Le terme audiation n'existe pas officiellement dans la langue française. Pour ce travail, j'utiliserai donc le néologisme intraudition en référence à une audition intérieure. Le verbe uploads/s3/ payet-kevin-tma.pdf
Documents similaires

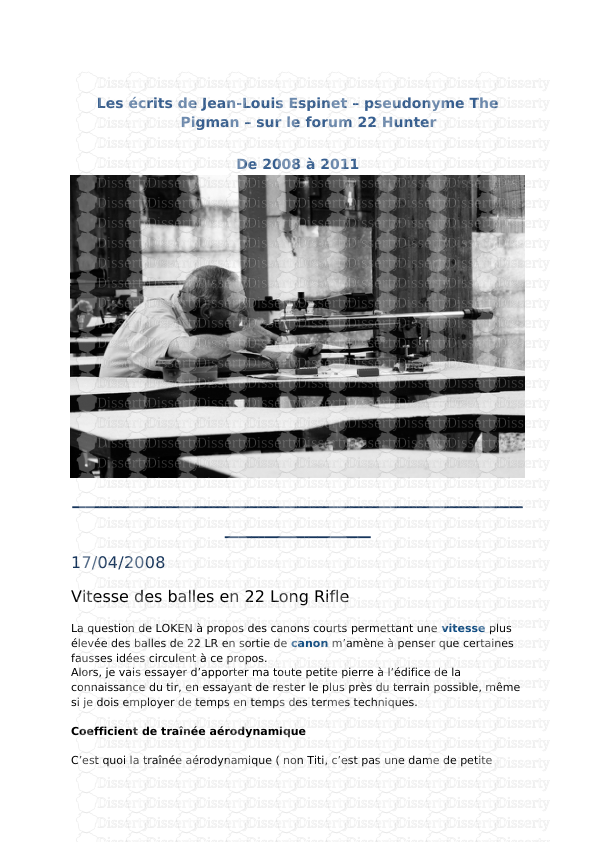







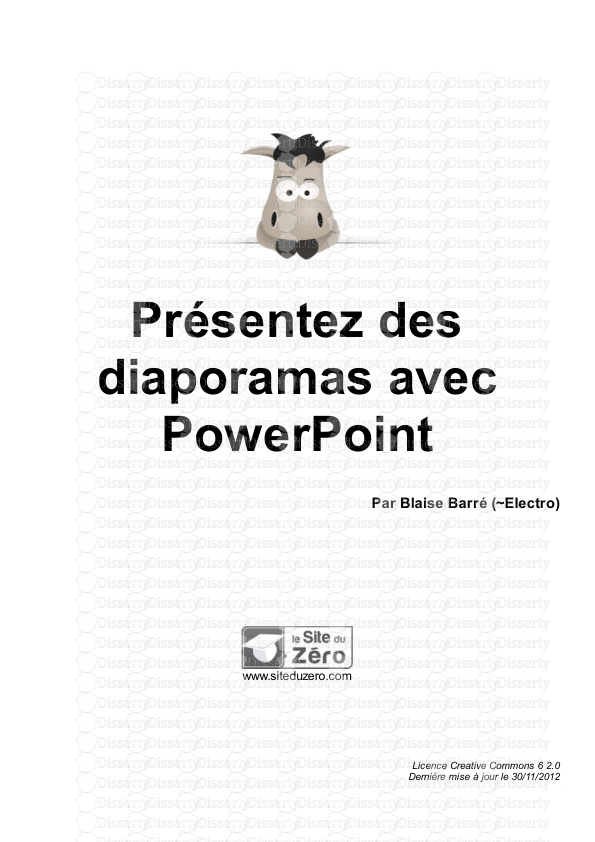
-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 03, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9049MB


