Édition 2018/2019 LE GUIDE PÉDAGOGIQUE 2 4 // D’où viennent les musiques que no
Édition 2018/2019 LE GUIDE PÉDAGOGIQUE 2 4 // D’où viennent les musiques que nous écoutons et que nous entendons autour de nous ? 5 // Une petite histoire du droit d’auteur 6 // Qu’est-ce que la Sacem ? 8 // Qu’est-ce que la musique contemporaine ? 9 // Typologie de la musique contemporaine & grandes figures 11 // Où écoute-t-on la musique contemporaine ? 12 // Comment devient-on compositeur de musique contemporaine? 13 // Boîte à questions 14 // Ressources pédagogiques 3 LA MUSIQUE EST PARTOUT DANS NOS VIES - - - - - - - - 3 Nous l’écoutons sur nos baladeurs numériques, nos téléphones portables, dans nos voitures sur l’autoradio, à la maison sur nos chaînes Hi-Fi, à la télévision, à la radio, sur Internet mais aussi dans les magasins quand nous faisons nos courses, dans les fêtes chez des amis, au spectacle de danse ou de cirque, et bien sûr en concert ou en festival. LE SAVIEZ-VOUS ? À votre avis combien de Français déclarent écouter de la musique ? l 78 % l 99 % l 100 % Réponse : 99 % des Français disent écouter de la musique, dont 86 % chaque jour, pour une durée moyenne journalière de 2h25 (sondage IPSOS MediaTC pour Spré/Sacem, 2014). Combien de Français pratiquent la musique ou le chant en amateur ? l 40 % l 10 % l 20 % Réponse : 20 % des Français disent pratiquer un instrument ou le chant en amateur (ministère de la Culture). 4 Travail pratique : l’originalité Les idées appartiennent à tout le monde. Mais chacun d’entre nous leur donne vie avec sa propre sensibilité. Pour réaliser cela, il suffit de demander aux élèves de faire un dessin ou d’écrire un poème sur un même thème : « la musique » par exemple, ou « la protection de la nature » , ou même un thème très précis. Chaque enfant produira une œuvre qui lui sera personnelle à partir d’un thème commun : c’est cela, l’originalité qui est reconnue et protégée par le droit d’auteur, l’empreinte de sa personnalité... LE SAVIEZ-VOUS ? Le droit d’auteur est un Droit de l’Homme ! Article 27 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. » Le droit d’auteur a deux aspects 1) Le droit moral Reconnaissance de la paternité de l’œuvre, respect de l’intégrité de l’œuvre. Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. De son vivant, seul l’auteur peut exercer son droit moral. 2) Le droit patrimonial Seuls les auteurs peuvent décider d’autoriser l’exploitation de leurs œuvres via leur représentation au public ou leur reproduction (sur un support comme le CD par exemple). En contrepartie de l’utilisation de leur œuvre les auteurs touchent une rémunération. L’auteur peut décider de confier la gestion de ses droits patrimoniaux à une société de gestion collective comme la Sacem. Au départ, comme pour toute création artistique (un livre, une peinture…), la musique est une idée. Le compositeur/la compositrice va transformer cette idée, cette mélodie qui lui trotte dans la tête, en une création concrète, réelle, soit en écrivant des notes sur une portée, soit en composant directement sur un instrument (sur un ordinateur ou sur des instruments traditionnels). L’auteur/e est la personne qui va écrire des paroles pour cette composition musicale, s’il s’agit d’un chant ou d’une chanson. Le compositeur et l’auteur sont des créateurs : ils donnent naissance de manière concrète à ce qui n’était avant qu’une idée, ils lui donnent une forme précise et personnelle, qui reflète leur personnalité. Ils sont les « parents » de l’œuvre musicale et c’est pour cela qu’ils ont des « droits » sur leur création : des droits d’auteur. C’est à partir de leur création qu’un jour, peut-être, nous entendrons cette musique ou chanson à la radio ou jouée en concert. D’OÙ VIENNENT LES MUSIQUES QUE NOUS ÉCOUTONS ET QUE NOUS ENTENDONS AUTOUR DE NOUS ? - - - - - - - - 5 UNE PETITE HISTOIRE DU DROIT D’AUTEUR - - - - - - - - Le droit d’auteur, une création révolutionnaire Avec les lois du 13-19 janvier 1791 et du 19-24 juillet 1793, le créateur est reconnu propriétaire exclusif de son œuvre et a le droit d’en disposer comme il le veut. Fini les mécènes et autres commanditaires qu’il faut satisfaire : les créateurs peuvent travailler librement, puisque leur revenu est lié à leurs droits d’auteur ! Ils sont libres et indépendants : c’est une des conditions pour que la liberté d’expression existe. Ces lois voient le jour grâce à la lutte sans faille d’un auteur de théâtre, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, qui depuis 1777 défendait le droit des auteurs face à la puissance sans contrôle des acteurs de la Comédie Française, qui utilisaient les œuvres des auteurs sans nécessairement les payer ou les payer justement. Forts de la reconnaissance de leurs droits, les quatre hommes vont décider de créer une société dont le rôle sera de représenter les créateurs et d’aller collecter leurs droits partout où leur musique est jouée. C’est l’acte de naissance de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), créée le 28 février 1851. Les créateurs s’organisent Avant le XIXe siècle, les endroits où la musique était jouée étaient peu nombreux : les opéras, quelques théâtres et lieux de concert. La musique était aussi un passe-temps privé : on chantait et jouait du piano ou de l’accordéon dans le cercle familial, à l’occasion des fêtes ou de dîners. Bien sûr, il n’y avait ni radio, ni télévision, ni Internet ! Dans ces conditions, les créateurs de musique pouvaient – seuls ou avec leurs éditeurs - suivre où leurs œuvres étaient jouées et recueillir leurs paiements de droits d’auteur. Cela change au XIXe siècle, moment où les « cafés-concerts » et les « music-halls » se multiplient dans les villes et les banlieues, pour répondre à la demande de loisirs des classes populaires et moyennes en plein développement. Pour les créateurs de musique, c’est très positif : leur musique va être jouée et chantée dans de plus en plus d’endroits, et toucher un public de plus en plus nombreux. Mais c’est aussi très compliqué : comment savoir quels établissements utilisent leurs musiques, et comment se faire payer des droits d’auteur ? C’est alors qu’éclate l’incident du café des Ambassadeurs… En 1847, trois auteurs et compositeurs de musique, Ernest Bourget, Paul Henrion et Victor Parizot, sont attablés au café-concert les Ambassadeurs, situé sur les Champs-Elysées. En partant, ils refusent de payer leurs consommations car le propriétaire du café-concert fait jouer leurs musiques, mais sans leur verser de droits d’auteur. Soutenus par l’éditeur Jules Colombier, les créateurs intentent des procès contre le cafetier, qu’ils gagnent tous. Avant la Révolution française, le créateur dépendait de ses mécènes Jusqu’à la Révolution française, les créateurs vivaient grâce aux soutiens de leurs mécènes, qui étaient des personnes riches (les nobles, les rois, ou bien l’Église) qui pouvaient subventionner leurs œuvres ou leur offrir des emplois. Leurs œuvres ne leur appartenaient pas, mais appartenaient à ceux qui les payaient ; les mécènes. Surtout, les créateurs n’étaient ni libres, ni indépendants. En effet ils devaient éviter de « fâcher » leurs mécènes sous peine de se voir « couper les vivres ». Exemples de mécènes et leurs créateurs : • le roi François 1er amena Léonard de Vinci au Clos Lucé (Amboise) en 1516 ; • Laurent de Médicis soutenait le peintre Botticelli en Italie ; • le Prince-archevêque de Salzbourg Colloredo employait Mozart à Vienne et le noble Nicolas Fouquet offrait une pension à l’écrivain Pierre Corneille... ERNEST BOURGET Auteur PAUL HENRION Compositeur VICTOR PARIZOT Compositeur JULES COLOMBIER Éditeur 6 QU’EST-CE QUE LA SACEM ? - - - - - - - - La coopérative des créateurs : l’union fait la force La Sacem fonctionne sur le même principe qu’une coopérative agricole. Les agriculteurs se réunissent dans une coopérative pour mettre en commun leurs récoltes et avoir un meilleur pouvoir de négociation avec les magasins. Quant aux créateurs, ils se rassemblent au sein de la Sacem pour cumuler leurs répertoires et avoir un meilleur pouvoir de négociation avec les utilisateurs de leur musique. Individuellement, en effet, même le plus connu des créateurs ne peut pas négocier seul... quand il s’agit de négocier ses droits avec des utilisateurs nombreux (tous les lieux publics utilisant de la musique) et/ou puissants (médias, sites Internet...). Le travail de la Sacem La mission de la Sacem est de représenter ses membres. Quand quelqu’un veut utiliser de la musique dans un cadre public, la Sacem lui donne l’autorisation en échange du paiement des droits pour les auteurs. Ensuite, la Sacem redistribue les droits aux créateurs (et éditeurs) dont les œuvres ont été utilisées et diffusées. LE SAVIEZ-VOUS ? On paye des droits d’auteur uniquement quand les uploads/s3/ guide-musique-contemporaine-dec2018.pdf
Documents similaires

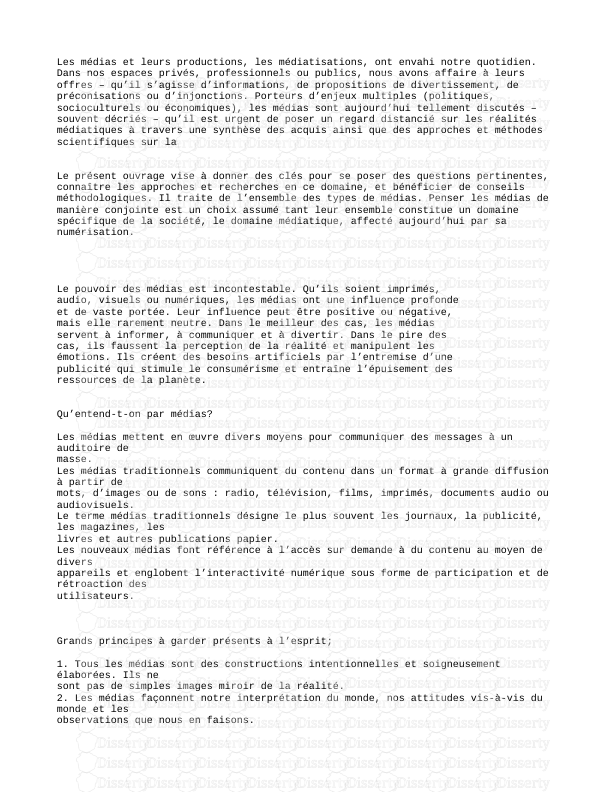








-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 21, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.5939MB


