International Musicological Society is collaborating with JSTOR to digitize, pr
International Musicological Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Acta Musicologica. http://www.jstor.org « Plain-chant dégeneré » et fleuretis : quelle musique pour quelle prière? Author(s): Jean-Paul C. Montagnier Source: Acta Musicologica, [Vol.] 83, [Fasc.] 2 (2011), pp. 223-243 Published by: International Musicological Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23343868 Accessed: 10-01-2016 08:40 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. This content downloaded from 132.216.238.85 on Sun, 10 Jan 2016 08:40:15 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions « Plain-chant dégénéré » etßeuretis : quelle musique pour quelle prière ? ]ean-Paul C. Montagnier Université de Nancy, UMR 200 du CNRS, McÇiii University Destinée par son institution à instruire le peuple, à le porter à Dieu ; à chanter les louanges du Seigneur, à publier ses bienfaits ; elle [« la musique d'Eglise »] doit remplir ces obligations de la manière la plus convenable, c'est à dire 1° qu'elle doit aider a l'intelligence des paroles, bien loin de l'offusquer par des sons bizarres et des bruits confus, qui empechent d'en pénétrer le sens et d'en tirer des instructions ; 2° qu'elle doit mettre de la noblesse et de la dignité dans tout ce qu'elle offre, et rejeter les ornemens superflus d'une musique mondaine et profane1. Ayant procédé à de très nombreux dépouillements de sources anciennes et modernes pour rédiger sa monumentale Histoire de la musique (ca 1754)2, l'érudit Dom Philippe-)oseph Caffiaux ne fait ici que restituer une opinion partagée par tous les auteurs, et opinion d'après laquelle la qualité de la musique chantée dans le sanctuaire est l'unique vecteur de la bonne compréhension et bonne réception spirituelle du texte sacré. Ce dernier demeure en effet premier. Ainsi le Mauriste insiste-t-il sur l'idée que « Toute musique et meme toute espece de chant, doit etre une sorte de declamation, de discours suivi, dans lequel on doit faire sentir tous les membres des périodes, avec leurs incisum en y menageant adroitement les repos, dans lequel chaque expression doit avoir sa quantité et son ton convenable ; dans lequel on doit s'attacher scrupuleusement aux lois de la grammaire, de la syntaxe, de la belle elocution »3. Voilà un pieux souhait que l'auteur sait difficile à satisfaire ! Déjà à l'orée du siècle, ]ean-Laurent Lecerf de La Viéville avait montré dans son « Discours sur la musique d'Eglise » que celle-ci consistait à « faire parler quelqu'un en chant »4 et que cette tâche était ardue et semée d'embûches, 1. Dom Philippe-]oseph Cafflaux, « Dissertation 7"™ sur le chant et sur la musique de l'Église », in Histoire de la musique, F-Pn ms. fr. 22.536, f* 242v-243r. 2. Cf. Philippe Vendrix, Aux origines d'une discipline historique. La musique et son histoire en France aux XVIIe et XVIIF siècles (Liège : Bibliothèque de ta Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, 1993), p. 104 et p. 142. 3. Cafpaux, op. cit., f* 243V. Cf. encore particulièrement f" 242r (« Il n'est pas encore vrai que les mu siciens soient en droit de négliger les regies de la grammaire en chantant : tous les arts et toutes les sciences doivent se soutenir et s'entr'aider mutuellement ») et f* 242V (le plain-chant a pour but de rendre attentif « au sens des paroles que l'on recite »). 4. ]ean-Laurent Lecerf de la Viéville de Fresneuse, « Discours sur la musique d'Église », in Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise (Bruxelles : François Foppens, 1705-1706 ; reprint Çenève : Éditions Minkoff, 1972), 3'™ partie, p. 38. Acta Musiœlogica, LXXXIII/2 (2011), p. 223-243. This content downloaded from 132.216.238.85 on Sun, 10 Jan 2016 08:40:15 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions ]ean-Paul C. Montagnier - « Plain-chant dégénéré » et fleuretis : quelle musique pour quelle prière ? même pour des compositeurs aussi doués qu'André Campra ou Nicolas Bernier, pourtant impliqués dans la vie ecclésiastique depuis leur plus jeune âge. De fait, si une musique figurée écrite peut se heurter à de tels écueils, qu'en advient-il d'une musique polyphonique improvisée dans l'instant même de l'action liturgique ? Cette musique réussit-elle malgré son caractère extemporané à véhiculer convenablement les paroles chantées et parvient-elle à toucher l'âme et le cœur du croyant qui l'écoute et du chantre qui la réalise ? Cette musique en somme peut-elle prétendre au statut de prière ? Afin de répondre à ces questions, nous allons interroger les rares sources françaises que le XVIIIe siècle nous a laissé, sans perdre de vue qu'il est bien impossible d'avoir une exacte idée de cette musique improvisée, en raison même de sa nature éphémère. Le rapport texte-musique dans la pratique du fleuretis On sait depuis longtemps que les premiers exemples de polyphonie conservés reflètent une pratique orale improvisée au chœur qui venait rehausser les cérémonies religieuses. Cette pratique médiévale du déchant ex tempore, théorisée très tôt dans des traités comme la Musica enchiriadis et surtout le Scientia artis musicœ (1274) d'Élias Salomon et le célèbre « Quiconque veut deschanter » en provenance de l'ancienne bib liothèque de Saint-Victor5, perdura tout au long de l'Ancien Régime pour ne disparaître totalement que dans le cours du XIXe siècle, faisant du cantare super librum une spécificité française toujours bien vivante à l'heure où elle avait pratiquement disparu ailleurs6. Comme nous avons eu l'occasion de le montrer dans divers travaux7, cette pratique improvisée ne laissa guère de traces en France. A compter de la fin du XVIIe siècle toutefois, de plus en plus de traités virent le jour comme si leurs auteurs se sen tirent dans l'obligation de la fixer sur le papier, apparemment afin de pallier l'ignorance grandissante des maîtres de musique en la matière. De fait, la notion même de chant 5. Cf. F-Pn ms. lat. 15.139, f. 269V-270V. Ce traité est disponible dans Théodore Çérold, La Musique au Moyen Age (Paris : Éditions Honoré Champion, 1932, rééd. 1983), p. 424-426. 6. Pour un état européen de la question, nous renvoyons à Çiulio Cattin et F. Alberto Çallo (éd.). Un Millennio dipolifonia liturgica tra oralitù e scrittura (Venise : Società editrice il Mulino, 2002; Quaderni di « Musica e Storia » 3). 7. Cf. nos articles suivants : « Le Chant sur le Livre au XVIIIe siècle : les Traités de Louis-Joseph Marchand et Henry Madin », Revue de musicologie 81/1 (1995), p. 37-63 ; « Les sources manuscrites françaises du Chant sur le livre aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue Belge de musicologie 49 (1995), p. 79-100 ; « Le Chant sur le Livre en France d'après un traité anonyme du XVIIIe siècle », Recherches sur la musique française classique 29 (1996-1998), p. 67-76 ; « Le Chant sur le Livre en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : de la survivance d'une tradition orale ancienne à l'avènement d'un genre écrit », in Un Millennio di polifonia liturgica tra oralitù e scrittura, op. cit., p. 257-289 ; « Le Chant sur le livre », in Louis-Joseph Marchand, Henry Madin, Traités du contrepoint simple. Textes présentés par Jean-Paul C. Montagnier (Paris : Société française de musicologie, 2004), p. 5-31. Cf. encore notre ouvrage Henry Madin (1698-1748). Un musicien lorrain au service de Louis XV (Langres : Éditions Dominique Cjuéniot, 2008), p. 85-98. 224 This content downloaded from 132.216.238.85 on Sun, 10 Jan 2016 08:40:15 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions ]ean-Paul C. Montagnier - « Plain-chant dégénéré » et fleuretis : quelle musique pour quelle prière ? sur le livre ne paraît pas avoir été très connue du grand public puisqu'en novembre 1728, à l'issue d'« une dispute qui s'est élevée en Province sur une maniéré de chanter, usitée dans les Eglises Cathedrales, qu'on appelle le Chant sur le Livre », le journaliste du Mercure de France s'interrogea sur la valeur de cette pratique8. Afin de lui répondre, l'infatigable Jean Lebeuf rédigea une longue dissertation à caractère historique dans laquelle il définit le supra librum cantare : Le Chant sur le Livre est un Chant qui accompagne la Note du Livre de Plain-Chant, mais qui l'accompagne avec ornement, avec fleurs & figures de Musique. Bien plus, il faut que chaque Chantre qui execute ce Chant, le tire de son propre fond, suivant les regies des accords ou consonances harmoniques. C'est autant qu'il en faut pour conclure avec certitude que le Chant sur le Livre est une veritable espece de Musique. On peut même dire hardiment que c'est l'espece la plus difficile à apprendre & l'une des plus scientifiques. Il est vrai qu'il y a une partie, qui, à la rigueur, peut porter le nom de Plain-Chant ; c'est la partie la plus basse, la partie uploads/s3/ plain-chant-degenere-et-fleuretis-quell.pdf
Documents similaires


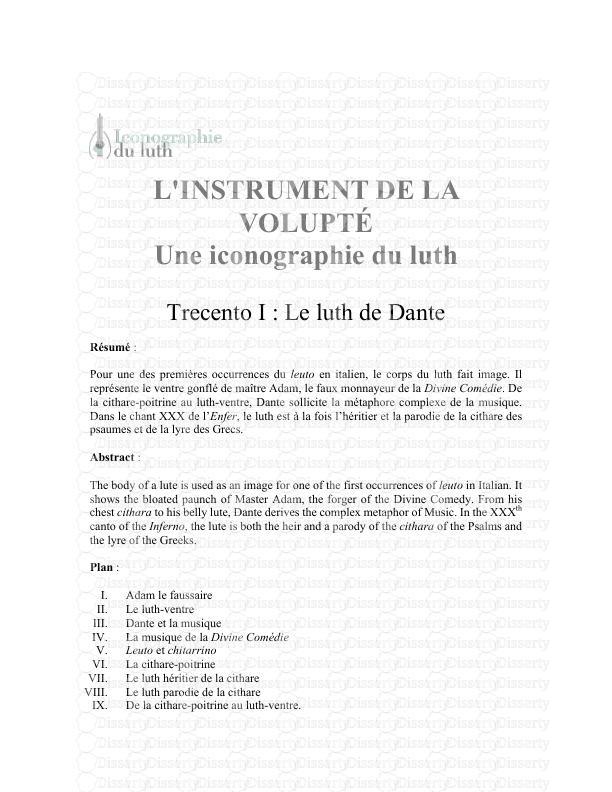







-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 10, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 3.9819MB


