1 Que reste-t-il du cinéma ? par Jacques Aumont E n 1971, Jean Eustache réalise
1 Que reste-t-il du cinéma ? par Jacques Aumont E n 1971, Jean Eustache réalise Numéro zéro. C’est l’enregistrement brut d’une conversation entre sa grand-mère, Odette, et lui – ou plutôt, d’un long mono‑ logue de la grand-mère devant le petit-fils. Dix bobines de film, tournées à deux caméras et montées en alternance, afin de ne pas interrompre le flux de la parole. Les cent dix minutes du film sont l’empreinte exacte de cent dix minutes de temps passé, y compris les accidents, par exemple un téléphone qui sonne, ou les claps ponctuant les changements de bobine. Ce film, produit par le Service de la Recherche de la télévision française, est resté longtemps ignoré, jusqu’à sa redécouverte en 2003, plus de vingt ans après la mort du cinéaste 1. Le titre renvoie à la « copie zéro » qui est le premier état du montage, mais le fait que le film soit si peu monté suggère aussi ce degré zéro du cinéma dont Bazin disait qu’il « embaume le temps ». Un temps concret, pas la pure expérience de la durée sans contenu vécu de l’Empire de Warhol (1963), pas le temps dramatisé des plans-séquences de Welles ou Wyler autour de 1950. Presque au même moment, Jean-Luc Godard commençait une longue série de travaux en vidéo, avec toutes les générations successives de matériel. Trente ans plus tard exactement, en 2001, il réalise Éloge de l’amour, une œuvre hybride, mêlant des scènes en noir et blanc et en 35 mm, et d’autres avec des couleurs au contraire extrêmement saturées, tournées en vidéo et reportées sur film pour la projection. Éloge de l’amour est un éloge, peut-être paradoxal, du cinéma, car seule la projection en salle, sur un grand écran et à partir d’une copie sur pellicule, permet de constater l’abîme visuel entre le 35 mm noir et blanc et la vidéo, avec ses couleurs archifausses. Dix ans encore ont passé depuis ce film, et désormais la vidéo règne, sous les espèces de ce qu’on appelle le numérique. Au congrès de la Fédération internationale des archives du film (FIAF), en 2006, une projection fut organisée, où l’on compara la technique pelliculaire à la technique numérique : dès cette date, il fut clair pour tous – non sans quelques frémissements d’horreur ou de mélancolie chez les plus âgés – 1. Il en existe une version de 54 minutes pour la télévision, intitulée Odette Robert. Aumont.indd 1 21/05/11 14:53:58 2 que la projection numérique à haute résolution était de qualité égale à celle de la pellicule. Ce public, composé de professionnels de la préservation des films, fut parfois même, dit-on, incapable de distinguer l’une de l’autre. * Je pourrais continuer, car depuis quarante ans que les premières machines vidéo à bandes ont fait leur apparition, le cinéma ne cesse de tracer ses frontières et de les défendre, parfois de manière étrangement passéiste, comme dans la cérémonie quasi funéraire de « The Last Nitrate Picture Show ». Mais aujourd’hui, celui qui veut avoir une certitude sur ce qu’on lui projette n’a guère qu’une solution : il lui faut guetter, sur l’écran, la trace d’une poussière ou d’une tache sur la pellicule, que la projection numérique a rendues impossibles. L’amoureux de la pellicule en vient à aimer jusqu’à ses défauts (en bon fétichiste). Quant à la production de films, elle reste provisoire‑ ment partagée entre des enregistrements sur pellicule, de plus en plus rares, et les gros bataillons de l’enregistrement numérique. Se demander « ce qui reste » du cinéma, c’est aussi se demander ce qui a disparu. Le cinéma, lui, n’a pas disparu. On continue d’« aller au cinéma », c’est-à-dire de voir des œuvres d’image mouvante, la plupart du temps narratives, dans des salles spécia‑ lisées, en payant son billet. L’industrie du cinéma existe toujours, elle produit autant de films qu’il y a cinquante ans, et même, avec la diffusion de copies des films sur dvd puis en vod, elle a trouvé de nouveaux débouchés ; au passage, la culture ciné‑ matographique est devenue une partie banale de la culture tout court. Pourtant, les choses ont changé, dans deux domaines au moins. D’abord, le cinéma n’a plus l’exclusivité des images en mouvement. Déjà la télévision l’avait concurrencé sur ce terrain – mais avec elle un modus vivendi était facile à trouver. En s’appropriant la fiction, la tv au fond a consacré la victoire du modèle cinémato‑ graphique, car les feuilletons et séries télévisées sont le dernier avatar du cinéma classique. Au reste, depuis dix ans, la télévision est devenue dans les pays riches un médium du passé, et le site le plus copieux de diffusion d’images en mouvement, c’est désormais le web – source continue, indéfinie, illimitée, et qui, elle, ne peut pas copier le cinéma. Sur l’autre bord, celui de la culture intello, il faut maintenant compter avec le musée d’art contemporain. Depuis que les artistes plasticiens ont inventé l’art vidéo à la fin des années 1960, l’image mouvante est devenue une possibilité parmi d’autres, de plus en plus utilisée, entre autres dans des installations. D’autre part, la diffusion, devenue hégémonie, de l’image numérique a engagé un gigantesque retour du cinéma – dans sa définition sociale majoritaire – dans la « voie Méliès », celle du trucage, de la maîtrise, du dessin. Cela est évident des films pour « adulescents » réalisés en images de synthèse, mais c’est aussi le cas, désormais, de n’importe quel film : l’enregistrement numérique n’est pas une empreinte intouchable, mais un codage, sur lequel il est loisible d’intervenir autant qu’on veut et comme on veut. Pour les très jeunes gens, qui n’ont guère connu l’époque « argentique », c’est Aumont.indd 2 21/05/11 14:53:58 3 avant tout une libération : enfin, le cinéaste peut bénéficier du droit au repentir et à la retouche, jusque-là réservés au peintre. Mais le prix à payer est, symboliquement et esthétiquement, assez lourd : il s’agit de rien de moins que de renoncer à une ontologie, celle de l’empreinte, donc de la rencontre et de la révélation du réel. Que reste-t-il du cinéma ? la question est donc double. C’est d’abord une question de vécu : que reste-t-il de l’expérience de la vision esseulée d’une grande image mouvante dans le noir, s’imposant à nous sans que nous puissions agir sur elle ? voir un film sur un petit écran mobile, est-ce voir du cinéma ? dans l’exposition de films au musée d’art contemporain, ce qu’on voit est-il du cinéma ? Et puis, c’est une question d’ontologie : que reste-t-il de la relation d’immédiateté, fût-elle fantasmée, qui unissait le film au réel ? peut-on croire que certaines formes prises par les images mouvantes pourront encore être dites « filmiques » ? les « nouvelles images » et les nouvelles techniques d’image laissent-elles une place à ce qui a fait le prix, esthétique et idéel, du cinéma : le respect de la réalité ? * L’évolution des techniques et des dispositifs est indiscutable. Cependant, sur ce terrain, on a trop raisonné à partir d’un a priori hégélien, qui veut qu’un dispositif ne puisse appartenir qu’à une époque, et doive obligatoirement être dépassé par une autre époque qui ne peut plus s’y reconnaître. C’est ce qui me retient d’adhérer à l’idée, éloquemment proposée depuis une dizaine d’années, que le cinéma aujour‑ d’hui ne se trouve plus seulement dans les salles de cinéma, mais un peu partout, notamment au musée d’art contemporain 1. On a connu cela avec la peinture : en juin 1989, au colloque « Cinéma et peinture » du Louvre, Christian Boltanski déclarait, en se frappant comiquement le crâne : « Si je dis que c’est de la peinture, ce sera de la peinture ! » Hélas, ce n’en est toujours pas : peindre, c’est peindre. Idem, à mes yeux, pour le cinéma : ce qu’on voit au musée, en général, non, ce n’en est pas. Une intéressante variante de cette nouvelle vulgate s’efforce d’identifier la situation présente avec celle d’il y a un peu plus d’un siècle, lorsque le cinéma a dû se dégager du cinématographe ou du kinétoscope et inventer à la fois son dispositif propre et son langage. Dans un article récent, Tom Gunning nous rappelle que, autour de 1900, les « films » étaient surtout destinés à la démonstration et à la promotion d’appareils, de techniques et de dispositifs 2. Cela devrait nous dire quelque chose : les productions 1. Représentatifs de cette nouvelle vulgate, qui se répand à la vitesse de l’éclair dans l’université, les travaux du groupe agrégé autour des « Spring schools » et « Summer schools » animées par les infatigables Philippe Dubois et Leonardo Quaresima. Voir Ph. Dubois et al., Oui, c’est du cinéma / Yes, it’s cinema (2009) et Extended cinema. Le cinéma gagne du terrain (2010), tous deux chez Campanotto editore, à Pasian di Prato ; voir aussi plusieurs numéros de la revue Cinema & Cie, notamment le n° 11 (« Relocation », dirigé par Francesco Casetti) et le n° 12 (« Cinéma et uploads/s3/ que-reste-t-il-du-cinema.pdf
Documents similaires

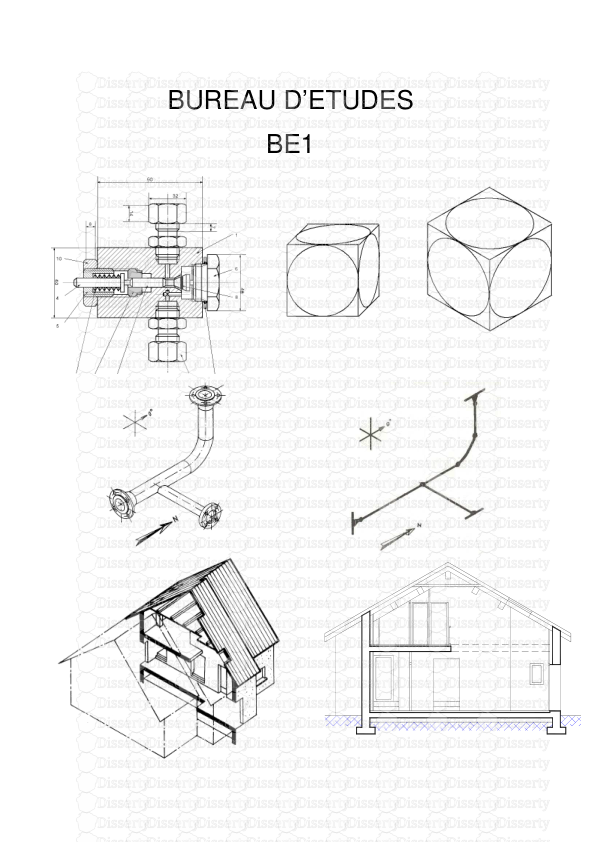



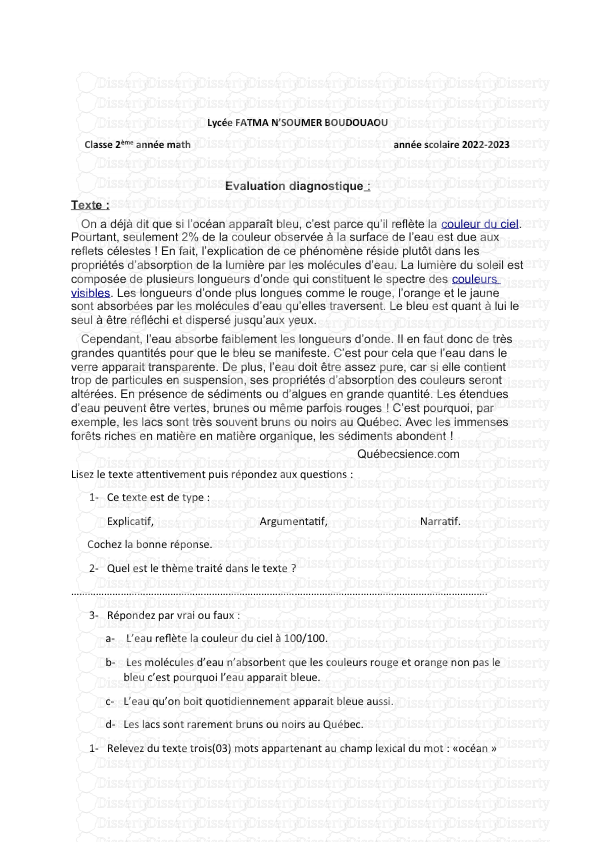




-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 05, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5572MB


