LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE Bibliographie : Jean WALINE, Droit administrat
LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE Bibliographie : Jean WALINE, Droit administratif, Dalloz 22ème éd., 2008 Jean WALINE, L’évolution de la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques, EDCE 1994 p. 459 - Conseil d’Etat, Responsabilité et socialisation du risque, Rapport public 2005. I. On vous a dit, pour caractériser ce droit spécial qu’est le droit administratif, qu’il était le droit spécial applicable à la puissance publique ou comportant des prérogatives de puissance publique. Cette affirmation est largement exacte : le droit administratif demeure « un droit martial ». La formule des prérogatives de puissance publique et des privilèges de l’administration ne donne toutefois pas une exacte représentation de la réalité car, comme l’a montré Jean Rivero, le droit administratif n’est pas seulement un droit de prérogatives – d’ailleurs assujetti à une finalité, la poursuite de l’intérêt général -, c’est aussi un droit de sujétions. On voit donc qu’en réalité, le droit administratif est en définitive, un ensemble indivisible de prérogatives et de sujétions qui sont souvent étroitement liées les unes aux autres. Pour s’en tenir aux sujétions, elles peuvent être rassemblées sous deux grandes rubriques : - Le principe de légalité, c’est-à-dire la soumission de l’administration à la loi ; - Le principe de responsabilité, c’est-à-dire la règle selon laquelle lorsqu’elle cause un dommage, notamment par sa faute, l’administration est tenue de le réparer. 1 II. Les principaux caractères de la responsabilité administrative à l’époque contemporaine. Il conviendra, tout au long des développements qui vont suivre, de fixer l’attention sur trois d’entre eux particulièrement : - D’abord, son caractère jurisprudentiel qui appellera à faire le point sur ses sources pour relever que même si à l’instar du droit administratif dans son ensemble, le droit de la responsabilité des personnes publiques est largement jurisprudentiel, les régimes législatifs de responsabilité ont tendance à se multiplier. On ne pourra les étudier tous. Mais il est évident que l’inspiration générale des régimes qu’ils mettent en place n’est pas sans effet sur l’évolution du régime de la responsabilité administrative en général dans le sens de la socialisation du risque. En effet, le législateur a multiplié les cas dans lesquels la victime peut prétendre à l’indemnisation d’un dommage sans avoir à identifier l’auteur de celui-ci ou à prouver l’existence de sa faute, n’ayant pour seule contrainte que celle d’établir se trouver dans la situation prévue par la loi (loi du 6 juillet 1990 sur les victimes d’actes de terrorisme ; loi du 23 décembre 2000 sur les victimes de l’amiante …). - Son autonomie, ensuite On sera amené à voir que lorsque le Tribunal des Conflits a reconnu le principe de la responsabilité des personnes publiques dans le célèbre arrêt BLANCO du 8 février 1873, il l’a fait en des termes qui devaient conférer au régime de cette responsabilité une véritable autonomie : "Cons. que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; 2 que, dès lors, ... l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître". On sera amené par conséquent à s’interroger sur la justification de cette autonomie par rapport au droit civil et sur sa réalité. Sur cette question : Denis de Bechyllon, Le Conseil d’Etat, le code civil et le droit de la responsabilité, RJEP 2005, p. 90. Enfin, dans le prolongement du constat de l’autonomie de la responsabilité administrative, il faudra plus largement s’interroger sur son fondement ou encore son économie générale pour porter une appréciation sur son caractère satisfaisant (ou non) ou, si vous préférez le vocabulaire à la mode, sur son « libéralisme ». On peut dire à cet égard qu’au-delà des considérations purement techniques, il y a sans doute une réelle spécificité de la responsabilité administrative quant aux équilibres qu’elle réalise entre les considérations qui lui sont propres. Peut être même, au-delà, subsiste-t-il une véritable différence avec le régime général de la responsabilité des personnes privées quant à son fondement (son esprit), Cela n’exclue évidemment pas une certaine convergence de fond des deux systèmes. Mais il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt et que l’attention prêtée dans les deux cas à la victime fasse perdre de vue que la mise en jeu de la responsabilité de l’administration demeure relativement restrictive. 1ère proposition : On doit constater une convergence des règles de fond des deux systèmes Cela n’a rien d’étonnant. - D’abord, dans des domaines d’action similaires, les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent se permettre d’aboutir à des solutions par trop différentes (ex : responsabilité des CRTS en matière de SIDA post transfusionnel : si le CRTS est organisé sous forme d’association gérant un service public, mais sans mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence appartient au juge judicaire ; si le CRTS a la qualité d’établissement public, le juge administratif est seul compétent. Conséquence : le juge administratif et le juge judiciaire ont fait application de règles d’engagement de la responsabilité tout à fait similaires. 3 - Ensuite, et surtout peut être, la convergence est induite par le fait que les deux systèmes de responsabilité s’inscrivent dans un cheminement des idées et un contexte sociologique qui leur sont communs. Pendant longtemps, le but principal d’un régime de responsabilité a été de sanctionner l’auteur du dommage. On peut dire que la responsabilité avait une fonction punitive. L’indemnisation de la victime constituait « l’occasion » de sanctionner l’auteur d’un trouble à l’ordre social. Mais, par la suite, l’accent s’est progressivement mais constamment déplacé vers la victime et le souci de son indemnisation au point que la responsabilité a remplit désormais une certaine fonction « assurantielle ». On peut ainsi observer que le régime de l’engagement obéit à une conception socialisée des risques dans laquelle on considère que certains dommages doivent être réparés en toutes circonstances, alors même que leurs auteurs n’ont pas nécessairement commis de faute, ne sont pas « coupables » : phénomène que l’on qualifie parfois de « victimisation » du régime de la responsabilité (« responsable mais pas coupable »). Du point de vue de ces évolutions, les deux régimes de responsabilité ont cheminé de conserve : d’un droit administratif de la responsabilité destiné au départ à éviter que l’action de l’administration ne soit entravée ou paralysée et visant donc à lui laisser une large marge de manœuvre en évitant des indemnisations trop systématiques, on est, au moins partiellement, passé à un système qui tend à indemniser de mieux en mieux les victimes, ce qui rejoint les évolutions de la jurisprudence judiciaire. On peut même se demander si le fondement « moral » de la responsabilité, en particulier de la responsabilité administrative, n’est pas en train de glisser vers le respect de l’égalité : tout dommage doit être indemnisé parce qu’il réalise une rupture dans l’égalité qui régit les rapports entre les hommes, ce qui aboutirait à une sorte de « garantie sociale généralisée ». En tout cas, les victimes y poussent : par ex. CAA DOUAI, 18 janvier 2008, Mme H. et Autres, n° 06DA011012 : la CAA était saisie d’un litige à l’initiative de trois mères de famille ayant donné naissance à des enfants atteints du syndrome d’alcoolisation fœtale. Elle s’est prononcée en faveur d’un rejet de la responsabilité de l’Etat en vue de la réparation d’un préjudice moral. L’Etat n’est pas responsable d’un manquement d’informations concernant les risques liés au syndrome d’alcoolisation fœtale. Dans la même affaire, le TA de Lille avait été saisi d’une action contre l’Etat par des mères qui entendait le voir déclaré responsable de syndromes d’alcoolisation fœtale dont leurs fils étaient atteints. 4 La faute aurait consisté pour l’Etat dans le fait de ne pas les avoir suffisamment informées du danger de la consommation d’alcool sur la grossesse et de n’avoir pas dispensé aux médecins la formation nécessaire pour leur permettre d’informer les femmes enceintes du danger d’une consommation d’alcool, ni imposé aux producteurs l’apposition d’une mention sur chaque bouteille mentionnant le danger de la consommation d’alcool pour le fœtus. Le TA a néanmoins rejeté ces actions en se fondant sur le fait que les requérantes n’établissaient pas un lien de causalité directe entre la faute imputée à l’Etat, à la supposer établie, et le préjudice dont elles se prévalaient (TA Lille, 23 mai 2006, Mme Sandrine M…, AJDA 4 sept. 2006, p. 1569, note F. Lemaire). Cette évolution – à laquelle la jurisprudence administrative n’a bien évidemment pas échappée - rend d’ailleurs plus poreuse la frontière entre ce qui relève de la responsabilité qui peut être engagée devant le juge et ce qui relève de la solidarité qui est largement tributaire de l’intervention du législateur Elle ainsi donne lieu à un « dialogue » entre uploads/S4/ cours-responsabilite-administrative.pdf
Documents similaires





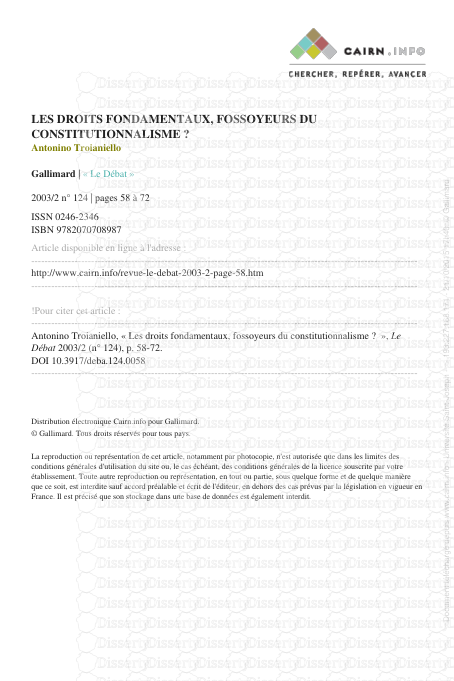




-
118
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.0146MB


