INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ou LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT L’ESSENTI
INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ou LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT L’ESSENTIEL Attention cet « ESSENTIEL » est conçu à partir du plan de votre cours magistral. Il suit la progression du cours magistral – Il obéit donc à sa structure c’est- à-dire à son plan C’est un abrégé : - il rappelle les notions fondamentales à retenir - il résume les idées principale, sans reprendre tous les exemples - Il peut récapituler dans un inventaire les exemples et illustrations évoquées en cours, voire en TD Il peut aussi rappeler et renvoyer à des éléments approfondis en travaux dirigés, Il peut utiliser de nouveaux exemples ; Identifier des passerelles vers d’autres cours (d’autres matières) pour de plus amples développements Il sera diffusé par feuillet au rythme de sa rédaction, et du déroulement de l’enseignement… Les services que peut vous rendre cet essentiel 1/ Lu avant le cours magistral, il vous facilite la compréhension en direct de ce cours magistral, il vous encourage à une prise de notes sélectives et analytiques 2/Après le cours magistral, c’est un support fiable qui permet de combler les lacunes de votre prise de notes, lever les ambiguïtés éventuellement corriger vos erreurs ou maladresse de prise de notes 3/ Faciliter l’apprentissage des connaissances : tout ce qui est dans l’essentiel doit être su pour les séances de travaux dirigés, pour espérer réussir l’examen C’est un socle minimum de connaissances essentielles – C’est donc le point de départ de votre apprentissage et certainement pas le point d’arrivé : à la fin du semestre votre culture juridique doit être BEAUCOUP PLUS ETEUNDUE QUE LE CONTENU DE CET ESSENTIEL ! 4/ Au moment des révisions, il peut vous servir de synthèse rétrospective des points vus en cours et en TD Feuillet n° 1 L’introduction du COURS Identification de l’objectif de l’introduction : Dire ce qu’est le DROIT Soit : DEFINIR - qui ou quoi : le DROIT – pourquoi : parce que c’est l’objet d’étude Comment : pour tenter d’y parvenir le choix de la Méthode – I- Avancer avec méthode Point de départ : les perceptions du droit 1°) Qu’est le droit pour vous aujourd’hui ? - Tout d’abord comment voit-on le droit ? Inventaire : des images ; des symboles ; des œuvres d’art ; des discours qui marquent la présence du droit – En L2 S3 une option : droit et littérature - Ensuite comment vit-on le droit ? - Peur du gendarme et recours au juge… mais pas seulement - l’impôt, le permis de conduire, les contrats etc… Point d’arrivée : la perception du droit pour les juristes 2°) Que sera le droit pour vous demain ? A) Les idées reçues : dont il faut se méfier et se libérer * Le droit ne se confond pas avec le procès. // Différencier le droit et la justice ; le droit et le contentieux o Le droit ne rime pas nécessairement avec sanction. o Le droit ne se résume pas à la loi : le droit existe en dehors de la loi. Le droit ne se confond pas avec la loi. Schématiquement le droit passe plutôt par 3 états : Il est d’abord règle ou norme. (Première approche de la notion d’ordre juridique) Il est ensuite fait de l’homme, c’est à dire attitude de l’homme face à la règle. ( première approche des fonctions de la règle de droit - dont son effet prophylactique - Il est enfin le cas échéant, office du juge. o Le Droit n’est pas UN : 3 remarques a. Le droit se subdivise en plusieurs branches La notion de branche du droit / Les subdivisions du droit/ attention les frontières ne sont pas imperméables / Articulation : Droit commun vs droit spécial - Hybridité ex du droit pénal – mouvement de spécialisation du droit b. Le droit varie selon les pays et les cultures : Le droit n’a pas vocation à l’universalité. Référence philosophique : Montesquieu Esprit des lois et théorie des climats - Les grandes familles de Droit : les systèmes dits de « common law » Vs/ systèmes dits de « droit continental » ou de « droit civil » La concurrence des droits : le droit comme enjeu économique – le droit comme enjeu culturel et social – Deux phénomènes : le phénomène de mondialisation du droit – le phénomène d’européanisation du droit – Des perspectives : l’harmonisation des droits – l’uniformisation du droit Le droit n’est pas partout. Même l’inflation législative ne doit pas conduire à la conclusion que le droit est omniprésent. C’est l’hypothèse développée par J. Carbonnier du « non droit », flexible droit II – Tenter la définition : Des références : G. Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues « le droit on ne sait pas ce que c’est … » R von Jhering, grand juriste allemand de la fin du XIXème siècle « le droit doit être tel qu’il est »…. Vaste programme. * Multiplicité et relativité des définitions du droit La définition du droit dépend de l’approche qu’on en a. Pour la sociologie, le droit c’est la forme la plus organisée du contrôle social. Pour la morale, le droit, « c’est la réalisation du bien et du juste ». Telle était d’ailleurs l’approche que retenaient les romains pour qui le droit était l’art du juste et du bon. Il existe tout un éventail de définition du droit : système de communication et d’échange, modèle de conduite construit par le pouvoir, procédure pour maintenir la paix entre les hommes, l’antidote du péché…. Et le droit c’est aussi la traduction d’un projet politique. Il vise à promouvoir et à mettre en œuvre une conception de la société et des relations qui s’y établissent. • pour le juriste : même pour le juriste s’il est aussi difficile de cerner la notion de droit, c’est qu’en vérité le mot droit désigne plusieurs réalités juridiques on pourrait en retenir deux définitions distinctes mais complémentaires : Deux approches deux notions : Le Droit objectif (Ensemble de règles) Les droits subjectifs (des prérogatives) Oriente la construction du Cours - Plan Première partie : L’étude du DROIT OBJECTIF (appréhender la norme juridique) Seconde partie : Approche des droits subjectifs (à travers quelques notions fondamentales du droit privé) Feuillet n° 2 LES TRAITS COMMUNS DE LA NORME JURIDIQUE ou REGLE DE DROIT Situé ce feuillet dans le plan de cours Première partie : LE DROIT OBJECTIF Titre I / Elaboration de la règle de droit Chapitre premier : LES TRAITS COMMUNS (question commune et caractères généraux) Section 1 : la question des fondements du droit Renvoie : La question des fondements du droit, de la justification du droit relève plus précisément de l’étude de la philosophie du droit. Schématiquement : sont distingués deux grands courants de pensées selon que l’on recherche le fondement du droit dans l’aspiration d’un idéal ou dans la constatation d’une réalité. L’idéalisme s’oppose au positivisme. §1 - Présentation des courants de pensées A- La philosophie idéaliste : Pour les tenants de cette thèse le droit ne saurait se limiter au droit en vigueur à un moment donné dans un Etat donné. Ils affirment l’existence au sein de l’ordre juridique d’un droit supérieur, qu’ils appellent droit naturel. Notion de droit naturel : Il s’agit là de lois immuables et universelles que personne n’a établies et qu’aucun législateur ne pourrait abolir. Références : C’est sans doute dans l’Antigone de Sophocle que les doctrines du droit naturel ont acquis leur titre de noblesse. Parmi les auteurs qui ont affirmé l’existence du droit naturel se côtoient et se relaient philosophes grecs (Platon, Aristote), jurisconsultes romains (Ulpien, Paul), théologiens catholiques (Saint Thomas), les membres de l’école « du droit naturel et des gens » aux XVIe et XVIIe (Grotius, Pufendorf), les philosophes du XVIIIe (Voltaire, Montesquieu), les hommes de la Révolution françaises, le catholicisme social et le socialisme humaniste au XXe. Mais si tous affirment leur attachement au droit naturel, des dissensions apparaissent s’agissant tant de l’inspiration fondamentale du droit naturel que de son contenu. a/L’inspiration fondamentale du droit naturel discuté : Il existe en effet deux conceptions du droit naturel : - une conception chrétienne avec notamment Saint Thomas d’Aquin : le droit naturel (lex naturalis) ne se confond pas avec la loi divine (lex divina). La loi naturelle se situe entre la loi éternelle et la loi positive. La loi naturelle est un pont entre la loi divine et la loi humaine - Une conception laïque, qui fait l’économie de l’intervention divine et affirme que le droit naturel est un droit rationnel connaissable par la raison, un droit auquel la conscience individuelle donne accès. C’est cette vision du droit naturel que le projet de code civil de l’an VIII (= la première rédaction du Code avant discussion) consacrait. Aux termes de l’article 1 : « il existe un droit universel et immuable source de toutes les lois positives : il n’est que la raison universelle en tant qu’elle gouverne tous les hommes ». b/Le contenu du droit naturel controversé : uploads/S4/ droit-general.pdf
Documents similaires







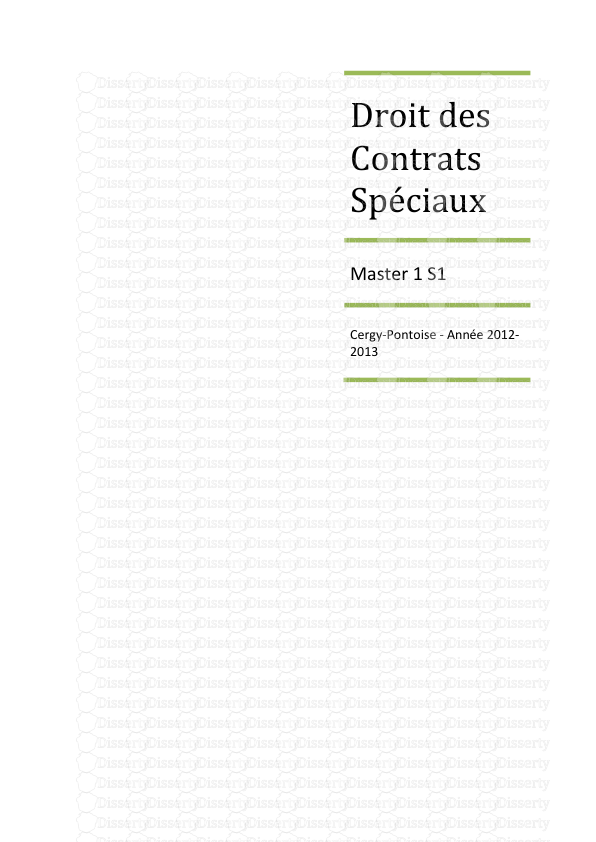


-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.8382MB


