Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles Ra
Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles Rapport 2015 consacré aux droits de l’enfant Éditorial C ette année, nous avons choisi de consacrer notre rapport thématique sur les droits des enfants à un sujet peu connu, peu étudié, peu traité, alors qu’il concerne des enfants particulièrement vulnérables : les enfants en situation de handicap et pris en charge en protection de l’enfance. Le Défenseur des droits a justement pour mission de veiller à ce que les per sonnes les plus vulnérables se voient garanti, et le cas échéant rétabli, l’accès effectif à leurs droits fondamentaux, tels que reconnus dans les conventions inter nationales dûment ratifiées par la France, et inscrits dans les Lois de la République. La Convention Internationale des droits de l’Enfant, dont le Défenseur des droits contrôle l’application effective, protège l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui le concernent. L’article 20-1 dispose en particulier que lorsqu’un enfant ne peut être laissé dans son milieu familial dans son propre intérêt, il a droit à une protection et une aide de l’État. Les enfants handicapés font l’objet de dispositions spécifiques : accès aux soins, droit à l’éducation, notamment, l’article 23 leur reconnaissant le droit à « mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ». Par ailleurs, la Convention relative aux droits des personnes handicapées vient rappeler le principe de non-discrimination des enfants porteurs de handicap (pré ambule), le respect du principe de développement de l’enfant (art. 3) et de son intérêt supérieur (art. 7). En outre, la situation de handicap ne peut venir justifier la séparation de l’enfant et des parents (art. 24-5), ni empêcher l’accès à une éducation gratuite et obligatoire ou l’accès aux soins. L’article 25 préconise un diagnostic précoce du handicap et des actions de prévention. Saisis de multiples réclamations individuelles, provenant de parents, d’associa tions ou de professionnels, et relatives à des enfants handicapés accompagnés ou confiés en protection de l’enfance, nous avons pu observer la grande complexité de leurs situations et les difficultés spécifiques auxquelles ils étaient confrontés. Nous avons pu mesurer combien la fragilisation extrême de ces enfants, ainsi que celle de leur famille, les exposait tout particulièrement à des dénis de leurs droits : à la santé, à la scolarité, à une vie en famille, à la protection contre la vio lence sous toutes ses formes… Des enfants « invisibles », dans les politiques publiques d’accompagnement du handicap, comme dans celles de protection de l’enfance, car oubliés des systèmes d’information existants, et donc ni quantifiés ni identifiés. Or selon les estimations retenues au rapport, prudentielles, et qui ne prennent en compte que les handicaps reconnus par les MDPH, 70 000 enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance seraient concernés, avec une sensible surreprésentation par rapport à la population générale. Des enfants qui présentent des situations très hétérogènes : en fonction de la nature et de la lourdeur du handicap : physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, ainsi que des troubles associés ; en fonction de leurs modalités de prise en charge dans le secteur médico-social et sanitaire comme dans le secteur social : milieu ordinaire ou ouvert, établissement ou famille d’accueil ; en fonction aussi du type de protection, administrative ou judiciaire. Des enfants doublement vulnérables, qui devraient en toute logique bénéficier d’une double attention et d’une double protection, mais qui vont paradoxalement, parce qu’ils se trouvent à l’intersection de politiques publiques distinctes, être les victimes de l’incapacité à dépasser les cloisonnements institutionnels, l’empilement des dispositifs et la multiplicité des acteurs, ainsi que les différences de cultures professionnelles, notamment autour de la place des parents et du travail avec les familles ; courant, de fait, le risque que se neutralisent les interventions conduites auprès d’eux. C’est la vocation de notre institution que de pouvoir repérer au travers des sai sines les besoins des enfants dans notre pays et les atteintes portées à leurs droits fondamentaux ; c’est aussi une force de s’appuyer sur la transversalité des missions qui nous sont confiées par la Loi organique et la synergie des compétences au service de l’accès aux droits ; c’est enfin la faculté de pouvoir dépasser le traitement individuel pour mettre en évidence les problématiques plus générales, l’objectif étant de proposer des recommandations utiles pour faire évoluer durablement les politiques et les pratiques. Nous nous appuyons pour ce faire sur les acteurs de la société civile et des institutions avec lesquels nous entretenons un dialogue permanent. Ainsi, pour préparer le présent rapport, nous avons conduit plus de 40 audi tions et entretiens, reçus plus de 20 contributions, dont celles du réseau européen des défenseurs des enfants, enfin mené une enquête auprès de l’ensemble des Conseils Départementaux. Nous avons été frappés par l’intérêt suscité par notre projet, de la part de nos différents interlocuteurs, associations, conseils départementaux, directions cen trales des Ministères, institutions nationales (CNSA…) ou locales (MDPH, ARS...), doublé de la prise de conscience partagée de la nécessité de traiter autrement ces enfants. En cette année riche en célébrations : les 25 ans de la ratification de la Conven tion Internationale des droits de l’enfant, les 10 ans de la Loi du 11 Février 2005 relative aux droits des personnes handicapées, les 15 ans de l’institution de Défen seur des Enfants, nous formons le vœu que ce rapport inédit, premier du genre en France, permette de rendre présents au regard de la société toute entière ces 70 000 enfants, et d’inciter les différents acteurs à s’emparer des problématiques et des enjeux spécifiques ainsi repérés. Puisse-t-il aussi identifier des pistes concrètes d’amélioration des dispositifs et des pratiques en direction des enfants handicapés sous protection qui fassent l’objet d’une appropriation à tous les niveaux, favorisant ainsi le respect effectif de leurs droits fondamentaux. Nous sommes certains pour notre part que tout progrès acquis pour les plus faibles comporte un effet de levier en faveur d’un changement qui bénéficie à tous. Le Défenseur des droits Jacques Toubon La Défenseure des enfants Geneviève Avenard Avertissement Pour des raisons de facilité d’écriture et de lecture, les termes d’enfant handi capé, d’enfant porteur de handicap et d’enfant en situation de handicap seront indistinctement utilisés dans le cadre du présent rapport. En tout état de cause, les enfants visés sont ceux dont le handicap a été reconnu par la MDPH. Par ailleurs, compte-tenu de l’ampleur et de la complexité du sujet, plusieurs thématiques, bien qu’identifiées, n’ont pas fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre du présent rapport : citons le statut de pupille et la question de l’adoption des enfants en situation de handicap, la prévalence des troubles psy chiques, la question multiculturelle, l’action des avocats d’enfants, les maltraitances institutionnelles et, par ailleurs, les différentes problématiques liées à l’attribution des aides financières (AEEH et PCH, notamment) aux familles. Arthur, 10 ans... L a scolarité d’Arthur a été compliquée dès le cours préparatoire, l’enfant ayant des difficultés d’apprentis sage et de concentration de sorte que sa mère a mis en place des suivis psycho logique, pédo-psychiatrique et en orthophonie. L’enfant a pu bénéficier des accom pagnements en RASED mais les problèmes de comporte ment ont été progressivement envahissants, empêchant les acquisitions scolaires. Les diffi cultés ont été de plus en plus prégnantes jusqu’en CM1 où le dialogue entre la mère et l’équipe éducative s’est dété rioré alors même que les diffi cultés d’Arthur augmentaient. Privé de récréation, puis de sorties pédagogiques, ses temps de présence à l’école ont été progressivement réduits, jusqu’à une interrup tion totale de la scolarisation pendant plus de 6 mois. En dépit des prises en charge mises en place par la mère, l’école a rédigé une informa tion préoccupante, s’interro geant sur les conditions de prise en charge parentale. Une évaluation du conseil départemental a permis de conclure que, si les troubles du comportement d’Arthur étaient réels, cela ne rele vait pas d’une carence fami liale. Cette IP a été perçue très violemment de la part de la famille qui était en demande d’aide depuis plusieurs années auprès de l’école. Il est intéressant de noter que l’école n’a préco nisé une orientation vers la MDPH que la dernière année de présence de l’enfant. Les parents, démunis, n’avaient pas eu connaissance de ce dispositif auparavant. Le Défenseur des droits a été saisi par la mère d’Arthur. Lena, 14 ans... L es parents de Lena viennent d’apprendre que leur fille, adolescente, est évaluée comme schizophrène. Après de nombreuses démarches, ils ont trouvé une structure adaptée pour l’accueillir. Ils expliquent qu’avant de pouvoir obtenir un diagnos tic, ils ont consulté un très grand nombre de méde cins qui connaissaient peu ou pas du tout le handicap et qui n’ont pas su les orien ter sur les démarches à réali ser (saisine MDPH notam ment). C’est en utilisant leurs ressources personnelles qu’ils ont réussi à trouver les informa tions utiles et qu’ils ont rencon tré des spécialistes qui ont pu les accompagner dans leurs démarches. uploads/S4/ handicap-et-protection-de-l-x27-enfance-des-droits-pour-des-enfants-invisibles.pdf
Documents similaires




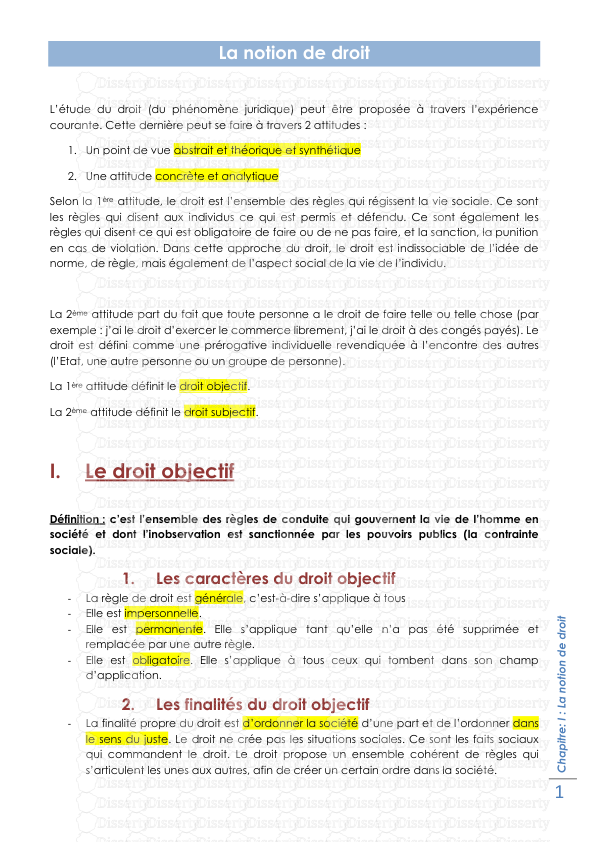





-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.6633MB


