- 1 - LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE Philippe COSSALTER (
- 1 - LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE Philippe COSSALTER (NB : Version d’archive récupérée le 17/03/2008. Cette version n’est peut-être pas identique à celle qui a été soutenue). Mémoire pour le DEA de Droit Public Interne de L’Université Panthéon-Assas (Paris II) Soutenue publiquement le 17 septembre 1999 Jury Messieurs les professeurs Michel Verpeaux, président Didier Truchet - 2 - INTRODUCTION "Les Grands arrêts n'appartiennent pas à la catégorie ordinaire des ouvrages d'un auteur déterminé, mais on pourrait les qualifier d'ouvrage collectif. En même temps, c'est un ouvrage d'essence, dans laquelle on condense et cristallise une grande œuvre historique, qui figure à juste titre parmi les plus importantes conquêtes de l'esprit français"1. Cette présentation des Grands Arrêts par le président Stassinopoulos résume l'opinion largement répandue que se fait la doctrine sur un ouvrage désormais classique. Certains n'hésitent pas même à le qualifier de "chef d'œuvre"2. Il est difficile, pour un étudiant qui, comme tous les étudiants en droit, a appris dès la seconde année d'études supérieures à chercher les réponses à ses questions dans le "GAJA", de porter un regard critique sur les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative. Tel est pourtant l'objet de cette étude. Et dès l'abord, il semble que tout n'est pas aussi simple et définitif au royaume des grands arrêts. L'un des auteurs du célèbre ouvrage ne note-t-il pas que "l'ombre portée des "grands arrêts" ne doit pas cacher les exigences qui s'imposent à tout juge dans l'exercice de sa mission. Le rappeler, c'est inviter tant à la modestie qu'à la rigueur. Modestie en ce sens que notre droit administratif est la résultante d'un ensemble de composantes. Il ne saurait être réduit à quelques décisions de principe. Bien plus est-il le fruit d'une œuvre collective toujours perfectible"3 ? Les grands arrêts ne seraient donc pas les seuls piliers qui soutiennent le droit administratif. Et si cet édifice est le résultat de "l'évolution lente réalisée par une jurisprudence patiente et prudente"4, il est plus un palais sur pilotis qu'un temple grec. 1 Michel STASSINOPOULOS, note bibliographique de la 5ème édition des grands arrêts de la jurisprudence administrative, R.D.P. 1970 p. 820. 2 "Voilà quarante ans, le GAJA était un ouvrage de grande qualité. C'est aujourd'hui un chef d'œuvre. Un de ces monuments de la littérature juridique que l'on prend plaisir à visiter…". Charles DEBBASCH, "Quarante ans de jurisprudence administrative ou les quarante ans des Grands arrêts de la jurisprudence administrative"; J.C.P., 27 février 1997, n° 9 p. 2. 3 Bruno GENEVOIS, "Sur la hiérarchie des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux"; Mélanges René Chapus, pp. 245-261. 4 Jacques MOREAU, "Internationalisation du droit administratif français et déclin de l'acte de gouvernement", Mélanges Loussouarn, 1994, pp. 294-301. - 3 - Le foisonnement de la jurisprudence a rendu nécessaire une œuvre de vulgarisation destinée à présenter la jurisprudence administrative à travers quelques grands arrêts, comme l'histoire de France s'apprend autour de grandes figures, qui sont présentées avec leurs qualités et leurs défauts, afin de marquer l'esprit de l'élève. Cette nécessité de synthétiser la jurisprudence administrative est apparue très tôt. Déjà, Cormenin s'était attelé à la tâche avec ses "Questions de droit administratif", et Maurice Hauriou notait l'importance d'une telle entreprise5, le doyen de Toulouse qui lui-même contribua à clarifier le domaine par ses nombreuses notes de jurisprudence réunies au sein de trois volumes d'un intérêt capital. Mais si les Grands Arrêts ont eu d'illustres prédécesseurs, c'est à une tâche différente que ses auteurs se sont attelés. Les Grands Arrêts ne sont pas un recueil exhaustif, une sorte de "super Lebon", ni un traité de droit administratif présenté sous forme de commentaires d'arrêts, ni même un manuel, au sens où ce mot est défini par le Petit Littré "Titre de certains livres ou abrégés qui présentent l'essentiel des traités longs et étendus écrits sur la matière". Les Grands Arrêts sont une galerie de portraits. Ainsi présenter l'ouvrage revient déjà à induire le lecteur en erreur : les Grands Arrêts ne sont rien de ce que nous avons dit, et tout ceci à la fois. Car à travers leur unité, les Grands Arrêts ont subi de profonds changements au fil des onze éditions qui se sont succédées de 1956 à 1996.Une douzième édition devrait paraître au mois de septembre 1999, réalisant une très importante mise à jour. La pluralité des auteurs, passés de trois en 1956 à cinq en 1990 et les profonds bouleversements du droit administratif ont inévitablement modifié le visage du GAJA en quarante ans. Le fond du droit ne sera abordé que lorsque sa présentation explique l'introduction ou la disparition d'un grand arrêt. L'Œuvre du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits ne sera donc abordé qu'à travers le prisme des Grands Arrêts. Par ailleurs, l'ouvrage a été étudié dans son unité. Aucune recherche du rôle de chaque auteur n'a été réalisée. Enfin, les arrêts étudiés ne sont pas toujours les plus importants des grands arrêts, mais les plus explicites. Il y aura donc souvent un rapport inversement proportionnel entre l'intérêt porté à un arrêt et son importance au sein de l'ouvrage. 5 Répertoire Béquet, t. XIV verbo Doit administratif, chap. III, pp. 18 s. - 4 - La méthode suivie pour l'étude de l'ouvrage a consisté à comparer les onze éditions afin d'en dégager les évolutions perceptibles quant au choix des arrêts et au contenu de leurs commentaires. Quant à la présentation de cette étude, elle se structure autour du rapport dialectique entre le singulier et le pluriel : singulier du grand arrêt, pluriel des Grands Arrêts. Enfin, à l'intérieur de chaque partie seront opposés les points communs et les différences : les grands arrêts seront étudiés à travers leurs caractéristiques communes, puis distingués afin d'aboutir à une typologie; les Grands Arrêts seront appréhendés à travers leurs caractères et leurs objectifs initiaux, afin de cerner les grands traits de leurs évolutions. Le propos du présent mémoire sera donc aussi bien l'étude des grands arrêts, personnages éponymes d'une grande histoire du droit administratif (première partie) que de la structure de la pièce qui nous les présente et qui, au fil des représentations, en modifie la distribution (seconde partie). - 5 - PREMIERE PARTIE : Le grand arrêt. "Il y a un mystère dans le destin des décisions juridictionnelles. Sans remonter jusqu'à l'arrêt Blanco, qui ne connut la gloire que quelque trente ans après qu'il eut été rendu, telle, qui ne fait guère que redire ce que d'autres avaient dit avant elle, est considérée comme faisant date, telle autre, objectivement importante, n'éveille que peu d'échos et semble vouée à l'oubli"6. Jean Rivero exprime l'étonnement qui saisit inévitablement l'observateur attentif du droit administratif à la vue de l'histoire de ses arrêts de principe. Alors que le droit administratif est unanimement reconnu comme étant un droit fondamentalement jurisprudentiel7, une partie de la doctrine discute encore du rôle normatif que joue le juge administratif. Parmi les inconvénients que peut représenter un tel droit prétorien, et notamment l'instabilité et la rétroactivité de la règle de droit, il en est un qui nous intéresse particulièrement : la difficulté de prendre un arrêt de principe comme référence incontestable d'une solution jurisprudentielle. Si, par exemple, l'arrêt Société immobilière Saint-Just* et les conclusions qui l'accompagnent sont le "code de l'exécution forcée", d'autres arrêts de principe ne contiennent pas une solution jurisprudentielle qui puisse représenter, sans le complément de jurisprudences "annexes", l'état du droit positif. Il est pourtant nécessaire, si l'on veut donner une vue synthétique du droit administratif à travers la jurisprudence, de structurer son analyse autour d'un nombre fini d'arrêts, pouvant illustrer chacun une solution particulière ou une étape historique menant à cette solution. Au sein de cet ensemble parfois confus car pléthorique que constitue la jurisprudence administrative, il conviendra de dégager les critères permettant d'établir une hiérarchie parmi les jugements, arrêts et décisions des juridictions administratives (Chapitre I). 6 Jean RIVERO, note sous Conseil constitutionnel, décision du 12 janvier 1977; A.J.D.A. 1978, p. 215. 7 "C'est la source la plus abondante et la plus sûre du Droit administratif, dit M. Serrigny, à tel point que je ne crains pas d'affirmer que, sans l'existence de ce Conseil, jamais cette partie de la législation ne se serait élevée à l'état de science"; cité par Edouard LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux; L.G.D.J., Paris, 1989, Introduction, p. VIII. - "… en droit administratif, les règles les plus importantes ont été posées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché ces règles à un texte, soit qu'il les aient tout simplement affirmées de son propre chef". Georges VEDEL et Pierre DELVOLVE, Droit administratif, tome 1; P.U.F. Collection Thémis Droit Public, 12ème édition, 1992, p. 89. - Tandis que René CHAPUS considère que le droit administratif est fondamentalement jurisprudentiel (Droit administratif général, tome 1, 12ème édition, p. 6), Messieurs LAUBADERE, VENEZIA et GAUDEMET pensent que la jurisprudence occupe une "place très importante…, le juge n'ayant pas simplement la fonction de trancher les litiges, mais ayant historiquement pris une part, souvent uploads/S4/ les-grands-arrets-de-la-jurisprudence-administrative 2 .pdf
Documents similaires








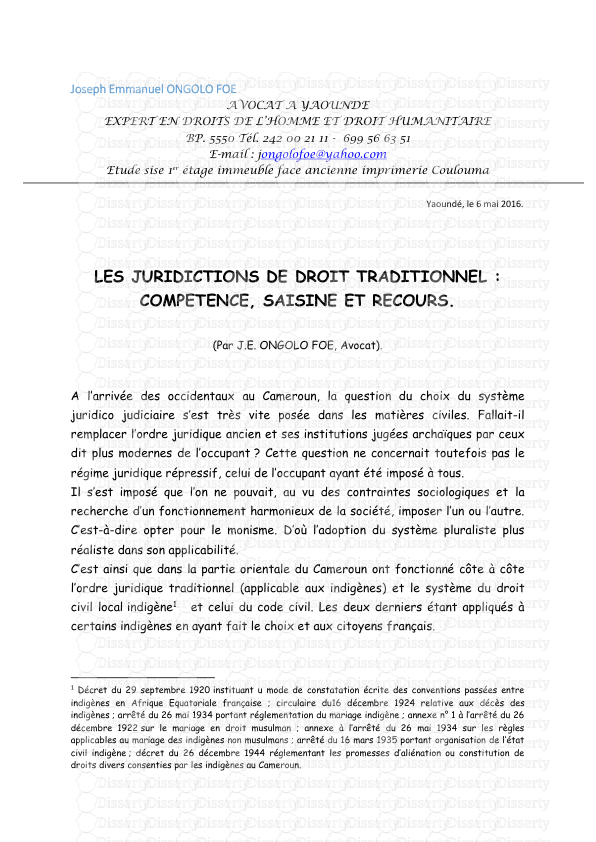

-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.9021MB


