GABENS Lola CIVLIB 206 TD N°4 Vous commenterez la décision suivante : Décision
GABENS Lola CIVLIB 206 TD N°4 Vous commenterez la décision suivante : Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 (Document 11) « Le Droit n’existe pas pour lui-même, il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu'il a pour mission de servir », c’est ce que pensait René Chapus. En ce sens, les éditorialistes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ont voulu tenir l'État responsable de sa police. C'est le libellé de l'article 12 de la Déclaration qui interdit la délégation des services de police et le pouvoir d'empêcher que les services de police soient utilisés par et pour les « ceux auxquels elle est confiée ». Il a été demandé au Conseil constitutionnel, le 21 janvier 2022, de décliner cette norme dans le cadre de loi renforçant les outils de la gestion la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. En substance, c’est l'article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 qui est remis en question. Il y a donc eu modification de l'article 1er, paragraphe II A, de cette dite loi ; notamment afin de permettre l'accès à certains lieux soumis à la présentation, par le Premier ministre, d'un justificatif de statut vaccinal au regard du Covid-19, également appelé « passe vaccinal ». De plus avec la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, le passe sanitaire a été transformée en passe de vaccination pour les 16 ans et plus. Un test négatif au Covid-19 (PCR ou antigène) ne suffisait donc plus pour entrer dans un lieu public. Il était aussi question dans cette décision de permettre aux gérants d’établissement, dans lesquels est obligatoire ce « passe vaccinal », de les contrôler eux-mêmes. C’est-à-dire que le législateur souhaite donner aux gérants le pouvoir de demander la restitution d’une carte d’identité lorsqu’il y a présence d’un doute sérieux sur la validité du document donné. Nous retrouvons ces dispositions dans les articles 1er et 16 de la loi du 31 mai 2021 concernant la modification du Code de la santé publique. Le Conseil Constitutionnel a donc été saisi, par la demande de soixante députés et soixante sénateurs, et par application de l’article 61 de la Constitution. Le 18 janvier 2022, il a par ailleurs été demandé au Conseil Constitutionnel, par le Premier Ministre, de statuer selon une procédure d'urgence retrouvée à l'article 61, alinéa 3 de la Constitution. Les requérants demandent alors la censure pour inconstitutionnalité des articles 1er et 16 de la loi mentionnée auparavant. Ils invoquent en premier lieu un moyen selon lequel ces dispositions seraient attentatoires à celles de l'article 12 de la DDHC, car elles constitueraient une délégation du pouvoir de police administrative. En outre, dans une deuxième requête, ils allèguent que les dispositions contestées constituent une violation grave de leur droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel est donc appelé à se prononcer sur la question de savoir si l'administration de pièces d'identité par des particuliers constitue une délégation de puissance publique susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Cette question est importante à bien des égards, d'autant plus qu'elle peut avoir un impact important. Si le Conseil constitutionnel ne reconnaît que le contrôle en omettant de reconnaitre la délégation de force publique, il ouvre la porte à un nombre considérable de litiges (I). En revanche, il semble compliqué de ne pas émettre de réserves lorsque des mesures ne respectant pas la vie privée risquent d'être facilement contournées par le Conseil constitutionnel (II). Par la résolution n°2022-835 DC du 21 janvier 2022, Le Conseil constitutionnel reconnaît la constitutionnalité des dispositions qui conditionnent l'accès à certains lieux à la présentation d'un « passe vaccinal ». Cependant, ce dernier précise qu’il sera nécessaire d’appliquer la résiliation lorsque cette présentation ne sera plus nécessaire, il exclut également la possibilité d'exiger du Premier ministre qu'il fournisse un nombre de certificats de vaccination et de résultats de tests de dépistage du virus pour les déplacements longue distance dans les transports publics nationaux, puis le Conseil finira par censurer la réglementation sur l'accès aux rassemblements politiques. I - Autoriser le contrôle d'identité sans déléguer l'autorité publique, une interprétation surprenante mais nécessaire L'arrêt du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2022 débouche sur le dispositif actuellement connu. Ainsi, il est notoire que le Conseil constitutionnel n'a pas censuré l'introduction du « passe vaccinal ». Dans ce contexte, il est logique de mettre en place un moyen de vérifier l’identité, sans cela le document est invalide (A). Une telle autorisation devrait toutefois conduire à une nette limitation des pouvoirs spécifiques du pouvoir législatif, sans laquelle l'interdiction de transfert de la puissance publique deviendrait nécessairement de plus en plus abstraite (B). A) Prise de conscience de la nécessité d'un contrôle par le Conseil constitutionnel, source d’une décision réfléchie Dans son considérant 6, le Conseil constitutionnel rejette l'objection selon laquelle le contrôle par un particulier de pièces d'identité viole l'article 12 de la DDHC. Cette décision est logique et rationnelle. La gestion du contrôle des pièces est limitée aux cas où il « existe des raisons sérieuses de douter », limitant fortement le nombre d’exigences. De plus, cette vérification est nécessaire pour pouvoir appliquer concrètement la nouvelle norme. Il s'agit d'une réclamation défendue par le gouvernement et d'une réclamation raisonnable en vertu de la loi. Les normes qui ne peuvent pas être appliquées sont sans valeur. Deuxièmement, le moyen semble n'avoir aucun fondement réel. L'article 12 de la DDHC aborde le sujet de « l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique », exigeant ainsi que la disposition de la loi soit liée à la puissance publique. Ce qui est ici le cas, puisque les institutions publiques sont des organes des services gouvernementaux dont le but est de maintenir l'ordre et de faire respecter les lois. Il s'agit d'appliquer la loi, mais à une échelle très limitée. De plus, la seule conséquence du refus de présenter une pièce d'identité est l'interdiction d'entrée, et les conséquences sont minimes. La mission de maintien de l'ordre n'est donc pas déléguée et, comme la mission de contrôle, reste du ressort de la police administrative. Le respect du « laissez-passer sanitaire » est principalement assuré par des contrôles de police. B) Absence apparente de limites, source potentielle de litiges Cependant, il est possible de nuancer les propos ci-dessus. Si la délégation n'est pas substantielle, elle semble exister et se limiter aux faits de la cause. Le Conseil constitutionnel n'établit donc pas de règles générales. Cette vision du Conseil constitutionnel pose des questions juridiques. En effet, le Conseil constitutionnel n'invoque jamais la théorie des circonstances exceptionnelles (état d'urgence) dans ces considérations. Cela montre qu'une telle délégation est toujours possible. Par ailleurs, si cette transmission est possible à plus grande échelle, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur ses contours. Il semble donc raisonnable de s'inquiéter des excès. Un exemple d'agent de sécurité privé qui pourrait utiliser cette jurisprudence pour obtenir une forme de délégation. Il y a une absence de garantie posée au niveau de la personne qui contrôle. Ce dernier n'est pas défini, l’excès peut donc également être pris en compte. Enfin, même si le Conseil constitutionnel ne le dit pas, il s'agit clairement de circonstances exceptionnelles. Quid si cela se passait dans une autre période ? Cela pose des questions de sécurité juridique. II – Une réserve et limitation du Conseil garantissant le maintien du principe d'égalité Le Conseil exprime des réserves quant au droit au respect de la vie privée lorsqu'il considère l'administration des documents d'identité comme constitutionnelle au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le moyen formulé par les requérants laisse peu de place à la censure, ce qui explique le rejet logique de la demande (A). Pourtant le conseil se pose légitimement en tant que garant des droits, en imposant une réserve (B). A) La faiblesse des moyens, cause du refus logique du Conseil constitutionnel Les requêtes formulées en rapport avec le droit au respect de la vie privée apparaissent relativement faibles, expliquant logiquement le refus du Conseil constitutionnel. La présentation d'une pièce d'identité aux gérants d’établissement est considérée comme une violation mineure des droits à la vie privée. De plus, la Cour constitutionnelle se trouvant dans la logique de conciliation des droits entre le respect du droit à la vie privée et la restauration de la liberté de circulation, voit une atteinte à la première largement justifiée par la restauration de la seconde. Le fait de fournir une pièce d'identité ne semble pas être une exception particulière et, comme la présentation de tels documents est déjà autorisée dans d'autres cas, elle entraîne également le rejet du premier moyen. Cependant, l’autre conciliation visant à garantir des objectifs à valeur constitutionnelle de protection de la santé sont intéressantes. Parce que le juge uploads/S4/ td-4-etat-d-x27-urgence-sanitaire.pdf
Documents similaires



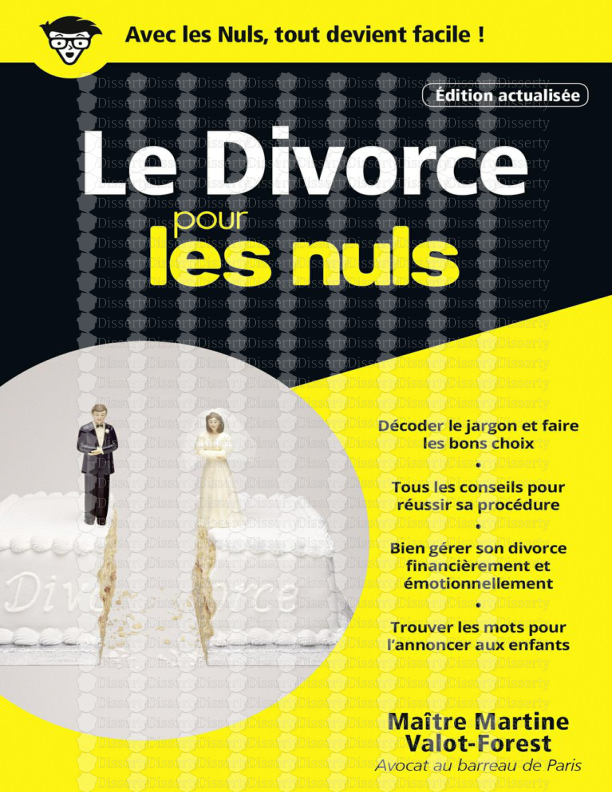






-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0853MB


