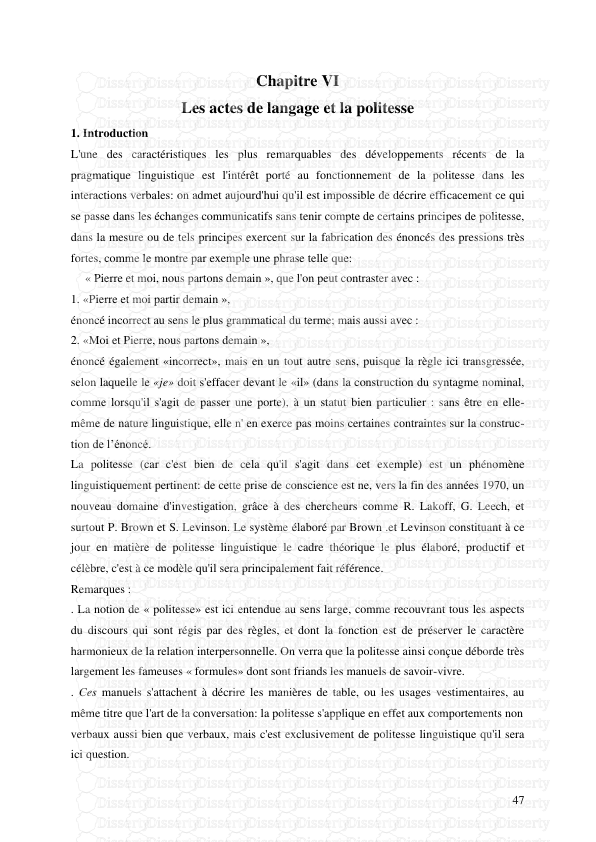47 Chapitre VI Les actes de langage et la politesse 1. Introduction L'une des c
47 Chapitre VI Les actes de langage et la politesse 1. Introduction L'une des caractéristiques les plus remarquables des développements récents de la pragmatique linguistique est l'intérêt porté au fonctionnement de la politesse dans les interactions verbales: on admet aujourd'hui qu'il est impossible de décrire efficacement ce qui se passe dans les échanges communicatifs sans tenir compte de certains principes de politesse, dans la mesure ou de tels principes exercent sur la fabrication des énoncés des pressions très fortes, comme le montre par exemple une phrase telle que: « Pierre et moi, nous partons demain », que l'on peut contraster avec : 1. «Pierre et moi partir demain », énoncé incorrect au sens le plus grammatical du terme; mais aussi avec : 2. «Moi et Pierre, nous partons demain », énoncé également «incorrect», mais en un tout autre sens, puisque la règle ici transgressée, selon laquelle le «je» doit s'effacer devant le «il» (dans la construction du syntagme nominal, comme lorsqu'il s'agit de passer une porte), à un statut bien particulier : sans être en elle- même de nature linguistique, elle n' en exerce pas moins certaines contraintes sur la construc- tion de l’énoncé. La politesse (car c'est bien de cela qu'il s'agit dans cet exemple) est un phénomène linguistiquement pertinent: de cette prise de conscience est ne, vers la fin des années 1970, un nouveau domaine d'investigation, grâce à des chercheurs comme R. Lakoff, G. Leech, et surtout P. Brown et S. Levinson. Le système élaboré par Brown .et Levinson constituant à ce jour en matière de politesse linguistique le cadre théorique le plus élaboré, productif et célèbre, c'est à ce modèle qu'il sera principalement fait référence. Remarques : . La notion de « politesse» est ici entendue au sens large, comme recouvrant tous les aspects du discours qui sont régis par des règles, et dont la fonction est de préserver le caractère harmonieux de la relation interpersonnelle. On verra que la politesse ainsi conçue déborde très largement les fameuses « formules» dont sont friands les manuels de savoir-vivre. . Ces manuels s'attachent à décrire les manières de table, ou les usages vestimentaires, au même titre que l'art de la conversation: la politesse s'applique en effet aux comportements non verbaux aussi bien que verbaux, mais c'est exclusivement de politesse linguistique qu'il sera ici question. 48 2. Le modèle de Brown et Levinson La conception de la politesse que développent ces auteurs s'articule et se fonde sur la notion de «face», notion empruntée entre autres à E. Goffman, mais étendue par incorporation de ce qu'on appelle plus communément le «territoire». a. La notion de « face» Pour Brown et Levinson, tout individu possède deux faces: -la face négative, qui correspond en gros à ce que Goffman décrit comme les «territoires du moi» (territoire corporel, spatial, ou temporel, biens matériels ou savoirs secrets...); -la face positive, qui correspond en gros au narcissisme, et à l'ensemble des images valorisantes que les interlocuteurs construisent et tentent d'imposer d'eux-mêmes dans l'interaction. b. La notion de « FTA » Dans toute interaction à deux participants, ce sont donc quatre faces qui se trouvent mises en présence. D'autre part: tout au long du déroulement de l'interaction, les interlocuteurs sont amenés à accomplir un certain nombre d'actes, verbaux et non verbaux. Or la plupart de ces actes - voire la totalité - constituent des menaces potentielles pour l'une et/ou l'autre de ces quatre faces: d'où l’expression de Face Threatening Act proposée par Brown et Levinson pour designer ces « actes menaçants pour les faces» ; expression popularisée sous la forme abrégée de «FTA», ce sigle faisant aujourd'hui partie du vocabulaire de base de tout chercheur des interactions. Dans cette perspective, les actes de langage se repartissent en quatre catégories : 1. Actes menaçants pour la face négative de celui qui les accomplit: c' est par exemple le cas de l' offre, ou de la promesse, par lesquelles on propose d'effectuer, ou l'on s'engage à effectuer, un acte susceptible de venir léser, dans un avenir proche ou lointain, son propre territoire. 2. Actes menaçants pour la face positive de celui qui les accomplit: aveu, excuse, auto critique et autres comportements «autodégradants ". 3. Actes menaçants pour la face négative de celui qui les subit: les violations territoriales de nature non verbale sont légion (offenses proxémiques, contacts corporels indus, agressions visuelles, sonores ou olfactives, pénétration par effraction dans les «réserves» d'autrui, etc.). Mais les menaces territoriales peuvent être aussi de nature verbale : il en est ainsi des questions dites «indiscrètes,,; et de l'ensemble des actes qui sont à quelque titre dérangeants ou « directifs», comme l'ordre, la requête, l'interdiction ou le conseil. 4. Actes menaçants pour la face positive de celui qui les subit: ce sont tous ceux qui risquent 49 de mettre en péril le narcissisme d'autrui, comme la critique, la réfutation, le reproche, l'insulte et l'injure, la moquerie ou le sarcasme... Les catégories 1 et 2 se rapportent aux actes «automenaçants" ; plus pertinentes dans la perspective qui nous occupe ici sont les catégories 3 et 4, puisque la politesse concerne avant tout l'attitude du locuteur envers son interlocuteur. Notons qu'un même acte peut relever simultanément de plusieurs catégories (mais avec généralement une valeur dominante); par exemple: en même temps qu'ils menacent la face négative du destinataire, l'ordre et la requête menacent la face positive du destinataire dans le cas de l'ordre, et du locuteur dans le cas de la requête. c. La notion de face want D'un côté donc, les actes effectués de part et d'autre tout au long de l'interaction sont potentiellement menaçants pour les interactants. Mais d'un autre côté, ceux-ci doivent obéir au commandement suprême: « Ménagez-vous les uns les autres », car la perte de face est une défaite symbolique que l'on essaie dans la mesure du possible d'éviter à soi-même, et d'épargner à autrui. Sur la notion de face viennent se greffer non seulement la notion de FTA, mais aussi celle de face want, ou désir de préservation des faces - celles-ci étant à la fois, et contradictoirement, la cible de menaces permanentes et l'objet d'un désir de préservation. d. La notion de face work Comment les interact ants parviennent-ils à résoudre cette contradiction? Pour Goffman: en accomplissant un travail de «figuration» (face work), ce terme désignant «tout ce qu' entreprend une personne pour que ses actions ne fassent perdre la face à personne (y compris elle-même)». Pour Brown et Levinson: en mettant en œuvre diverses stratégies de politesse ; dans cette perspective, la politesse apparaît comme un moyen de concilier le désir mutuel de préservation des faces, avec le fait que la plupart des actes de langage sont potentiellement menaçants pour telle ou telle de ces mêmes faces. A partir de là, il s'agit pour Brown et Levinson de faire l'inventaire et la description des différentes stratégies qui peuvent être mises au service de la politesse, le choix effectue parmi ces nombreuses stratégies étant fonction des trois facteurs suivants : -le degré de gravité du FTA; -la «distance sociale» (D) qui existe entre les interlocuteurs (c'est-à-dire notre relation «horizontale»); 50 -leur relation de « pouvoir» (P) (relation verticale); l'idée étant que la politesse d'un énoncé doit en principe croître en même temps que D, P et le « poids " du FTA. Le modèle édifié par Brown et Levinson est à coup sur productif, comme en témoigne la masse considérable des études qui s'en sont inspirées avec profit. Il apparaît toutefois qu'un certain nombre de critiques peuvent lui être faites, et corrélativement qu'un certain nombre d'aménagements doivent lui être apportés. 3. Aménagement du modèle a. La notion d'«anti-FTA» (ou «FFA ») Ce modèle s'est vu surtout reprocher une conception excessivement pessimiste, voire «paranoïde», de l'interaction - représentant les individus en société comme des êtres vivant sous la menace permanente de FTAs en tout genre, et passant leur temps à monter la garde autour de leur territoire et de leur face. Il est en effet incontestable que Brown et Levinson réduisent par trop la politesse à sa forme « négative» : très révélateur à cet égard est le fait que, cherchant à recycler la notion d'acte de langage dans la perspective d'une théorie de la politesse linguistique, ils n'aient envisagé que les actes potentiellement menaçants pour les faces des interactants, sans penser que certains actes de langage peuvent aussi être valorisants pour ces mêmes faces, comme le compliment, le remerciement ou le vœu. Pour en rend re compte, il est indispensable d'introduire dans le modèle théorique un terme supplémentaire pour designer ces actes qui sont en quelque sorte le pendant positif des FTAs: ces «anti- FTAs», nous les appellerons des «FFAs" (Face Flattering Acts) – l’ensemble des actes de langage se répartissant alors en deux grandes familles, selon qu'ils ont sur les faces des effets essentiellement négatifs (comme l’ordre ou la critique), ou essentiellement positifs (comme le compliment ou le remerciement). b. Politesse négative vs positive L'introduction des FFAs permet en outre de clarifier les notions de «politesse négative» et de uploads/Finance/ chuye-n-de-3.pdf
Documents similaires






-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 09, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.2010MB