LE CHÔMAGE DANS L’AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE : UNE EXPLICATION PAR LA STRUCTURE
LE CHÔMAGE DANS L’AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE : UNE EXPLICATION PAR LA STRUCTURE URBAINE* UNEMPLOYMENT IN THE BRUSSELS METROPOLITAN AREA: THE ROLE OF CITY STRUCTURE par Claire DUJARDIN ** Aspirant du F.N.R.S. GEOG (UCL) et CORE dujardin@geog.ucl.ac.be Harris SELOD *** Chargé de recherches INRA Paris-Jourdan (LEA) et CREST selod@ens.fr et Isabelle THOMAS ** Maître de recherches du F.N.R.S. GEOG (UCL) et CORE isabelle@geog.ucl.ac.be ** Département de Géographie, Université catholique de Louvain 3, Place Pasteur, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique *** INRA-LEA 48, Boulevard Jourdan, 75014 Paris, France 11 juillet 2003 Mots-clés : chômage urbain, spatial mismatch, ségrégation résidentielle Key-words : urban unemployment, spatial mismatch, residential segregation Classification JEL : R0, J6, J7 * Les auteurs remercient Patrick Deboosere et le Point d’Appui Démographie (Vrije Universiteit van Brussel) de leur avoir fourni les données nécessaires à cette étude, ainsi que Dominique Peeters pour une lecture minutieuse d’une première version de l’article. Harris Selod remercie la Commission Européenne pour le financement de ses travaux (bourse Marie Curie HPCF-CT-2000-00614). - INTRODUCTION - De nombreux travaux économiques, sociologiques et géographiques se sont penchés sur la question de la structure sociale et spatiale des villes, et plus particulièrement sur la répartition spatiale du chômage au sein des agglomérations urbaines (BURGESS, 1925 ; HOYT, 1939 ; KASARDA, 1989 ; WILSON, 1987 et 1996 ; VANDERMOTTEN et al, 1999). Ainsi, la majorité des villes présente une structure spatiale opposant le centre-ville à la périphérie. Aux États-Unis, les centres des villes sont généralement pauvres et connaissent d’importants problèmes sociaux, tandis que la banlieue est plus aisée. Bruxelles se rapproche de ce schéma puisque son centre-ville connaît des taux de chômage élevés et concentre des populations défavorisées, en particulier minorités ethniques et individus peu qualifiés (KESTELOOT et al, 2001 ; THOMAS et ZENOU, 1999 ; GOFFETTE-NAGOT, THOMAS et ZENOU, 2000). Deux hypothèses opposées mais non mutuellement exclusives ont été avancées afin d’expliquer cette différenciation intra-urbaine des taux de chômage. La première et la plus évidente met l’accent sur les choix de localisation résidentielle par lesquels les individus se stratifient naturellement dans l’espace urbain en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques. C’est un des résultats classiques des modèles d’économie urbaine (voir par exemple FUJITA, 1989) sur lequel nous ne reviendrons pas. La deuxième explication, et qui fait l’objet de cet article, renverse pour ainsi dire la causalité en suggérant que l’organisation spatiale des villes peut être en soi une source de chômage. Cette explication s’appuie sur des théories qui peuvent être subdivisées en deux groupes selon (i) qu’elles insistent sur les effets négatifs de la ségrégation résidentielle entre groupes ethniques ou socio-économiques (CUTLER et GLAESER, 1997 ; ELLEN et TURNER, 1997) ou (ii) qu’elles soulignent le rôle défavorable de la déconnexion physique entre lieux de résidence et lieux d’emploi (hypothèse du spatial mismatch avancée par KAIN, 1968 ; voir la revue empirique de IHLANFELDT et SJOQUIST, 1998 ou la revue empirique et théorique de GOBILLON, SELOD et ZENOU, 2002). Ces théories qui relient l’organisation des villes au marché du travail sont apparues aux États- Unis et ont été principalement testées pour des métropoles américaines (voir par exemple IMMERGLUCK, 1998 ; O’REGAN et QUIGLEY, 1996 et 1998). On connaît à l’heure actuelle peu d’études de ce type pour les villes européennes (voir GOBILLON et SELOD, 2003, pour une étude de l’agglomération parisienne). Malgré l’intérêt porté à la question, les études empiriques n’ont pas encore atteint de consensus quant aux effets de la ségrégation résidentielle et du spatial mismatch sur la différenciation intra-urbaine du chômage. Cette absence de consensus tiendrait selon certains auteurs (par exemple O’REGAN et QUIGLEY, 1998) à la grande diversité des méthodes employées et à la comparabilité limitée des différentes sources de données utilisées. Sur ce dernier point, une distinction peut être faite entre d’une part, les études basées sur des données agrégées par zone géographique et, d’autre part, les études basées sur des données individuelles. Les premières s’attachent à expliquer les différenciations spatiales du taux de chômage à l’aide d’indicateurs mesurant la composition sociale des quartiers et/ou la déconnexion physique aux emplois (voir par exemple IMMERGLUCK, 1998 ainsi que FIELDHOUSE, 1999), tandis que les secondes tentent d’évaluer le rôle des caractéristiques individuelles et des caractéristiques du quartier dans l’explication des probabilités de chômage de certains groupes d’individus (voir O’REGAN et QUIGLEY, 1996 et 1998 ou encore BAUDER et PERLE, 1999). Le présent article a pour objectif principal de tester les théories relatives au rôle de la ségrégation résidentielle et de la déconnexion physique aux emplois sur la formation du chômage dans le cas de l’agglomération bruxelloise. Sur le plan méthodologique, nous souhaitons également comparer les résultats obtenus en utilisant deux bases de données toutes deux construites à partir du Recensement de la Population de 1991 mais qui diffèrent par leur niveau d’agrégation (INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUES, 1991a et 1991b). Dans un premier temps, nous utilisons des données agrégées afin de régresser le taux de chômage local sur des indicateurs de composition sociale des quartiers et d’accessibilité physique aux emplois de l’agglomération. Ensuite, nous estimons une probabilité de chômage à partir des données individuelles en prenant en compte tant les caractéristiques des individus que celles de leur ménage et de leur quartier de résidence. L’article met ainsi en évidence un certain nombre de problèmes liés à l’utilisation de données agrégées et souligne l’importance de la mise à disposition de données individuelles pour l’étude de ce type de problématique. Dans une première section, nous présentons une brève synthèse de la littérature économique qui expose les liens entre l’organisation spatiale des villes et la formation du chômage. La deuxième section décrit la base de données et les méthodes utilisées. La troisième section présente quelques faits stylisés sur l’agglomération bruxelloise. La quatrième section présente les principaux résultats obtenus et la cinquième section conclut. - I - ORGANISATION DES VILLES ET CHÔMAGE La littérature économique suggère que l’organisation spatiale des agglomérations urbaines peut avoir des effets négatifs sur l’emploi et le revenu des populations les plus fragiles. Les performances d’un individu sur le marché du travail seraient ainsi fonction non seulement de ses caractéristiques individuelles (âge, niveau d’éducation, appartenance ethnique,…) mais également de sa localisation au sein de la ville. Cette idée s’appuie sur deux grands types d’explications que nous présentons successivement. 1.1. La déconnexion physique entre lieux de résidence et lieux d’emploi La déconnexion physique entre lieux d’emploi et lieux de résidence (qualifiée de spatial mismatch ou mauvais appariement spatial par la littérature américaine) peut être à l’origine de coûts de déplacement monétaires ou temporels élevés qui sont une entrave à la mobilité. Pour les individus n’ayant pas accès à l’automobile, l’utilisation de transports en commun inadaptés peut également être coûteuse (couverture insuffisante de certaines zones par les points de desserte, temps d’attente importants aux nœuds d’interconnexion, problèmes de coordination des différents modes de transport utilisés, faibles fréquence de passage, voire fermeture du réseau à certaines heures). Dans ce contexte, pour les chômeurs des zones les plus éloignées des emplois, des coûts trop importants au regard du salaire proposé pour un emploi distant peuvent tout simplement décourager l’acceptation du poste ou bien, en cas d’acceptation, conduire à un salaire net très faible. BRUECKNER et MARTIN (1997) et BRUECKNER et ZENOU (2003) proposent des modèles urbains dans lesquels ces coûts associés à la distance sont l’origine principale du chômage urbain. L’éloignement aux emplois peut également décourager la prospection d’emploi (à cause des coûts de déplacement élevés) ou même détériorer son efficacité. En ce qui concerne ce second point, la littérature suggère que l’information disponible sur les emplois vacants décroît avec la distance aux emplois, ce qui réduit d’autant l’efficacité de la prospection (ROGERS, 1997 ; IHLANFELDT et SJOQUIST, 1990 ; IHLANFELDT, 1997). Cette décroissance de l’information avec la distance peut s’expliquer par le fait que de nombreuses entreprises cherchant à pourvoir un poste pour un emploi peu qualifié ont souvent recours à des moyens de recrutement à portée limitée dans l’espace, tels l’affichage d’offres d’emploi en vitrine ou la publication d’annonces dans les journaux locaux (TURNER, 1997). Une autre explication est que les demandeurs d’emploi ont plus de difficultés à identifier les employeurs potentiels dans des zones distantes qu’ils ne connaissent pas. DAVIS et HUFF (1972) ont ainsi montré que les demandeurs d’emploi ne prospectent efficacement que dans un périmètre restreint autour de leur lieu de domicile même si cette zone ne comprend que des emplois de moins bonne qualité et de surcroît peu rémunérés. Il existe aujourd’hui un certain nombre de modèles théoriques qui expliquent la formation du chômage par ces mécanismes (BRUECKNER et ZENOU, 2003 ; WASMER et ZENOU, 2002). 1.2. La ségrégation résidentielle La distance physique entre lieux de résidence et d’emploi n’est pas la seule façon dont l’espace peut restreindre les opportunités économiques des habitants des zones défavorisées. En effet, la théorie économique met également l’accent sur le rôle de la ségrégation socio-économique voire ethnique des quartiers. Trois principales conséquences de cette ségrégation ont été mises en évidence. La ségrégation résidentielle peut tout d’abord jouer un rôle de frein à l’acquisition de capital humain uploads/Geographie/ article-3-economie-urbaine.pdf
Documents similaires









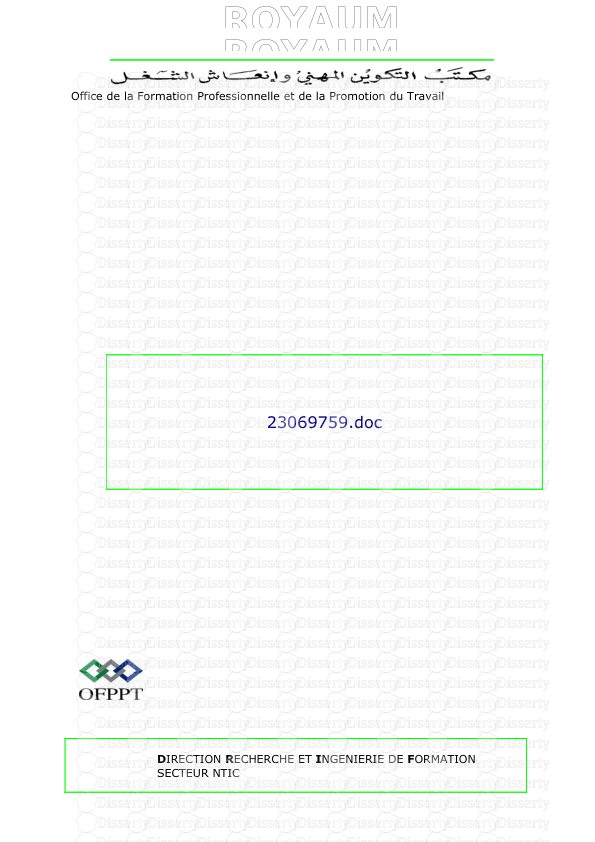
-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 28, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1973MB


