21-FRANTEIN1bis Page 1/8 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SESSION 2021 FRANÇAIS ÉPREU
21-FRANTEIN1bis Page 1/8 BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SESSION 2021 FRANÇAIS ÉPREUVE ANTICIPÉE Durée de l’épreuve : 4 heures Coefficient : 5 L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Ce sujet comporte 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. 21-FRANTEIN1bis Page 2/8 Vous traiterez au choix, l’un des deux sujets suivants : 1- Commentaire de texte (20 points) Objet d’étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle Texte : Gaston Miron, L’Homme rapaillé, 1970. JE T’ÉCRIS I Je t’écris pour te dire que je t’aime que mon cœur qui voyage tous les jours ─ le cœur parti dans la dernière neige le cœur parti dans les yeux qui passent le cœur parti dans les ciels d’hypnose ─ 5 revient le soir comme une bête atteinte Qu’es-tu devenue toi comme hier moi j’ai noir éclaté dans la tête j’ai froid dans la main j’ai l’ennui comme un disque rengaine1 10 j’ai peur d’aller seul de disparaître demain sans ta vague à mon corps sans ta voix de mousse humide c’est ma vie que j’ai mal et ton absence Le temps saigne 15 quand donc aurai-je de tes nouvelles je t’écris pour te dire que je t’aime que tout finira dans tes bras amarré que je t’attends dans la saison de nous deux qu’un jour mon cœur s’est perdu dans sa peine 20 que sans toi il ne reviendra plus II Quand nous serons couchés côte à côte dans la crevasse du temps limoneux2 nous reviendrons de nuit parler dans les herbes au moment que grandit le point d’aube 25 dans les yeux des bêtes découpées dans la brume tandis que le printemps liseronne3 aux fenêtres Pour ce rendez-vous de notre fin du monde c’est avec toi que je veux chanter sur le seuil des mémoires les morts d’aujourd’hui 30 eux qui respirent pour nous les espaces oubliés 1 Rengaine : refrain populaire, répété sans arrêt, ressassé. 2 Limoneux : recouvert d’un dépôt de terre fertile. 3 Liseronne : néologisme forgé à partir du nom liseron, qui désigne une plante grimpante aux fleurs blanches. 21-FRANTEIN1bis Page 3/8 Vous ferez le commentaire du texte de Gaston Miron extrait de L’Homme rapaillé en vous aidant des pistes de lecture suivantes : 1) Vous montrerez d’abord comment l’expression poétique de l’amour met en relief la sensation du manque ; 2) Vous montrerez ensuite comment la conscience du temps marque dans tout le poème l’espoir des retrouvailles des amants. 2- Contraction de texte (10 points) et essai (10 points) Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle Le candidat traite, compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant l’année, l’un des trois sujets suivants : A - Œuvre : Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I,31. Parcours : Notre monde vient d’en trouver un autre. Texte : Michela Marzano, Visages de la peur, 2009. L’autre dérange et déstabilise. Par sa différence, il dépayse, étonne, surprend, met en danger. Il oblige à s’interroger sur la place que l’altérité occupe dans notre vie et sur celle que nous sommes disposés à lui accorder. Il oblige aussi à regarder de plus près notre « mêmeté »1. C’est alors, cependant, que l’inconnu surgit. La proximité révèle nos faiblesses et nous fragilise : plus on regarde, plus on a peur. 5 L’autre, c’est le contraire du connu, du normal, du prévisible, du même : tout ce qui fait éclater les repères ; tout ce qui dérange les habitudes mentales et force l’étonnement… Mais la peur de l’autre ne fait en réalité que réveiller une peur bien plus profonde, la peur d’une étrangeté irréductible, car présente en chacun de nous. Si l’altérité nous menace et nous terrorise, c’est avant tout parce qu’elle nous renvoie à notre propre ambiguïté. 10 L’étranger n’est pas l’autre, mais la « dissipation2 de toute identité », pour reprendre une formule de Maurice Blanchot. Et lorsqu’on a le sentiment que son identité se dissipe, on ne peut qu’avoir peur. […] Longtemps, la notion d’identité a servi de rempart, afin de distinguer ce qui est à soi de ce qui tient de l’autre, qu’on érige alors en menace. C’est la peur qui nous pousse à mettre 15 des limites afin d’écarter l’étrangeté qui nous menace de l’intérieur et à qualifier l’autre de monstre. C’est l’autre, en effet, qui renvoie toujours à notre angoisse originaire et archaïque d’être envahis et d’éclater. D’où le besoin de mettre des limites, des frontières, des barrières. […] Depuis toujours, c’est la peur de l’autre qui nous pousse à construire des frontières et 20 des murs de séparation. C’est ainsi que les cités antiques et moyenâgeuses s’enfermaient derrière de hauts murs, dressés contre l’étranger. C’est ainsi qu’on érigeait des murailles 1 Selon le philosophe Paul Ricoeur, qui a forgé le mot, la « mêmeté » désigne ce que nous sommes, ce qui nous définit. 2 Dissipation : disparition progressive. 21-FRANTEIN1bis Page 4/8 pour empêcher l’invasion des armées ennemies et l’afflux de populations considérées comme indésirables […]. Mais la tentation du mur n’a pas disparu avec le temps. Elle est au contraire toujours là, 25 malgré les fables contemporaines des années 1990 sur la « fin de l’histoire » en un monde sans frontières. Afin de marquer une ligne de partage qui se voudrait infranchissable entre un « dedans » qui se sent menacé et un « dehors » menaçant, un soi-même apeuré et un autre considéré comme étranger, de multiples murs ont fleuri ces dernières années : le mur long de plus de 1000 km entre les États-Unis et le Mexique voté le 15 décembre 2005 par 30 le Congrès américain ; le mur de séparation entre les populations israélienne et palestinienne décidé par le gouvernement Sharon en 2002 […], etc. Ils indiquent tous le retour de la méfiance à l’égard de l’autre et, de ce point de vue, ils en disent long sur l’ambiguïté du processus de mondialisation. Tandis qu’on valorise les liens d’interdépendance entre les hommes à l’échelle mondiale et que se répand la thèse de 35 l’émergence d’un « village global » où, grâce aux nouvelles technologies de l’information, chacun peut désormais communiquer avec tout le monde, la Terre est traversée par de nouvelles barrières qui limitent le déplacement des individus, en particulier des plus pauvres. D’une part, on consacre la libre circulation des marchandises ; d’autre part, les frontières se ferment aux hommes du Sud. 40 Mais d’autres murs apparaissent et témoignent de la volonté de mettre à l’écart ceux qui n’appartiennent pas à la communauté. C’est ainsi que, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud ou encore en Italie, on voit s’ériger des murs et des fossés : certains visent à isoler des parties de la ville où s’entassent les gens « indésirables » ; d’autres entourent des « communautés closes » (gated communities) où s’enferment 45 certains afin d’être protégés du reste de la population. Dans un monde global, où l’on vante la fin des frontières, certaines « surclasses »3 peuvent habiter, travailler et voyager dans des zones protégées sans être jamais confrontées au reste de la population du monde, en particulier aux plus démunis. Loin des yeux, loin du cœur… C’est une façon de vaincre la peur des autres. Mais le résultat escompté est souvent l’opposé. Au lieu de protéger, les 50 barrières cristallisent les différences, favorisent le repli sur soi et alimentent la peur : la présence du mur porte à croire que l’ennemi est partout, innommable et dangereux, et que tous les moyens sont légitimes pour s’en protéger. (772 mots) Contraction : Vous ferez la contraction de ce texte en 193 mots. Une tolérance de plus ou moins 10% est admise : les limites sont donc fixées à au moins 174 mots et au plus 212 mots. Vous placerez un repère dans votre travail tous les 50 mots et vous indiquerez à la fin de la contraction le nombre de mots qu’elle comporte. Essai : Si l’autre est celui qui fait éclater les repères, quelles réactions sa rencontre peut- elle susciter ? Vous développerez de manière organisée votre réponse à cette question, en prenant appui sur « Des Cannibales » (Essais, I,31) de Montaigne, sur le texte de l’exercice de contraction (texte de Michela Marzano) et sur ceux que vous avez étudiés dans l’année dans le cadre de l’objet d’étude « La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle ». Vous pourrez aussi faire appel à vos lectures et à votre culture personnelle. 3 Surclasses : classes supérieures. 21-FRANTEIN1bis Page 5/8 B – Œuvre : Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX). Parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle. Texte : Michèle Petit, article issu de la conférence « S’accorder au monde », Sciences humaines, janvier 2020. Pourquoi lire des histoires aux enfants ? Ce sont habituellement des arguments « sérieux » et « utiles » qui sont mis en avant : médias, enseignants, chercheurs ou parents expliquent que cette pratique uploads/Geographie/ bt-asie-francais-voie-techno-sujet-bis-21-frantein1bis 1 .pdf
Documents similaires



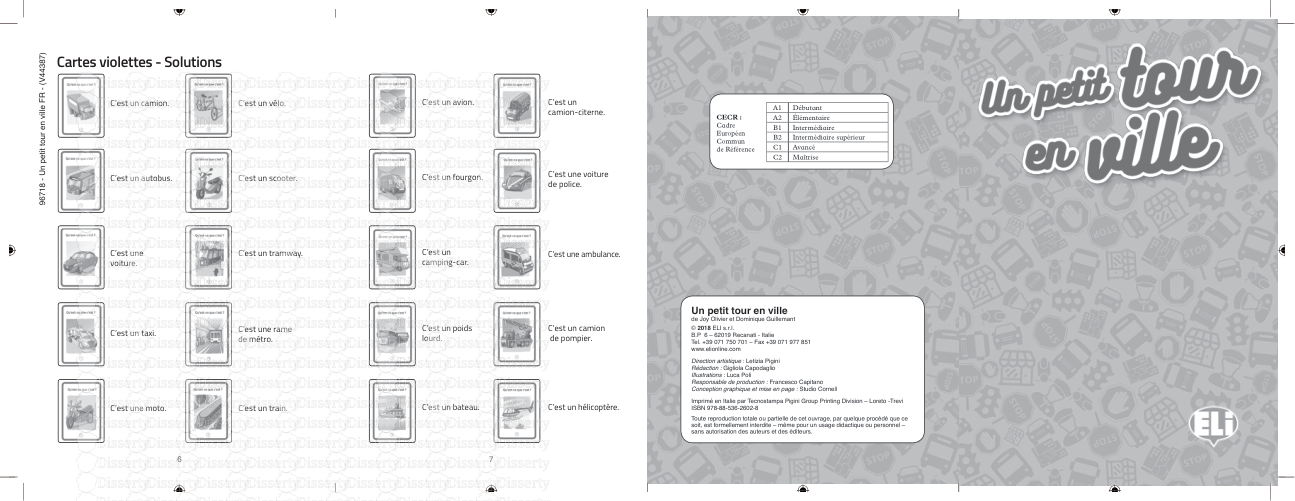






-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 06, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6391MB


