Projet de Loi Convention citoyenne pour le climat (CCC) Se Nourrir Document tra
Projet de Loi Convention citoyenne pour le climat (CCC) Se Nourrir Document transmis aux parlementaires et citoyens 1. Eléments de contexte Le changement climatique est devenu une réalité concrète pour les habitants de notre planète, avec des épisodes de sécheresses répétés et des aléas climatiques, ou des épisodes de grêle de plus en plus fréquents et intenses. Ce sont donc nos agriculteurs qui sont au quotidien parmi les premiers confrontés à ces impacts. Si l’agriculture et la forêt contribuent à hauteur de 19% aux émissions de gaz à effet de serre de la France, soit 85 MteqCO2 / an, c’est aussi un secteur capable de contribuer significativement à la lutte contre le changement climatique : l’agriculture et la forêt stockent 30 MteqCO2 / an. Comme le rappel le rapport spécial du GIEC sur les terres, les sols avec leur couvert végétal absorbent chaque année 30% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Au travers de leurs propositions formulées dans le cadre du bloc « Se Nourrir », les citoyens souhaitent garantir un système permettant une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment en rendant efficiente la loi EGALIM. Ils souhaitent accélérer la mutation de notre agriculture pour en faire une agriculture plus durable et faiblement émettrice de gaz à effet de serre, basée sur des pratiques agroécologiques. Cet objectif a guidé la construction du plan France relance qui dispose d’un bloc « Accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation saine durable et locale pour tous les français». Doté d’une enveloppe de 1,2 milliards d’euros, il permettra notamment de d’accélérer la transition agroécologique grâce à du matériel plus performant ou au développement de l’agriculture biologique et HVE, de structurer les filières locales, de renforcer les circuits courts, de favoriser l’alimentation de qualité dans les cantines. Les agriculteurs français se sont engagés depuis de nombreuses années dans cette transition agroécologique. Elle porte déjà ses fruits et des résultats visibles partout sur le territoire. Cette dynamique se traduit par le nombre d’exploitations et de surfaces engagées dans l’agriculture biologique, et plus récemment par le développement des certifications environnementales. La Loi Egalim fixe un objectif de 15% de la SAU en bio en 2022. Depuis 5 ans, la surface en agriculture biologique a doublé pour atteindre en 2019 2,3 millions d’hectares cultivés en bio soit 8,5 % de la SAU française. Elle a augmenté de 13% dans les deux dernières années et mobilise sur le seul secteur de la production 47 196 producteurs en 2019. La certification Haute Valeur Environnementale (HVE) concernait 1 518 exploitations au 1er janvier 2019 et 8 218 au 1er juillet 2020. Le nombre d’exploitations certifiés a donc été multiplié par 5,5 en 1 an et demi. Accompagner cette transition agroécologique, c’est aussi donner des débouchés aux produits frais, locaux et durables que la ferme France produit. Les citoyens invitent à juste titre à renforcer à la fois les actions en direction de la restauration hors domicile et de la restauration à domicile. C’est tout le sens de la loi EGALIM et des actions que le Gouvernement porte, en particulier à travers le plan France Relance, pour favoriser la structuration de filières locales, l’approvisionnement en produits frais, locaux, de qualité et durables dans les cantines notamment, mais aussi en les mettant en avant dans les différents lieux de vente avec l’objectif de les rendre plus accessibles à tous. 2 Le Gouvernement s’engage aussi pour la protection et la gestion durable des forêts, avec des mesures qui n’étaient pas explicitement proposée par la Convention Citoyenne, pour renforcer la contribution de la forêt au piégeage du carbone. Le plan de relance prévoit en effet un grand plan de reboisement à hauteur de 155 M€, qui permettra d’accroitre encore davantage la contribution de l’agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique. 2. Rappel des propositions législatives de la Convention citoyenne pour le climat PROPOSITION SN1.1.6 : Passer à un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique à partir de 2022 y compris dans la restauration collective à menu unique PROPOSITION SN1.1.7 : Étendre toutes les dispositions de la loi EGalim à la restauration collective privée à partir de 2025 PROPOSITION SN 2.1.3 : Engrais azotés : Augmenter la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) PROPOSITION SN 2.1.5. Aider à la structuration de la filière des protéagineux PROPOSITION SN2.4.1 : mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de L'atteinte de la performance climat du plan stratégique NATIONAL (PSN) PROPOSITION SN 2.4.2 : mettre en compatibilité le PSN avec la SNBC (bas carbone), SNDI (déforestation importée), SNB (biodiversité) PROPOSITION SN5.2.1 : Mieux informer le consommateur en renforçant la communication autour du PNNS et réformer le PNNS en PNNSC PROPOSITION SN 5.3.1 : Réformer le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés et en mettant en place un label pour les produits issus de l’agriculture agro écologique 3. Proposition de contenu du PJL CCC Choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique (SN1.1.6) La Convention propose qu’un choix végétarien quotidien soit prévu dans les self-services pour l'ensemble de la restauration collective publique, dès janvier 2022. En ce qui concerne les cas de restauration collective à menu unique, cantines scolaires notamment, elle souhaite que ce choix soit également rendu possible, éventuellement sous certaines conditions afin d'en faciliter l’organisation : par exemple sous forme d'une inscription préalable. Le Gouvernement proposera de mettre en place une expérimentation sur la base du volontariat à partir de septembre 2021 pour qu’un choix végétarien soit proposé dans l’ensemble de la restauration collective publique. Cette expérimentation sera mise en place pendant 2 ans et sera accompagnée d’une évaluation sur plusieurs éléments clés que sont ses impacts sur les apports nutritionnels, sur le gaspillage alimentaire, sur le coût pour les usagers et sur la fréquentation de ces restaurants. L’objectif de ce dispositif est donc de ne pas lancer un dispositif obligatoire sans avoir de recul sur l’impact qu’il pourrait avoir en termes de santé publique, en particulier pour les populations vulnérables (enfants et personnes âgées), en termes de gaspillage sur les volumes induits par ces menus supplémentaires, en termes de faisabilité pour les petites collectivités, en termes d’impact sur les objectifs d’EGALIM d’augmenter la qualité des produits utilisés… 3 Cette expérimentation vise à laisser la possibilité aux collectivités territoriales, qui sont celles qui décident concrètement de l’organisation de la restauration collective publique dans la plupart des cas, le soin de mettre en place un choix de menu végétarien quotidien, selon la réalité du terrain (dans le cadre de petites cantines avec un menu unique, où pour vérifier que cette nouvelle règle n’induit pas du gaspillage alimentaire supplémentaire par exemple). Certaines sont d’ores et déjà en avance, et les autres pourront les rejoindre dans cette dynamique. Extension des dispositions d’EGALIM à la restauration collective privée (SN1.1.7) La Convention souhaite étendre à partir de 2025 les dispositions de l’article 24 de loi EGalim relatives à l’approvisionnement durable et de qualité à toute la restauration collective privée. Le Gouvernement a intégré cette mesure dans le projet de loi. Taxe engrais azotés (SN 2.1.3) La CCC souhaite mettre en place une redevance sur les engrais azotés pour réduire leur utilisation, tout en rappelant qu’un telle taxe est « Un moyen pratiquement pas utilisé en Europe : cinq pays européens ont instauré par le passé des mesures de taxation des engrais azotés : la Finlande, la Suède, l’Autriche, la Norvège et les Pays-Bas. Ces expériences ont été par la suite abandonnées, en général au moment de l’adhésion du pays concerné à l’Union européenne, dans un objectif de réduction des distorsions fiscales. L’augmentation d’une taxe existante ou l’introduction d’un dispositif nouveau serait de nature à nuire à la compétitivité de l’agriculture française et donc difficilement acceptable. » Le Gouvernement a décidé d’intégrer dans le projet de loi des dispositions pour réduire les émissions liées aux engrais azoté, à la fois en raison de leur impact sur le climat et sur la qualité de l’air. Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera définie conformément à nos objectifs européens, et si elle n’est pas respectée, une taxe entrera en vigueur à partir de 2024 en cas d’échec des mesures incitatives de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, et si la France ne parvient pas à faire adopter une telle mesure au fiscal au niveau européen. Cette proposition a vocation à permettre une transition radicale mais non brutale en prenant en compte la volonté des citoyens de ne pas nuire à la compétitivité de l’agriculture française. Le principe d’une taxe sur les engrais azotés entrera donc en vigueur si les objectifs que nous nous sommes fixés ne sont pas respectés et si cette taxe n’est pas adoptée au niveau européen. Le gouvernement a fait ce choix pour obtenir des résultats tangibles et concrets en matière de réduction des émissions, sans toutefois mettre en danger la compétitivité des agriculteurs français qui sont en concurrence, en Europe et uploads/Geographie/ document-de-travail-du-groupe-quot-se-nourrir-quot.pdf
Documents similaires


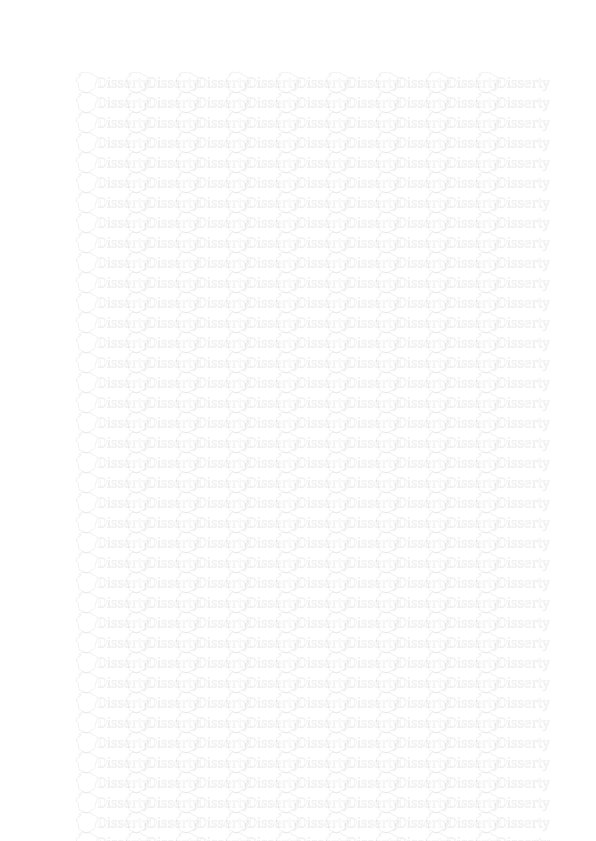







-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 06, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7440MB


