Despa Lucian-Andrei 1500-2016 Histoire politique de l’Amérique Latine Introduct
Despa Lucian-Andrei 1500-2016 Histoire politique de l’Amérique Latine Introduction: le profil d’un continent Les Etats latino-américains Amérique du Nord Mexique – Mexico City, indépendant 1821 Amérique Centrale Guatemala – Guatemala City, 1821 (Empire Mexicain 1821-1823, République Fédérale de l’Amérique Centrale 1821-1838) El Salvador – San Salvador, 1821 (Empire Mexicain 1821-1823, République Fédérale de l’Amérique Centrale 1821-1838) Honduras – Tegucigalpa, 1821 (Empire Mexicain 1821-1823, République Fédérale de l’Amérique Centrale 1821-1838) Nicaragua – Managua, 1821 (Empire Mexicain 1821-1823, République Fédérale de l’Amérique Centrale 1821-1838) Costa Rica – San José, 1821 (Empire Mexicain 1821-1823, République Fédérale de l’Amérique Centrale 1821-1838) Panama – Panama City, 1903 (Colombie 1821-1903) Caraïbes Cuba – Havana, 1898-1902 Haiti – Port aux Princes, 1804 République Dominicaine – Santo Domingo, 1821 (Haiti 1822-1844) Amérique du Sud Venezuela – Caracas, 1821 (Grande Colombie 1821-1829) Colombie – Bogota, 1819 (Grande Colombie 1819-1831) Equateur – Guayaquil, 1822 (Grande Colombie 1822-1830) Pérou – Lima, 1824 (Confédération péruvo-bolivienne 1836-1839) Bolivie – La Paz, 1825 (Confédération péruvo-bolivienne 1836-1839) Pays andins Brésil – Brasilia, 1822 Paraguay – Asunción, 1811 Argentine – Buenos Aires, 1810 Chili – Santiago, 1818 Uruguay – Montevideo, 1828 Belize (British Honduras), colonie britannique indépendante en 1981 et membre du Commonwealth Jamaïque, colonie britannique indépendante en 1962 et membre du Commonwealth Puerto Rico, territoire au statut intermédiaire dépendant des Etats-Unis en tant qu’Etat Libre Associé Bahamas, colonie britannique indépendante en 1973 et membre du Commonwealth Guyana, colonie britannique indépendante en 1966, membre du Commonwealth depuis 1970 Suriname, colonie néerlandaise indépendante en 1975 Guyane Française, DROM (Département et Région d’Outre-Mer), Région Ultrapériphérique (RUP) de l’UE, dépendant de la France Considérations démographiques La Conquête espagnole au XVIe siècle se traduit par un effondrement démographique d’une telle magnitude qu’il faudra attendre le XXe siècle pour que le sous-continent latino-américain retrouve des taux de population comparables à ceux de l’ère précolombienne. Les causes de ce phénomène sont complexes, des mauvais traitements systématiques auxquels les amérindiens sont soumis1 au choc bactériologique contre laquelle les populations indigènes n’étaient pas immunisées. En 1500, l’Amérique du Sud contenait environ 20% de la population mondiale, mais sa croissance démographique normale a été mutilée par le colonialisme espagnol : ainsi, en 1900, le sous-continent représente moins de 4% (3, 61%) de la population globale. Jusque dans les années 1930, la démographie latino-américaine reste de type ancien (démographie naturelle, pré-transitionnelle), avec des taux de mortalité et de natalité très élevés de neutralisant réciproquement. La récupération démographique se réalise lentement jusqu’au milieu de XIXe siècle ; l’immigration y contribuera de façon décisive. Il faut néanmoins faire la différence entre l’immigration d’origine 1 Hormis les morts violentes non-naturelles qui ont fait grimper les taux de mortalité, cela a eu comme effet de réduire sensiblement le rythme des naissances : ex – ethnie des Taïnos, pratiquement annihilée en moins de 30 ans Cône Sud européenne (provenant essentiellement de l’Europe latine) et les flux de populations africaines disloquées et déplacées par la traite négrière entre le XVII et le XVIIIe (voire même le XIXe pour certains territoires antillais comme Cuba). Cette dernière concerne surtout les territoires antillais et brésiliens sur la façade atlantique. L’immigration européenne fait éclater au XIXe siècle les axes traditionnels de mobilité liant les métropoles aux anciennes colonies. Les schémas se diversifient tandis que la mobilité transatlantique se massifie, encouragée encore par la politique d’ouverture des Etats, qui mettent sur pieds des agences d’immigration sur le continent européen. Mais le bilan est très inégal : 3 pays, le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine, absorbèrent plus de 75% du solde migratoire. Le Pérou et le Brésil connaissent également une immigration d’origine japonaise, les gouvernements nippon et péruvien signant en 1897 un accord ouvrant la côte pacifique aux agriculteurs japonais. Le sous-continent latino-américain est en outres marqué par de très forts déséquilibres démographiques, qui engendrent un peuplement en archipel s’inscrivant dans la très longue durée. Au niveau continental, les 3 pays les plus peuplés, le Brésil, le Mexique et l’Argentine, concentrent près de 60% de la population totale. Le pays le plus peuplé, le Brésil, contient plus de 30%. Les densités restent très faibles, autour de 30 hab. par km2, alors que la densité terrestre moyenne est de 49 hab. par km2. Les pays de l’Amérique Centrale et Antillaise ont des densités nettement supérieures à celles de l’Amérique du Sud. Les hinterlands sont quasiment dépeuplés – on constate deux principales axes de peuplement le long de la façade atlantique (prolongé par l’aire antillaise) et le long de la Cordillère andine et méso-américaine. Un peuplement axial mais intérieur s’est également opéré le long du Rio de la Plata et de sa pénétrante le Rio Parana, dont l’importance commerciale provoqua la médiation anglaise lors de la guerre entre l’Argentine et le Brésil au début du XIXe siècle – médiation qui aboutit à la création d’un Etat-tampon, l’Uruguay, en 1828. Les centres urbains La culture occidentale se concentre dans les grands centres urbains coloniaux, tel que Lima et Mexico. Au début du XXe siècle, le système urbain reposait toujours sur des structures mises en place durant l’époque coloniale – à savoir un maillage urbain rudimentaire, avec une ville centre administratif, économique et politique, et une multitude de villes front pionnier, fondée dans le but de dominer et d’explorer le vaste hinterland. Durant la seconde moitié du XXe siècle se développent les géants urbains sud-américains (Mexico, 22 M d’habitants ; Sao Paulo, 21 M ; Buenos Aires, 13 M), témoins du décollement économique et du dynamisme urbain du continent. Cet essor rapide est du également au fait que l’Amérique Latine connait simultanément et avec la même force la transition démographique notensteinienne et la transition urbaine : les villes subissent donc la double pression de leur dynamisme démographique interne et celles des espaces ruraux qui se vident. Le pic de croissance démographique est atteint entre 1960 et 1980 : en vingt ans, Mexico passe de 5 M d’habitants à plus de 12 M ; Sao Paulo connait une croissance de 50% (de 7 M à 14 M) entre 1970 et 1990. Ce phénomène est en décélération, l’Amérique Latine évoluant vers un schéma post-transitionnel selon le modèle européen et nord-américain. L’héritage complexe de la latinité Utopie européenne dès la Découverte, l’Amérique Latine va servir de toile aux fantasmes du Vieux Monde ; l’historien mexicain Edmundo O’Gorman formule même la thèse de l’ « invention » de l’Amérique par l’Europe. Mais la relation entre les deux « mondes » est plus ambigüe que cela, et le Vieux Monde va exercera avec au moins autant de puissance son magnétisme sur l’Amérique, et plus particulièrement sur l’Amérique Latine qui vivra moins intensément que celle anglo-saxonne son prétendu particularisme et unicité. Par son nom même, l’Amérique Latine revendique et se rattache à l’héritage culturel de l’Europe. Suite à l’érosion lente mais inexorable des cultures indigènes précolombienne (acculturation qui s’opérait principalement par une pratique religieuse et linguistique entièrement dictée et dirigée par les nouvelles élites européennes), l’Amérique Latine développe une culture mimétique. La culture politique, au moins au niveau superficiel des programmes et des idéologies, semble confirmer ce schéma. Le libéralisme parvenu à sa maturité en Europe est adopté presque systématiquement par les élites indépendantistes. Ce libéralisme, regardé par nombre de politistes comme un libéralisme purement formel, se construit autour de deux pivots doctrinaux : l’anticléricalisme et le nationalisme anti- hispanique. Ce libéralisme, comme le libéralisme pré-utilitariste en Angleterre et pré-solidariste en France, n’a aucun contenu social. Le conservatisme s’érige en défenseur d’une conception de l’identité américaine dans la filiation directe de l’héritage hispanique, avec un accent particulier sur les traditions catholiques et militaires. Le socialisme pénètre la réflexion politique à la fin du XIXe siècle, avec à peine quelques dizaines d’années de retard sur l’Europe. À la gauche des libéraux se forment des partis « radicaux » ou « démocrates », forts dans les rangs des classes moyennes, défendant un programme de réformes sociales et politique (suffrage universel). Les premiers partis explicitement ouvriéristes prennent corps dans les pays du Cône Sud où l’immigration européenne est plus importante. L’Amérique Latine connaitra, comme le Vieux Continent, le phénomène du sinistrisme, les socialistes et démocrates étant rejetés à droite par une nouvelle nébuleuse de gauche, plus proche du communisme marxiste qui forme le cœur du système, mais qui voit également éclore plus marginalement de mouvements anarchistes, maoïstes (Sandero Luminoso au Pérou), trotskystes (le POR bolivien, mais également puissants notamment au sein du syndicat des travailleurs des mines boliviens, le FSTMB). Les arts et la littérature aussi vivaient au rythmes des modes intellectuelles venues d’Europe ; en témoigne la popularité des bourses d’études en Espagne, en Italie et en France ; la littérature avait évacué le parler populaire et les expressions indigènes. Le XIXe siècle, du romantisme à l’esthétisme décadentiste, en passant par le réalisme de facture balzacienne, est par excellence un siècle « européen ». Mais cela ne doit pas occulter le fait que derrière ces –ismes européanisants on retrouve des réalités politiques et culturelles uniques, issues d’une expérience historique qui n’est nullement un simple reflet des évolutions européennes. Le romantisme, courant uploads/Geographie/ histoire-politique-de-lamerique-latine-curs-preda.pdf
Documents similaires

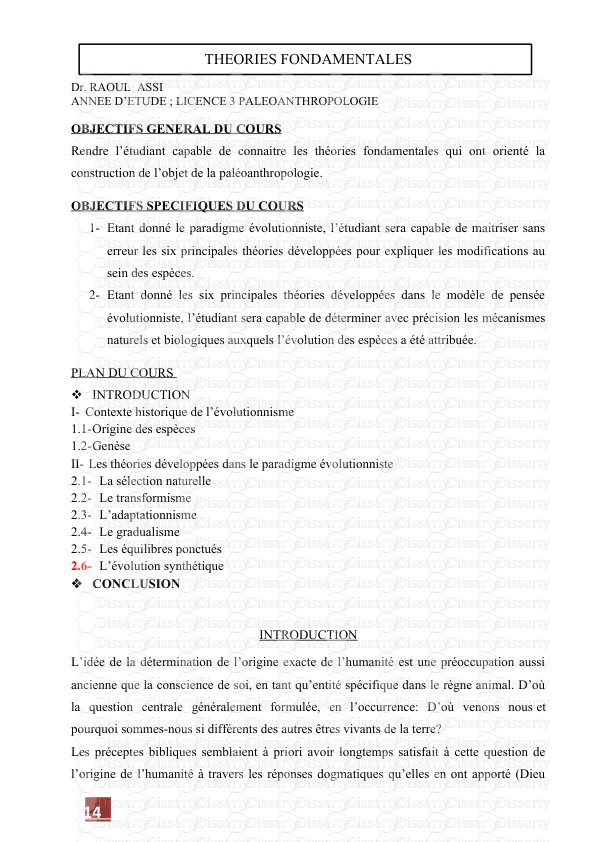








-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 20, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.5117MB


