UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS LE REGARD FRANÇAIS SUR LES ENVOYÉS
UNIVERSITE PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS LE REGARD FRANÇAIS SUR LES ENVOYÉS MAROCAINS DU XVIIe ET XVIIIe SIECLES Mémoire de D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) rédigé par Rabih SAIED Sous la direction de : Jean-Pierre DUTEIL Année : 1999-2000 1 LE REGARD FRANÇAIS SUR LES ENVOYÉS MAROCAINS DU XVIIe ET XVIIIe SIECLES Mémoire de D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) rédigé par Rabih SAIED 2 Remerciements Je remercie Monsieur Jean-Pierre Duteil, professeur en histoire moderne à l’université Paris VIII Vincennes Saint-Denis et Monsieur Ousama ZOUGARI, chercheur et enseignant en histoire au Lycée Mohammed V à Taroudannt (Maroc) pour leur aide, leur conseil et leur soutien respectif qui furent indispensables à la réussite de ce mémoire. Je tiens à remercier enfin le personnel des Archives Nationales, des Affaires Etrangères, de la Bibliothèque Nationale de France et de la Bibliothèque Richelieu à Paris et de l’Institut du Monde Arabe également à Paris pour leur chaleureux accueil. 3 INTRODUCTION 4 Chaque année la France accorde un intérêt particulier à un pays étranger. Cette sollicitude de « l’autre » se manifeste alors de diverses façons. Plusieurs manifestations culturelles ont lieu dans la capitale et dans les villes de province. C’est en effet l’occasion de réaliser des expositions, des spectacles, des colloques, des livres et des films. Jouissant d’une publicité médiatique, cela crée ainsi l’événement culturel de l’année et pousse la curiosité des gens à s’y intéresser. Il arrive d’ailleurs que cet avant goût donne l’envie de voyager et de voir en vrai ce qui est admiré en France. L’année 1999-2000 est celle du Maroc. La culture et l’histoire de cet État se différencient par rapport aux autres pays maghrébins. Le Maroc à l’inverse de l’Algérie et de la Tunisie ne subit pas la domination de l’Empire ottoman. En outre par rapport aux autres, le Maghreb Al-Aqça rejoint tardivement l’empire colonial français (1912). De plus le protectorat ne dure qu’une quarantaine d’années. La France n’a pas non plus considéré de la même manière le Maroc et l’Algérie (divisée en départements français). L’empreinte française est donc moins présente au Maroc qu’en Algérie (colonisée de 1830 à 1962). Le Maghreb Extrême a par conséquent conservé plus de particularismes par rapport à ses voisins qui ont subi pendant de nombreux siècles les dominations étrangères. Depuis l’accession à l’indépendance de ce pays en 1956, un nombre important d’immigrés marocains s’est installé en France. Cette population africaine se trouve alors en contact direct avec le peuple français. Toutefois 5 les ouvrages relatifs à cette deuxième plus grande communauté musulmane en France restent rares. Leur religion amène cependant énormément de discussions dans la société française : l’affaire du foulard islamique à Creil dans l’Oise en 1989 est un exemple. Les livres et les articles sur l’islam – deuxième religion dans l’Hexagone – et surtout sur l’intégrisme musulman se sont multipliés depuis une vingtaine d’année. L’image de cette religion et de ses adeptes s’accompagne en outre dans la rue le plus souvent de clichés et de préjugés hostiles. C’est dans ce contexte que se pose une interrogation historique essentielle : celle de la relation avec autrui. La découverte du Maroc et de la culture marocaine basée sur l’islam par les Français pose en effet la question. Quelles sont les origines du regard de ces Européens porté sur les Marocains venus en France ? Pour répondre il faut retourner dans le passé et précisément à l’époque moderne. Pourquoi ? C’est tout simplement parce qu’au XVIIe et au XVIIIe siècles, les premiers Marocains voyagent en France. Ils ne restent pas pour une longue période puisqu’ils ont la fonction d’ambassadeur ou de simple envoyé chargés par leur souverain de remplir une mission. Ainsi à partir des représentants du sultan venus en France, il est plausible d’examiner les impressions et les sentiments des Français à l’égard de « l’autre » marocain. 6 L’envoyé du sultan n’est pas évidemment l’archétype du Marocain de la période. Il est choisi par son souverain parmi l’élite du Maroc. Il est chargé de défendre les intérêts de son maître et de son pays à l’étranger. Toutefois la perception des Français à l’égard de ces représentants – qui viennent d’une partie de l’Afrique islamisée – reste tout de même indissociable du regard porté sur leur peuple en général. Ces musulmans marocains créent en effet l’événement en arrivant en terre chrétienne. Les sources françaises sur lesquelles se fondent les réponses sont de différentes natures. Elles émanent d’abord des autorités politiques de l’époque. En premier lieu, un intérêt particulier est porté aux correspondances des consuls de France au Maroc. Ces derniers sont généralement les premiers au contact des envoyés du sultan. Ils informent alors minutieusement par l’intermédiaire de lettres et de mémoires le secrétaire d’État à la Marine sur les intentions du sultan d’envoyer une mission en France. Deuxièmement, il faut s’arrêter sur les lettres laissées par les marins chargés de transporter les ambassadeurs. Les capitaines de vaisseaux écrivent à leur supérieur pour leur rendre compte du déroulement du voyage. Les intendants des ports – principalement de Brest et de Marseille – sont aussi chargés de fournir des nouvelles des Marocains. Enfin la correspondance de la Chambre de Commerce de Marseille avec les consuls au Maroc et le pouvoir central demeure aussi primordiale. Certains Français – notamment les secrétaires interprètes du roi en langues orientales – accompagnent troisièmement les Marocains pendant leur trajet jusqu’à la 7 capitale. Ils gardent alors le contact avec le pouvoir central par courrier. Il est possible d’y ajouter les nouvelles transmises par les intendants et les présidents de parlements de la province qui ont accueillis ces Africains. Les introducteurs des ambassadeurs constituent la quatrième source originaire du pouvoir. Louis Nicolas Le Tonnelier, baron de Breteuil nommé en 1698 a laissé des mémoires richissimes au sujet des ambassades du Maroc. Les secrétaires d’État et les rois de France ont eux aussi produit de nombreux documents pour répondre à leurs agents en ce qui concerne la présence des Marocains sur le sol français. En dernier lieu, il faut citer les récits de voyage des ambassadeurs du roi de France au Maroc comme ceux du baron de Saint Amant envoyé en 1683 et de François Pidou de Saint- Olon dix ans plus tard. Ils ont en effet rencontré et côtoyé les agents du sultan venus à la cour. Ces documents permettent de connaître en détail le déroulement des missions marocaines. Mais elles sont fortement imprégnées du contexte diplomatique régnant à ce moment entre la France et le Maghreb Al-Aqça. Les sources littéraires constituent la deuxième catégorie. Elles comprennent les écrits des contemporains qui ont évoqués les ambassades et les missions marocaines. Le duc de Saint-Simon, le marquis de Dangeau et le marquis de Sourches leur ont accordé des lignes dans leurs mémoires et journaux. Des captifs et des religieux revenus du Maroc ont également publié des ouvrages engagés et le plus souvent hostiles dans lesquelles ils relatent entre autre la venue des Marocains en France. Ces ouvrages ont pour but de sensibiliser « l’opinion » sur le sort des Français en captivité au 8 Maghreb Extrême. De ce fait il se crée un courant littéraire hostile envers ces musulmans. Voltaire s’est d’ailleurs inspiré de cette littérature pour certains passages concernant le Maroc dans ses contes tels que Candide ou l’optimisme et Histoire des voyages de Scarmentado écrite par lui-même. La dernière sorte de documents écrits semble les sources « journalistiques ». Ce sont en fait les gazettes ou les journaux de l’époque qui accordent des pages à l’événement constitué par la présence de Marocains. Il s’agit du Mercure Galant, du Mercure de France, de la Gazette de France, le Journal de Verdun, la Gazette d’Amsterdam, la Gazette de Rotterdam, l’Histoire journalière de ce qui se passe de plus considérable en Europe et les Nouvelles extraordinaires de divers endroits. Ces écrits ne sont pas innocents. Ils véhiculent une certaine propagande en faveur de la monarchie française. Les sources iconographiques restent enfin la dernière catégorie qui peut nous aider à comprendre le regard français sur « l’autre » marocain à l’époque moderne. Des Français ont effectivement exécuté des portraits des envoyés du sultan et de sa suite ou des scènes les mettant en valeur durant leur ambassade à la cour de France. Les estampes décrivent entre autre les tenues vestimentaires et les traits principaux des Marocains. Mais leur but reste surtout de glorifier le pouvoir royal français. La méthode pour parvenir à cerner le regard porté par les Français à l’encontre des Marocains aux XVIIe et XVIIIe siècles comprend plusieurs niveaux. Il est nécessaire de prendre d’abord en compte toutes les clefs de 9 la vision française sur autrui. Elles comprennent aussi bien celles à l’échelle du pays que celles qui sont au niveau individuel. Il faut séparer et comparer la perception des agents du pouvoir, de celles des littéraires, des anciens captifs, des aventuriers et des religieux. Il semble également indispensable de comparer le regard porté sur les Marocains avec celui porté à l’encontre d’autres musulmans envoyés en France, c’est-à-dire des Régences, de l’Empire Ottoman et de uploads/Geographie/ le-regard-francais-sur-les-envoyes-marocains.pdf
Documents similaires





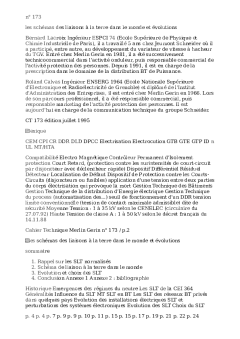




-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 21, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.7822MB


