CHAPITRE Quelles sont les sources de la croissance économique ? 1 > MANUEL, PAG
CHAPITRE Quelles sont les sources de la croissance économique ? 1 > MANUEL, PAGES 16-35 ◗ Réponses aux questions 1. Intérêts et limites du PIB > MANUEL, PAGES 18-19 • Doc. 2 – La dépense de protection de l’environnement 3. Rédigez une phrase présentant les informations apportées par les données concernant la France, puis le Royaume-Uni. En France en 2016, l’indice du PIB/hab. (base 100 pour l’ensemble des pays de l’UE à 28) était en moyenne d’environ 105, ce qui signifie que le PIB/hab. en France était supérieur (en moyenne) de 5 % à celui des pays de l’UE à 28. Toutefois cette moyenne masque des inégalités importantes : dans la région la moins « fortunée » le PIB/hab. ne représente « que » un peu plus de la moitie du PIB/hab. de l’UE à 28 alors qu’en Île-de-France (« Capitale ») il est 1,75 fois plus important que la moyenne européenne. Au Royaume-Uni, le PIB/hab. est en moyenne 8 % supérieur à celui de l’UE, avec là aussi de fortes disparités régionales. À Londres (« Capitale ») le PIB/hab. est 5,6 fois plus élevé que la moyenne européenne, alors que dans la région la moins fortunée, il est inferieur d’environ 10 % à la moyenne européenne. 4. Quels sont les pays ayant les plus fortes inégalités internes de PIB/habitant ? Ceux où elles sont les plus faibles ? Le pays où les inégalités sont les plus fortes est incontestablement le Royaume-Uni, où l’indice s’étale entre environ 90 et 560. Le Portugal et, dans une moindre mesure, la Suède sont beaucoup moins inégalitaires. 5. Expliquez pourquoi, selon ce document, le PIB/habitant est un indicateur imparfait du niveau de vie. Si l’on utilise le PIB/habitant pour évaluer le niveau de vie d’un pays, on risque de négliger le fait que ces moyennes cachent des disparités parfois importantes à l’intérieur d’un même pays (comme c’est notamment le cas au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne ou encore en France.) 4. Le progrès technique au cœur de la croissance > MANUEL, PAGES 24-25 • Doc. 1 – Innovation et progrès technique 1. Quelles innovations les tablettes ont-elles apportées ? 2. Montrez que les tablettes sont un exemple de progrès technique. Les tablettes sont des innovations de produit. Elles sont donc un exemple de progrès technique, puisque celui-ci désigne l’ensemble des innovations. 3. Pourquoi l’invention des tablettes a-t-elle pu être source de croissance économique ? Elles ont été sources de croissance économique, d’une part parce qu’on a produit des biens qui n’existaient pas auparavant (cf. ventes mondiales de tablettes qui sont passées en 4 ans de 145 millions à environ 225 millions entre 2012 et 2014, soit une progression en seulement 2 ans de 55 %), et d’autre part parce qu’elles ont généré des revenus supplémentaires alimentant davantage de dépenses, donc de consommation et/ou d’investissements, et donc ont participé à la hausse de la production mondiale. TD 2 – Des indicateurs alternatifs au PIB > MANUEL, PAGE 29 • Doc. 1 – L’IDH et ses composantes pour quelques pays en 2015 Erratum : Les statistiques des colonnes sur la durée moyenne de scolarisation (en années) et sur la durée attendue de scolarisation (en années) sont inversées. Par exemple, pour la Norvège, il faut lire : - durée moyenne de scolarisation (en années) : 12,7 - durée attendue de scolarisation (en années) : 17,7 1. Rédigez des phrases présentant les informations apportées par chacune des données en rouge. En 2015, avec un IDH de 0,897, la France est en 21e position des pays en fonction de leur IDH. Cette même année, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 82,4 ans (il s’agit du nombre d’années qu’un nouveau-né peut espérer vivre si les taux de mortalité par âge ayant prévalu au moment de sa naissance demeurent inchangés tout au long de sa vie). Toujours en 2015, la durée moyenne de scolarisation s’est élevée à 11,6 ans (c’est-à-dire que les personnes âgées de 25 ans et plus ont eu en moyenne 11,6 ans d’éducation), alors que la durée attendue de scolarisation des enfants d’âge scolaire est de 16,3 ans (autrement dit, un enfant en âge d’entrer à l’école peut espérer bénéficier – si les taux de scolarisation par âge devaient rester inchangés tout au long de la vie de l’enfant – de 16,3 ans de scolarisation). En 2015, un habitant avait en moyenne un revenu national brut de 38 085 $ PPA constants de 2011. 2. Comparez le RNB/habitant de la Norvège à celui du Qatar. Comment s’explique leur différence de classement en termes d’IDH ? En 2015, le Qatar dispose d’un RNB/hab. de 129 916 $ PPA constants de 2011, contre 67 614 $ pour la Norvège. La population qatarie a donc un niveau de vie en moyenne très supérieur à celui des Norvégiens (1,92 fois plus important). Toutefois, la Norvège est largement mieux positionnée en termes d’IDH (1er rang contre 33e pour le Qatar). Cette différence s’explique par le fait que les dimensions santé et éducation sont plus favorables à la Norvège : espérance de vie supérieure de 3,4 ans, durée moyenne de scolarisation et durée attendue de scolarisation supérieures respectivement de 2,9 ans et de 4,3 ans. 3. Cherchez, dans ce tableau d’autres exemples de pays à RNB/habitant proches, mais à IDH très différents. On peut citer le cas de la Syrie et de la Côte d’Ivoire (22 places d’écarts dans le classement en termes d’IDH, avec pourtant des RNB/hab. très proches). 4. Comparez l’IDH du Congo à celui de la Guinée équatoriale. Leur niveau de développement humain provient-il des mêmes facteurs ? Justifiez votre réponse. L’IDH du Congo et celui de la Guinée équatoriale sont identiques (0,592), mais leur « niveau » de développement ne provient pas des mêmes facteurs. Ainsi, la Guinée équatoriale a un RNB/hab. presque 4 fois plus important que le Congo. En revanche, le Congo « fait largement mieux » en matière d’espérance de vie à la naissance (écart de 5 ans !) et d’éducation. • Doc. 2 – L’IDH par catégorie de pays en 2015 Erratum : Les statistiques des colonnes sur la durée moyenne de scolarisation (en années) et sur la durée attendue de scolarisation (en années) sont inversées. Par exemple, pour les pays au développement humain très élevé, il faut lire : - durée moyenne de scolarisation (en années) : 12,2 - durée attendue de scolarisation (en années) : 16,4 5. En vous appuyant sur le document 6 p. 19, rappelez ce qui caractérise les pays à développement humain faible. Les pays à niveau de développement faibles sont ceux du dernier quartile, autrement dit, comme il y a en 2015 188 pays de recensés dans ce classement du PNUD, il s’agit des 47 pays à l’IDH le plus faible. 6. Rédigez une phrase présentant l’information apportée par chacune des données en rouge. En 2015, les pays à développement élevé avaient en moyenne un IDH de 0,746. La même année, la durée moyenne de scolarisation dans les pays à développement humain faible s’élevait à 4,6 années. Enfin, le RNB/hab. mondial s’élevait en moyenne à 14 447 $ PPA de 2011. ◗ Bac > MANUEL, PAGES 33-35 Épreuve composée II. Étude de documents Vous présenterez le document, puis vous montrerez comment a évolué la productivité globale des facteurs en France depuis 1990. Ce document est un graphique composé de deux courbes retraçant chacune l’évolution de la productivité globale des facteurs (PGF) en France sur la période 1990-2016 : l’une est exprimée en indices base 100 en 1990 (échelle de gauche), l’autre exprime les variations annuelles de la PGF en %. Ce graphique a été publié en 2017 et est issu de plusieurs sources : Datastream, Insee, AMECO, OCDE et Natixis. L’analyse de ce graphique peut nous permettre ainsi de décrire les évolutions de la PGF. On peut tout d’abord noter la hausse globale sur la période de la PGF puisque l’indice passe de 100 en 1990 à environ 113 en 2016. Autrement dit, en 26 ans, la PGF a globalement progressé de 13 % en France. On peut toutefois remarquer que cette hausse n’est pas linéaire, comme nous le montrent les taux de variation annuels. Ainsi, si le plus souvent, ces taux de variation sont positifs, soulignant une hausse de la PGF, on peut noter qu’ils sont à plusieurs reprises négatifs. Ce fut par exemple le cas en 1991, où la PGF recule de 1 %, ou encore en 2009, avec une baisse de 4 %. À noter que, ces mêmes années, on constate logiquement une baisse de la courbe représentant la PGF en indices. Enfin, si la tendance est clairement à la hausse, on peut aussi remarquer que cette hausse s’est quelque peu ralentie depuis la fin des années 2000, puisque la pente de la courbe en indice est moins forte que sur les années précédentes. D’ailleurs, on peut aussi voir cette rupture grâce aux taux de variation qui sont en moyenne plus faibles. CHAPITRE Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? 2 > MANUEL, PAGES 36-55 uploads/Geographie/ nathansesterm-2018-corrigesmanuelslycee.pdf
Documents similaires



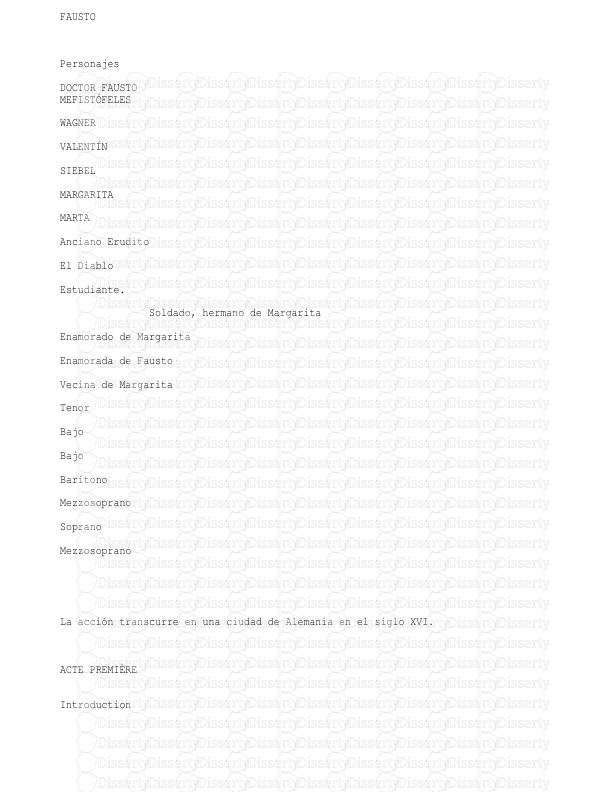






-
37
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 26, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 5.0689MB


