Reçu, par email, de M. Robert Berrouët-Oriol, Linguiste-terminologue Au moment
Reçu, par email, de M. Robert Berrouët-Oriol, Linguiste-terminologue Au moment où se tiennent, en Haïti, les « Assises nationales sur la qualité de l’éducation », il est tout à fait indiqué de lire ou de relire ce que les linguistes haïtiens proposent quant à la nécessaire refondation du système éducatif national. Depuis nombre d'années et en particulier depuis le séisme de 2010, plusieurs linguistes haïtiens soutiennent une vision et une pragmatique de refondation du système éducatif national fondées sur l'aménagement linguistique, sur la résolution conséquente du « problème linguistique haïtien » diagnostiqué dès les années 1960 par le réputé linguiste Pradel Pompilus. Alors, faut-il espérer que la dimension linguistique durant ces « Assises nationales », plutôt que d'être encore une fois ignorée, sera inscrite au programme et amplement abordée ? On saura assez tôt si cette énième conférence ciblant l'éducation en Haïti sera une nouvelle « opération cosmétique » : parviendra-t-elle à mettre en lumière le rôle moteur de l'État --donc des décideurs politiques--, dans l'énoncé d'une future politique linguistique articulant une claire vision de la qualité de l'aménagement du créole et du français au pays ? Sous l’angle précisément de la qualité de l’éducation, existe-t-il, en avril 2014, une politique linguistique de l’État haïtien dans le domaine de l’éducation ? Les « Assises nationales sur la qualité de l’éducation » sont-elles en train d’aborder une question aussi centrale ou énoncent-elles les mêmes généralités, les mêmes « discours cosmétiques » qui alimentent ce type de rencontre depuis des décennies ? À ce chapitre, notre contribution à nous linguistes mérite d’être réentendue et examinée. Il est tout à fait indiqué, dans le contexte de ces « Assises nationales », de lire ou de relire le texte de la conférence intitulée « L’école en créole, en français, dans les deux langues ? État de la question et perspectives » (cliquer sur le titre de l'article, pour y accéder, par le lien actif du site www.berrouet-oriol.com). Cette conférence a été prononcée lors de la Table- ronde de l'Association des enseignants haïtiens du Québec (AEHQ), à Montréal, le 16 octobre 2011. Bien cordialement, Robert Berrouët-Oriol Linguiste-terminologue Site Internet : www.berrouet-oriol.com Montréal, le 8 avril 2014 Voir aussi : Robert Berrouët-Oriol et al. L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions (Éditions du Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti. Montréal/Port-au-Prince 2011). Aménagement du créole et du français en Haïti L’école en créole, en français, dans les deux langues ? État de la question et perspectives Par Robert Berrouët-Oriol Pour contribuer de manière constructive à la réflexion de la table-ronde d’aujourd’hui dont le thème est «L’école en créole, en français, dans les deux langues? État de la question et perspectives», je caractériserai la situation linguistique haïtienne sur quatre axes principaux. Ces quatre axes analytiques constituent la charpente à partir de laquelle notre vision est construite, et cette vision légitime et donne lieu à une perspective centrale –l’aménagement des deux langues officielles d’Haïti à l’échelle du pays tout entier. Et c’est à partir de cette vision centrale que j’interrogerai le sous-ensemble «aménagement des langues officielles dans le système éducatif national». Le fil conducteur de ma pensée sera donc le suivant: l’État haïtien doit-il adopter sa première législation contraignante en matière d’aménagement linguistique afin de légitimer et d’encadrer l’aménagement et du créole et du français dans le système éducatif national, de la maternelle à l’enseignement secondaire, universitaire et technique? La démarche analytique1, que je souhaite partager avec vous, expose la configuration linguistique haïtienne dans les termes suivants : 1- un patrimoine linguistique national historiquement constitué en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominant du français et à la minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale; 2- une exemplaire insuffisance de provisions constitutionnelles au regard de l’aménagement linguistique, insuffisance en phase avec le déni des droits linguistiques de l’ensemble des locuteurs haïtiens; 3- l’inexistence –conséquence du déficit de vision et de leadership de l’État--, d’une politique linguistique publiquement énoncée et promue, préalable à la mise en œuvre d’un plan national d’aménagement des deux langues haïtiennes; 4- la perduration d’une École haïtienne à deux vitesses qui engendre l’exclusion sociale, qui pratique la discrimination linguistique en contexte d’échec quasi-total des trois réformes du système éducatif haïtien à 80% gouverné et financé par le secteur privé national et international. 1. Un patrimoine linguistique national historiquement constitué en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominant du français et à la minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale. Dans les dictionnaires usuels de langue, l’étymologie du terme « patrimoine » renvoie à « biens de famille », « héritage d'une collectivité, d'une communauté ou d'un groupe (par ex. patrimoine littéraire)», ou encore à « ce que l'on transmet d'une génération à une autre (par ex. héritage culturel) ». Haïti est riche d’un patrimoine linguistique comprenant le créole, langue parlée par la totalité de ses locuteurs natifs, et le français, langue très minoritairement maternelle et majoritairement seconde et apprise à l’école par environ 25% de la population2. Au même titre que le patrimoine architectural, littéraire et musical, le patrimoine linguistique, «bien de la nation et héritage commun à tous les locuteurs» unilingues et bilingues, a une histoire et s’exprime tant à travers ses corpus oraux et écrits que dans des institutions et des textes fondateurs. Ainsi, rédigé et proclamé uniquement en français, l’Acte de l’Indépendance du premier janvier 1804 appartient au patrimoine linguistique et littéraire du pays et il peut être considéré comme étant au fondement de la première intervention implicite de l’État dans la vie des langues en Haïti. En instituant le nouvel État en 1804, les Pères de la nation, auparavant officiers de l’armée française, ont institué un usage dominant de la langue française –sans toutefois la proclamer langue officielle–, dans toutes les sphères de l’Administration publique, dans les relations entre l’État et ses administrés et dans les embryons du système scolaire hérité de la France. Le passage d’une société esclavagiste et coloniale à une République indépendante de la France s’est donc effectué dès les premiers instants sur le mode du refoulement et de la minorisation de la langue maternelle des nouveaux libres, le créole, vers les mornes et dans le système de plantations reconstitué presqu’à l’identique pour répondre aux exigences de la centralisation administrative du pays et aux besoins de la militarisation à grande échelle du nouvel État encore menacé par l’Europe esclavagiste. De 1804 à 1987, la configuration des rudes rapports économiques et sociaux du pays, d’abord sur le mode de la servilité semi-féodale puis sur celui d’un capitalisme import-export prédateur, a permis la reproduction d’une société de castes et de classes ancrée dans l’exclusion sociale, l’exil dans sa langue et dans «l’en-dehors» de la majorité paysanne créolophone, l’accaparement des pouvoirs économique et politique par les «ayants droit» d’un système verrouillé dès 1804, ainsi que le maintien de l’usage dominant du français dans les appareils d’État, dans l’École de la République, dans l’administration de la justice et dans les autres sphères de la vie de tous les jours. En 1918, pour la première fois de l’histoire nationale, un statut constitutionnel est accordé à l’une des deux langues du pays: le français est proclamé langue officielle dans la nouvelle Constitution --rédigée à Washington, sous occupation américaine d’Haïti. Le partage inégal du patrimoine linguistique haïtien par la minorisation historique et de fait du créole, «langue qui unit tous les Haïtiens», prend formellement fin --je dis bien formellement fin--, avec la Constitution de 1987 qui accorde le statut de langue officielle et au français et au créole. S’il est convenu d’admettre qu’il s’agit là d’une indéniable conquête historique de la nation haïtienne, il est également établi que cette Constitution de 1987 n’a pas résolu d’un coup de baguette magique la question de l’usage dominant du français et de la minorisation du créole dans une société qui n’a pas encore fait sienne la notion de droits linguistiques au titre d’un droit constitutionnel reconnu. 2. La perduration d’une École haïtienne à deux vitesses qui engendre l’exclusion sociale, qui pratique la discrimination linguistique en contexte d’échec quasi-total des trois réformes du système éducatif haïtien à 80 % gouverné et financé par le secteur privé national et international. En dépit de la réforme Bernard de 1979 qui a, --avec un lourd handicap de compétences et instruments didactiques préalablement bâtis--, introduit le créole comme langue enseignée et langue d’enseignement dans notre système éducatif, l’École haïtienne, lieu de la transmission et de la reproduction des savoirs et des connaissances, assure cette transmission et cette reproduction non pas dans la langue maternelle et usuelle des apprenants, le créole, mais plutôt dans une langue, le français, qui leur est seconde et qu’ils doivent acquérir en même temps que lesdites connaissances. C’est bien à cette enseigne que réside, parmi d’autres qui lui sont liées, la cause première du naufrage à la fois didactique et citoyen de notre système éducatif national. Aujourd’hui, en Haïti, malgré les trois « réformes » successives du système éducatif -- à savoir la Réforme Bernard de 1979; le PNEF (Plan national d’éducation et de formation) uploads/Geographie/ robert-berrouet-oriol-amenagement-du-creole-et-du-francais-en-haiti.pdf
Documents similaires








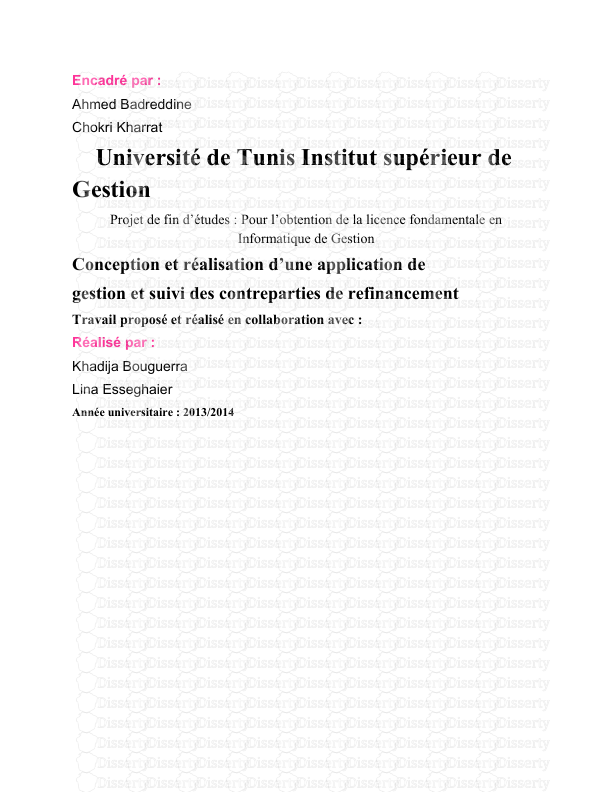

-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6579MB


