307 V. VERS LA ÎÅÍÉÔÅÉÁ INTERIEURE 308 CHAPITRE 1. LE COMBAT AU DESERT Pour se
307 V. VERS LA ÎÅÍÉÔÅÉÁ INTERIEURE 308 CHAPITRE 1. LE COMBAT AU DESERT Pour se dégager des passions, il faut nécessairement s’être d’abord soustrait le plus possible au contact des « objets » (ce qu’Evagre appelle les ðñÜãìáôá).971 Il faut donc d’abord atteindre l’½óõ÷ßá. Mais celle-ci ne suffit pas à supprimer les passions.972 La doctrine du renoncement qui conduit l’ascète vers la îåíéôåßá intérieure, décrite par Evagre comme inaccessible en permanence, est tout spécialement formulée par saint Basile de Césarée : « Il faut renoncer à tous les attachements passionnés du monde, qui peuvent faire obstacle sur le chemin qui mène vers le but fixé par la religion (...). En effet, l’esprit qui est partagé entre différents soucis ne peut pas réussir dans ce qu’il s’est proposé. (...) Le renoncement consiste à délier les liens de cette vie matérielle et éphémère, à se libérer des obligations humaines, libération qui nous rend plus dispos pour nous engager dans la voie qui mène vers Dieu ».973 Le renoncement est donc bien fondé sur l’impossibilité pour l’esprit d’être attaché à la vie terrestre et de servir en même temps Dieu : « Nul ne peut servir deux maîtres (...) vous ne pouvez servir Dieu et Mamon ».974 Evagre, dans son traité des Bases de la vie monastique, déclare que le moine doit être « un soldat du Christ, dégagé de la matière, libéré des soucis, exempt de toute préoccupation d’affaires. Comme le dit l’Apôtre : quiconque est soldat ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie, afin de donner satisfaction à celui qui l’a engagé [2 Timothée 2,4] ».975 Le moine doit dès lors renoncer au maximum à son humanité physique, à nettoyer son âme de ses « maladies ». Le « combat au désert » va consister en une « pratique », selon le terme usité par Evagre, qui vise essentiellement à dégager l’esprit par l’abolition des mauvaises pensées, démoniaques, par la victoire des vertus sur les vices. Les anges vont aider l’ascète dans cette tâche, tandis que les démons vont s’efforcer de le faire échouer 971 On retrouve la même idée chez PORPHYRE, De abstinentia, I,33,3-6 [J. BOUFFARTIGUE et M. PATILLON (éd.)], Paris 1977, p. 67-68. Les ðñÜãìáôá regroupent les choses et les hommes, en fait tout ce qui est source de sensation. 972 A. GUILLAUMONT, Evagre, p. 210-211. 973 Grandes Règles, 8 ; traduit et cité par A. GUILLAUMONT, Monachisme et éthique, p. 53. Voir aussi ID., Perspectives, p. 222-223, et V. DESPREZ, Monachisme primitif, p. 356. 974 Matthieu 6,24. 975 Esquisse monastique, 2 ; A. GUILLAUMONT, Monachisme et éthique, p. 53-54. Voir aussi L. REGNAULT et J. TOURAILLE (introd. et trad.), p. 19. 309 en le combattant. 1. LES ANGES COMME FORCES POSITIVES « Pour les Egyptiens de l’Antiquité, (...) le visible n’était qu’apparence fugitive et éphémère, ou plus exactement les deux mondes étaient si étroitement mêlés et comme imbriqués l’un dans l’autre qu’il était impossible de les séparer. Il n’y avait pas de frontière entre les deux (...). Les rapports et les échanges étaient continus, si bien qu’un anachorète dans le désert n’était pas tellement surpris de voir apparaître auprès de lui un ange ou un démon. Anges et démons faisaient partie de son univers et de son horizon. Le fait qu’ils se rendent visibles à certains moments ne changeait rien à la réalité de leur présence permanente dans ce monde des pères du désert. »976 Les anges apparaissent, semble-t-il, beaucoup moins souvent que les démons mais peut-être ne faut-il voir là que le résultat de l’humilité du moine qui répugne à raconter les bienfaits de Dieu à son égard. Il arrive même que cette humilité conduise l’ermite à refuser la vision d’un ange, ne s’en jugeant pas digne. Il vaut d’ailleurs mieux manquer de courtoisie à l’égard d’un ange que de se laisser tromper par un démon déguisé en « ange de lumière ». Un apopthegme déclare ainsi : « les anciens disaient : même si un ange t’apparaissait véritablement, ne le reçois pas, mais humilie-toi en disant : ‘je ne suis pas digne de voir un ange, car je vis dans les péchés’ ».977 Notons qu’Evagre déclare que « les anges voient les hommes et les démons ; les hommes sont privés de la vue des anges et des démons, et les démons voient les hommes seulement ».978 La vue d’un ange est donc un miracle (tout comme celle d’un démon si l’on suit Evagre !). Nous ne nous attarderons pas davantage sur les anges, en dépit du fait qu’ils jouent un rôle important dans la Mission de Paphnuce et qu’un nombre intéressant de catégories d’anges s’y trouve représenté.979 De même, les apophtegmes et d’autres sources littéraires importantes fournissent de nombreux exemples d’interventions angéliques. Cependant, celles-ci sont assurément des assistances importantes apportées au moine, mais elles ne s’imposent nullement en raison de la démarche monastique. En revanche, les démons, forces 976 L. REGNAULT, Vie quotidienne, p. 189. 977 N311 (ID., Anonymes, p. 109) ; ID., Vie quotidienne, p. 190 et 192. 978 EVAGRE LE PONTIQUE, Chapitres gnostiques, VI,69 [Les six Centuries, p. 246-247] ; A.D. RICH, p. 64. 979 Cette étude sera l’objet d’un article à paraître prochainement. 310 négatives en lutte permanente contre le moine qui recherche la îåíéôåßá intérieure, apparaissent comme totalement indissociables de cette démarche et doivent donc être étudiés plus en détail. 2. LES DEMONS COMME FORCES NEGATIVES980 A) LE DEMON ACCUSATEUR OU TENTATEUR Dans l’Antiquité chrétienne, l’existence du démon n’est pas une croyance populaire des gens les moins cultivés. En effet, les plus grands esprits en parlent. L’Ecriture Sainte ne lui accorde cependant qu’une place limitée.981 Dans l’Ancien Testament, l’œuvre démoniaque est le plus souvent attribuée à une volonté purement divine. Le Satan du Livre de Job ne correspond pas à la figure diabolique chrétienne traditionnelle du tentateur car il ne s’agit de rien d’autre que d’un ange agissant dans l’intérêt de Dieu et avec son autorisation et qui est essentiellement un accusateur, même si le tentateur transparaît en lui.982 Il en va de même en Zacharie 3,1-5. Il est souvent présenté comme un esprit mauvais envoyé par Dieu.983 Il ne présente les caractéristiques du Diable « chrétien » que dans la Genèse où il revêt l’apparence du Serpent. Notons encore que lorsque la Bible évoque les démons des païens, elle les assimile non pas au Diable mais bien aux animaux sauvages propres au désert.984 Le Serpent démoniaque apparaît dans le Nouveau Testament sous différents vocables.985 Il conserve en partie le rôle d’accusateur au tribunal de Dieu comme dans Apocalypse 12,10 ou 1 Pierre 5-8, mais son côté tentateur domine ici, notamment avec le séjour du Christ au désert afin d’y être tenté par le Diable.986 Il est également tentateur en 980 On trouvera une synthèse de ce chapitre dans M. MALEVEZ, « A la poursuite de la îåíéôåßá intérieure : le combat des Pères du désert contre les démons », Acta Orientalia Belgica XXIII, Varia aegyptica et orientalia Luc Limme in honorem, Bruxelles 2010, p. 95-108. 981 Concernant cette question, nous nous référons essentiellement à S. LYONNET, dans Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, t. III, s.v. « Démon. I. Les démons dans l’Ecriture », Paris (1953), col. 142-152. 982 Job, chapitres 1 et 2. 983 I Samuel 16,14-15 ; Juges 9,23. 984 Isaïe 13,21-22 et 34,14 ; Jérémie 50,39 sv. 985 Grand Dragon, antique Serpent, etc. Apocalypse 12,9 ; Jean 8,44, 1 Jean 3 ; 2 Corinthiens 11,3. Cf. S. LYONNET, col. 145. 986 Matthieu 4,1 ; Luc 4,1-2 ; Marc 1,12-13. 311 1 Jean 3,8 et 1 Corinthiens 7,5. Il va jusqu’à tenter d’opposer les hommes à Dieu lui-même.987 La Mission de Paphnuce insiste sur le caractère essentiellement tentateur du démon. En copte (S1.25, S2.25, B.19) et en A2.23, Timothée déclare ainsi à Paphnuce avoir été tenté. Les autres versions emploient d’autres termes qui montrent le harcèlement des « esprits », à l’exception de A3 qui est ici muet (E1.24, A0.16). Lorsque Timothée expose ensuite l’épisode de la moniale, l’idée de la tentation démoniaque est à nouveau évoquée en A0.30. Cette idée se retrouve aussi au chapitre 24, en S2.114 et B.88, en guèze (E1.120) et en A1.42. Dans le même chapitre, elle revient un peu plus loin, dans certaines versions. L’« affliction » recouvre tout malheur qui peut survenir au moine. S1.127 et S2.119 (qui emploie le terme « péril », qui ne peut recouvrir ici qu’une « tentation ») distinguent cepedant le malheur dû au démon tentateur de toute autre peine s’abattant sur l’errant. B.94 ne fait en revanche aucune distinction. Le terme « malheur » est repris par A1.42, qui en distingue les combats suscités par les tentations de l’Ennemi. Quant au guèze (E1.129), il différencie également « affliction » et combat démoniaque qu’il précise relever de la tentation. A3.114 ne parle plus de tentation, mais sépare également « souffrance » et combat démoniaque. A2.94 réduit l’« affliction » à la maladie, à l’« affection ». Au chapitre 27, on trouve en E5 une mention uploads/Geographie/ vers-la-iaaieoaaea-interieure.pdf
Documents similaires

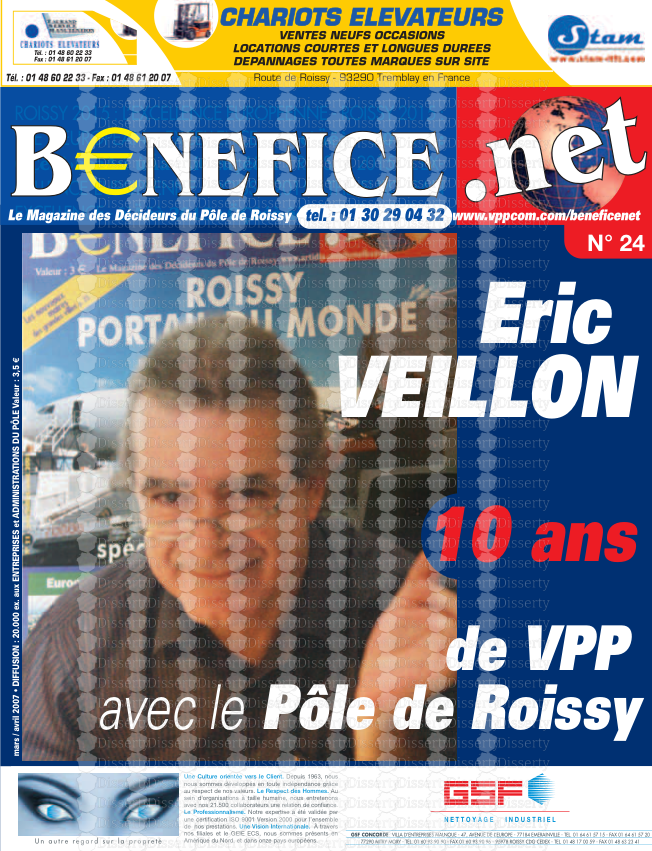








-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 08, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 2.5470MB


