ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮاث Revue Annales du Patrimoine P-ISSN 1112-5020 / E-ISSN 2602-6
ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮاث Revue Annales du Patrimoine P-ISSN 1112-5020 / E-ISSN 2602-6945 Hawliyyat al-Turath, University of Mostaganem, Algeria N° 19, September 2019 Etude archéohistorique et architecturale du Medracen Archeohistoric and architectural study of Medracen Dr Meriem Seghiri Bendjaballah Université Paris Nanterre ARSCAN, France myriamseghiri39@gmail.com Reçu le : 19/5/2019 - Accepté le : 7/7/2019 19 2019 Pour citer l'article : Dr Meriem Seghiri Bendjaballah : Etude archéohistorique et architecturale du Medracen, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N° 19, Septembre 2019, pp. 157-169. http://annales.univ-mosta.dz *** Revue Annales du patrimoine, N° 19, 2019, pp. 157 - 169 P-ISSN 1112-5020 / E-ISSN 2602-6945 Reçu le : 19/5/2019 - Accepté le : 7/7/2019 myriamseghiri39@gmail.com © Université de Mostaganem, Algérie 2019 Etude archéohistorique et architecturale du Medracen Dr Meriem Seghiri Bendjaballah Université Paris Nanterre ARSCAN, France Résumé : Le présent article s’intéresse aux monuments funéraires préhistoriques en Afrique du Nord, à travers l’étude archéohistorique et architecturale du mausolée royal numide Medracen. La question posée est comment l’architecture funéraire peut-être utile dans la compréhension des sociétés ancestrales ? Malgré la partie importante qu’occupent ces monuments dans la carte patrimoniale archéologique de l’Algérie, la majorité se voit affrontée à la l’oubli et la disparition. Il est important de l’étudier, de le documenter et de veiller à sa valorisation pour permettre une continuité entre passé, présent et avenir. Afin d’atteindre nos objectifs, nous adopterons une approche historique. Ainsi que des outils mobilisés tel que l’observation, pour l’analyse des données, qui sont essentiellement les recueils d’archéologie et les récits historiques. Mots-clés : monuments funéraires, Algérie, Medracen, ruines, valorisation. o Archeohistoric and architectural study of Medracen Dr Meriem Seghiri Bendjaballah Paris Nanterre University ARSCAN, France Abstract: This article spots the lights on the prehistoric funerary monuments in North Africa through the archeological and architectural study of the Numidian Royal Mausoleum Medracen. The question asked is how can funeral architecture be useful in understanding ancestral societies? Despite the fact that these monuments occupy an important part in the archeological heritage map of Algeria, the majority are facing the danger of oblivion and disappearance. Therefore, it is crucial to study it, to document it, and to make sure that it is used to ensure continuity between the past, the present and the future. To achieve our goals, we will take a historic approach. As well as mobilizing tools such as observation, for the analysis of data, which is essentially the archeological collections, and historical stories. Dr Meriem Seghiri Bendjaballah - 158 - Revue Annales du patrimoine Keywords: funerary monuments, Algeria, Medracen, ruins, valorization. o Introduction : La ville de Batna, riche en patrimoine archéologique, compte parmi les villes les plus anciennes, représentant une portion du territoire algérien, qui a été convoitée par nombreuses civilisations, numide, romaine, byzantine, vandale, ottomane et française. L’Aurès présente un cas d’étude illustratif dans la mesure où son patrimoine funéraire est innombrable. Le Medracen, notre cas d’études est le plus ancien mausolée royal antique d’Afrique du nord, situé à 100 km au sud de Constantine, au Nord de la Wilaya de Batna entre Aïn Yagout et El Mader, région de Boumia, à proximité d'une nécropole sur une distance de 2 km et une dizaine de tumulus(1). Le tombeau est un monument accueillant le corps du défunt, qui était enterré selon un rituel et des pratiques funéraires spécifiques, ou tout simplement élevé pour rendre hommage à un personnage. Ce joyau de l’histoire a fait l’objet de plusieurs études, en intéressant plusieurs chercheurs, historiens et archéologues. Son exclusivité est cette architecture autochtone berbère assimilée à des influences architecturales mixte ente puniques, grecques, romaines et égyptiennes. 1 - Les premières descriptions dans l’histoire : Contrairement aux autres mausolées comme le mausolée royal de la Maurétanie, Medracen, n’a pas été cité par les anciens auteurs qui s'intéressaient à l'histoire de l'Afrique du Nord, comme Strabon, Pompnius Mela et Hérodote. Sa première description remonte aux récits de l’historien arabe El Bekri, au moyen âge, dans ses récits. Par la suite, plusieurs descriptions ont succédé et les plus connues sont celles d’Ibn Khaldoun et des archéologues français comme Brunon, Becker et Camps. Etude archéohistorique et architecturale du Medracen - 159 - N° 19, Septembre 2019 2 - Etude historique et étymologie : Plusieurs appellations ont été attribuées au Medracen, Madr’azen, Medrachem, Medghassem, Maidgh-assem, Medr’cen et Madracen. Les auteurs travaillant sur le tombeau ont légué ces nominations d'après la prononciation entendue. Le tombeau a été décrit pour la première fois par Abou Ubid el Bekri, dans son livre "Massalik el Mamaalik", traduit par le Baron de Slane (description de l’Afrique septentrionale). Dans son livre, Ibn Khaldoun disait "Certains généalogistes s’accordent à rattacher toutes les branches du peuple berbère à deux souches principales : celle de Bernés (ou Bornès, ou Bornos) et celle de Mardis (ou Maghdis, ou Madès, ou Madghous, ou Madrous), cette dernière occupant les montagnes de l’Aurès". Le général Carrette appela le Medracen "Madracen", le monument est consacré aux descendants de Madrès, qui se trouve dans l’Aurès. De ce fait, Medracen est le pluriel de Madrès ou Madrous, ce qui désigne une ancienne famille. De là, d'après Carette, la sépulture commune des descendants de Madrès avait été désignée par le nom même de ceux qui y étaient déposés. Quant au docteur Leclerc, il adhéra à l'opinion de Carette, en pensant que le Madras’en est le tombeau de la famille de Massinissa, dont il fait remonter l’origine jusqu’à Madrès, ou Syphax(2). Le Rabbin Cahen tira l'origine de Madracen de la racine (Dour) ou (Dar), qui est dans les langues sémitiques à une double acceptation : la première est le cercle ou la forme ronde et le deuxième est l'habitation où la demeure. Le Madracen semble s'adapter à cette acceptation, car il est construit en rond et qu’il s’y trouve des chambres, des voutes, un hypogée, qui pourraient en faire une demeure, donc Madracen signifierait la demeure d’eux (les hommes célèbres du pays, et par conséquent les chefs, les rois). Une autre origine de l'appellation du tombeau "Madras'en" est sa situation à l’extrémité d’une plaine dite El-Mader, ainsi Dr Meriem Seghiri Bendjaballah - 160 - Revue Annales du patrimoine que la tribu occupe ce pays porte le nom de Haracta-Madrès(3). Enfin, l'étude de Gabriel Camps, qui se repose sur les noms de régions. Il disait "Le plus ancien, le Djedar (nommé A) n'est pas antérieur au Vème siècle. Ces monuments sont donc plus récents que ces mausolées, or le territoire sur lequel sont construits les Djedars appartenait au douar Madroussa. Ce nom est la forme plurielle arabisée de Madres et équivaut exactement au berbère Medracen"(4). Nous pensons d’après cette étude historique et étymologique, que Medracen comme s’est écrit du Madrous ou Madghis et qu'il désigne une ancienne famille berbère. 3 - La datation du tombeau : Datation de Stéphane Gsell(5): s'est basé dans sa datation sur le caractère mixte de l'architecture du Medracen. Le tombeau est un monument indigène, qui est un énorme tumulus, revêtu d'une chemise gréco-punique, dont la colonnade est grecque et la corniche est phénicienne, probablement du IIIe siècle avant J.-C. Gsell a remarqué l'emploi de l'ordre dorique ainsi que la gorge égyptienne dans le Medracen et dans le tombeau de Souma el Khroub, près de Constantine. Les colonnades doriques de la Soumaâ ont été datées du IIème siècle avant J.-C. De là, Gsell pensa que Medracen est de IIIème siècle, pas loin de cette date. La datation de Gabriel Camps(6): s'est basé sur la datation d'âge du bois utilisé dans le plafond de la galerie, Il effectua des prélèvements dans les poutres de cèdre et de les analyser par la suite. Deux échantillons provenant de poutres différentes furent respectivement datés par la technique de Carbonne 14 par les laboratoires de : Gif-sur-Yvette : (Gif 1671 : 2270 plus au moins 110 ans soit 320 plus au moins 110 av. J.-C.) 320 av. J.-C. Alger : (Alg 21 : 2170 plus au moins 155 ans soit 220 plus au moins 155 av J.-C.) 220 av. J.-C. Quant aux tables de corrélation dendrochronologiques, une Etude archéohistorique et architecturale du Medracen - 161 - N° 19, Septembre 2019 autre technique adoptée par le Laboratory of Osotope Geochemistry de l'Université d'Arizona donna les dates suivantes 403 plus au moins 53 av. J.- C. et 286 plus au moins 42 av. J.-C. En revanche, les cèdres utilisés par les constructeurs du Medracen avaient été abattus longtemps auparavant afin que le bois bien sec puisse résister à l'énorme poussée des matériaux accumulés au-dessus de la galerie. Nous pouvons conclure concernant la datation du Medracen qu'il fut construit soit à la deuxième moitié du IIème siècle avant J.-C, ou le début du IIIème siècle avant J.-C. Il ne pourrait pas être postérieur à 200 av. J.-C. 4 - Interprétation archéologique : Gabriel Camps considère que le Medracen est cette belle rencontre des influences gréco-orientales introduites par Carthage et de la tradition protohistorique berbère. Il appartient à la grande famille de Bazinas et cela quels que soient leur âge et leurs aménagements intérieurs. "Construits au cours des uploads/Histoire/ dr-meriem-seghiri-bendjaballah-etude-archeohistorique-et-architecturale-du-medracen.pdf
Documents similaires

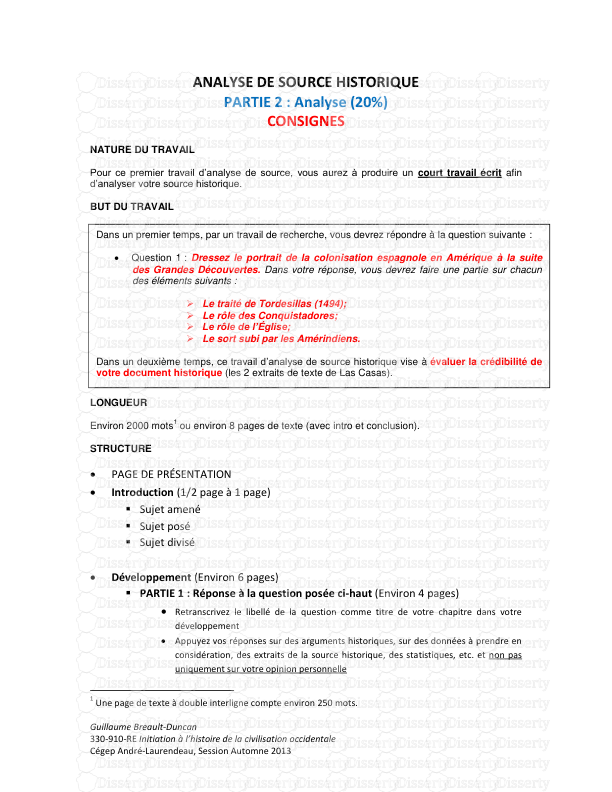








-
78
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 23, 2021
- Catégorie History / Histoire
- Langue French
- Taille du fichier 0.1957MB


