Chapitre 1: Introduction Montée en puissance progressive du « tout numérique
Chapitre 1: Introduction Montée en puissance progressive du « tout numérique » de nouveaux types de produits et services émergent peu à peu MULTIMEDIA : Élaboration de documents comprenant de multiples médias. Un document multimédia est un document interactif qui comprend au moins deux signaux de types différents Comprend à la fois de l’information textuelle, des images, des animations, etc. Objets multimédias de base : texte, son, image et vidéo. Nouveaux modes de représentation du réel : Synthèse, réalité virtuelle, etc. 2 Chapitre 1: Introduction Définitions Media : Un média est un mode de représentation de l'information avec un moyen de communication (comme la presse, la radio, la télévision, Internet, etc.) Multimédia : un mot apparu vers la fin des années 1980, lorsque les supports de stockage se sont développés comme les CD- ROM. Il désignait les applications qui, grâce à la mémoire du CD et aux capacités de l'ordinateur, pouvaient générer, utiliser ou piloter différents médias simultanément. Aujourd'hui, le mot multimédia est utilisé pour désigner toute application utilisant ou traitant au moins un média spécifique. Support Multimédia : c’est un support qui réunit plusieurs médias en vue de leur manipulation (utilisation ou traitement). 3 Chapitre 1: Introduction Objets multimédias Type d’objet multimédia Dispositif d’acquisition Dispositif de restitution Texte Clavier, … Ecran, Imprimante, ... Son Microphone, … Haut-parleurs, ... Image Appareil photo, scanner Ecran, imprimante, Vidéo Caméra, … Ecran, haut-parleurs, vidéoprojecteur, ..., etc. 4 Chapitre 1: Introduction Acteurs du multimédia Signaux multimédia: la technologie s’est développée pour diversifier la forme de présentation de l’information qui peut comprendre à la fois de l’information textuelle, des images et les animations. Réseaux de télécommunications: le multimédia utilise le réseau Internet pour la transmission des données qui est plus adapté aux contraintes multimédia que le réseau téléphonique. Informatique: les progrès de l’informatique de ces dernières années ont permis l’apparition des outils logiciels et une croissance de la puissance des micro-processeurs facilitant l’apprentissage de l’usage de l’ordinateur par un nombre croissant d’utilisateurs. Normalisation: un échange d’information n’est possible que s’il existe un “langage” commun, ce qui dans le monde technique s’appelle des normes ou standards. 5 Chapitre 1: Introduction Applications multimédia Les images, son et vidéo sont présents partout : 8 148 000 photos toutes chaque heure sur fb. 4 milliards de vidéos youtube visionnées par jour. On est non seulement consommateur, mais aussi producteurs. Les capteurs son, caméras photos et caméscopes vidéo sont partout. 6 Chapitre 1: Introduction Applications multimédia Applications intelligentes : Restauration des images Réduction de l’espace Extraction de super résolution depuis basse Rajout d’effets spéciaux sur les vidéos/images Correction des erreurs dans les séquences Catalogues interactifs, journaux en ligne TV et cinéma (2D ou 3D) Vidéoconférences Reconnaissance objets, Visages, Surveillance, Tracking Expressions faciales, Mouvements des mains, Segmentation, Réalité augmentée télédiagnostic médical Reconstruction 3D 7 Chapitre 1: Introduction Normalisation Définition: La normalisation est un processus politique, économique et technologique qui consiste à établir un ensemble de règles. Les normes sont des accords documentés contenant des spécifications techniques ou autres critères précis destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes directrices ou définitions de caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, processus et services sont aptes à leur emploi. Un produit répondant à des normes permet une meilleure intégration du produit dans des solutions tant matérielles que logicielles. 8 Chapitre 1: Introduction Normalisation Standard: On distingue les standards de facto, improprement appelés standards car ils sont imposés par un constructeur unique, des standards officiels qui eux résultent d’un consensus. Standards de facto Standards officiels Avantages • Conçus rapidement • Solution optimale • Possibilité de tailler un standard sur mesure en fonction d’une application • Développement par un large panel d’experts • Spécifications complètes et non ambiguës • Contrôle du standard confié à un organisme au lieu de l’entreprise • Possibilité de certification accrue Inconvénients • Possibilité d’erreur plus grande • Manque de clarté • Manque de compétition en raison des droits de propriété • Diversité des solutions pour un même type d’application • Long temps de développement (de 3 à 5 ans) • Compromis technique • Généricité qui ne peut pas être adaptée à une application précise • Complexité élevée • Conflits entre intervenants 9 Chapitre 1: Introduction Normalisation Certification La certification est l’opération qui consiste à vérifier que des produits, matériaux, services, systèmes ou individus sont conformes aux spécifications d’une norme pertinente. Par exemple, un client peut vouloir vérifier l’aptitude à l’emploi requise du produit qu’il a commandé auprès d’un fournisseur. L’une des procédures les plus efficaces est de s’appuyer sur les spécifications du produit lorsqu’elles sont définies dans une norme internationale ; la plupart des normes actuelles prévoient un chapitre spécifiquement lié à la certification. Organismes de normalisation: des organismes de normalisation ont été créés pour définir des standards pour permettre l’intégration d’éléments provenant de fournisseurs distincts. Les organismes importants en télécommunications sont : l’International Telecommunications Union (ITU) : une agence spéciale des Nations-Unies qui a développé une série de recommandations, appelée série V, décrivant la connexion d’un modem à un réseau téléphonique. l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) : un organisme européen, créé en 1989 pour contrebalancer l’influence du groupe de normalisation américain ANSI. L’ETSI a développé entre autres l’Euro-RNIS et la norme GSM. 10 Chapitre 1: Introduction Normalisation Groupes de normalisation internationaux Groupes de normalisation régionaux ISO International Organisation for Standardisation CEN European Committee for Standardisation IEC Commission Électronique Internationale CENELEC European Committee for Electrical Standardisation ITU Union Internationale des Télécommunications CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations CIE Commission Internationale de l’Éclairage IAU International Astronomical Union ETSI European Telecommunications Standards Institute IFIP International Federation for Information Processing IPA International Prepress association 11 Chapitre 1: Introduction Normalisation Exemples de normes : Voici quelques exemples de normes : la format A4 papier est une norme ISO la série V de l’ITU définit les modes connexion d’un modem au réseau téléphonique (V90, …) les familles H32x définissent des normes de vidéoconférence les langages HTML, XML les numéros ISBN, . . . Numérotation des comptes bancaires: pour faciliter les paiements transfrontaliers, l’ISO a défini la norme ISO- 13616 “International Bank Account Number” (IBAN) pour l’uniformisation des numéros de compte bancaire . L’IBAN se compose se compose de 3 parties : 1. le code ISO du pays où le compte est tenu (2 lettres) 2. un chiffre de contrôle (2 chiffres) et 3. l’actuel numéro de compte national. 12 Chapitre 1: Introduction Normalisation Norme de compression vidéo : MPEG Les normes MPEG sont constituées de plusieurs volets. Parmi les normes issues du groupe MPEG de l’ISO10 on peut citer les normes MPEG-1 et MPEG-2. La norme MPEG-1 est composée d’une partie système, vidéo, audio, conformité et simulation par logiciel. La partie 3 de cette norme est utilisée également en dehors du contexte de la vidéo ; c’est ce volet qui porte le nom plus connu de MP3. Il faut veiller à ne pas confondre MP3 avec le projet MPEG-3 qui s’adressait à la télévision haute définition et qui a été fusionné avec MPEG-2 lors du développement de la norme MPEG-2. Normes de qualité ISO 9000 : les normes de qualité ISO 9000 constituent une référence incontestable en matière de qualité. La norme est ensuite déclinée suivant le secteur d’activités. 13 PLAN Chapitre 2 : Les signaux multimédia 1. Introduction 2. Les signaux analogiques de base a. Son b. Image et vidéo 3. Les espaces de couleurs 4. Signal vidéo 5. La numérisation des signaux multimédia 14 Chapitre 2: Les signaux multimédia Introduction Multimédia : nécessite échange d’information, principalement de nature visuelle ou auditive, ainsi qu’une série d’actions. Autrement dit, l’interactivité multimédia se traduit par un échange de signaux entre les différentes composantes des équipements. Les signaux tels que nous les percevons sont analogiques, c’est-à-dire qu’ils ne présentent aucune discontinuité. Par exemple, les sons arrivent à notre oreille en continu. Cependant, les applications multimédia mettent en jeu plusieurs types de signaux ainsi qu’une série de processus de mise en forme de ces signaux. 15 Chapitre 2: Les signaux multimédia Introduction L’acquisition et la numérisation permettent la création des objets multimédia. Compression et codage réduisent la quantité de données de façon réversible et non réversible. L’objet multimédia peut être stocké sur un support ou utilisé comme un service. Le service multimédia nécessite des structures de transmission adaptées à des flux importants de données numériques. 16 Chapitre 2: Les signaux multimédia Les signaux analogiques de base Caractéristiques d’un son Le son est une onde qui se propage dans l’air et qui est perceptible grâce au détecteur de pression qu’est le tympan, logé dans l’oreille. Ces vibrations sont ensuite converties en signaux transmis au cerveau par le nerf auditif. Le son peut être décrit par plusieurs paramètres décrivant les propriétés de l’onde acoustique et qui peuvent être exprimées sous la forme de grandeurs objectives dont quatre suffisent à décrire globalement un son Intensité Durée Hauteur tonale Timbre 17 Chapitre 2: Les signaux multimédia Les signaux uploads/Industriel/ chapitres-1-2-multim.pdf
Documents similaires

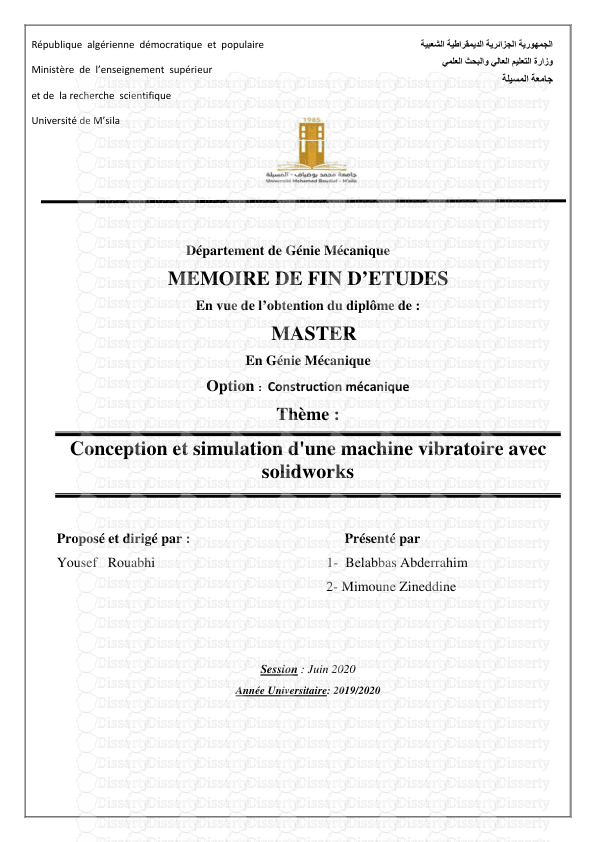








-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 25, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4598MB


