Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 7 960 − 1 Aciers pour emballage par Philippe AUBRUN Ingénieur de l’École Supérieure de Physique et Chimie de la Ville de Paris Docteur ès Sciences Physiques Ancien Directeur Technique au Centre de Recherches du Fer-Blanc es aciers pour emballages comprennent le fer-blanc et ses produits dérivés : l’expression recouvre donc les matériaux d’emballage ayant une âme d’acier, c’est-à-dire : boîtes de conserves, boîtiers d’aérosols, capsules, petits emballages industriels. 1. Généralités................................................................................................. M 7 960 - 2 1.1 Importance du fer-blanc.............................................................................. — 2 1.2 Raisons des particularités du cycle de fabrication du fer-blanc .............. — 2 1.3 Normes et règles de l’art............................................................................. — 2 2. Particularités du cycle de fabrication du fer-blanc........................ — 2 2.1 Usine à brames............................................................................................ — 2 2.2 Train à chaud................................................................................................ — 2 2.3 Train à froid .................................................................................................. — 3 2.3.1 Décapage............................................................................................. — 3 2.3.2 Laminage à froid................................................................................. — 3 2.3.3 Dégraissage avant recuit sur base .................................................... — 3 2.3.4 Recuit en continu................................................................................ — 3 2.3.5 Écrouissage......................................................................................... — 4 3. Étamage électrolytique .......................................................................... — 4 3.1 Généralités ................................................................................................... — 4 3.2 Enchaînement des opérations.................................................................... — 4 3.2.1 Section d’entrée.................................................................................. — 4 3.2.2 Dégraissage......................................................................................... — 5 3.2.3 Décapage............................................................................................. — 5 3.2.4 Étamage électrolytique ...................................................................... — 5 3.2.5 Refusion............................................................................................... — 6 3.2.6 Passivation .......................................................................................... — 6 3.2.7 Huilage................................................................................................. — 6 3.2.8 Section de sortie................................................................................. — 6 3.2.9 Contrôle de qualité ............................................................................. — 6 4. Chromage électrolytique du fer noir.................................................. — 6 5. Perspectives techniques à court terme............................................. — 7 5.1 Continuité des procédés ............................................................................. — 7 5.2 Réduction des épaisseurs ........................................................................... — 7 5.3 Vernissage en bande ................................................................................... — 7 Pour en savoir plus........................................................................................... Doc. M 7 960 L ACIERS POUR EMBALLAGE _______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. M 7 960 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques 1. Généralités 1.1 Importance du fer-blanc La vogue du fer-blanc ne se dément pas depuis plus de cinq cents ans et tient à différentes propriétés de ce matériau complexe constitué d’une âme d’acier, le fer noir, recouverte d’étain. La première a été son inaltérabilité, d’où il tire son qualificatif de blanc, d’autant plus marquante aux siècles passés que l’on ne savait pas autrement empêcher l’acier de rouiller, ce qui lui a donné sa dési- gnation de fer noir. La deuxième a été l’aptitude du fer-blanc à s’assembler à l’aide de soudures tendres ; l’opération est facile du fait du bas point de fusion de l’étain (232 oC). La dernière est l’absence de toxicité des ions de l’étain pour l’homme : elle a ouvert au fer-blanc, déjà matériau d’emballage, l’immense champ de l’emballage alimentaire après que les travaux de Nicolas Appert sous le Premier Empire aient établi la possibilité de conserver les aliments dans des conditions aseptiques après stérilisation. Dans cette appli- cation, la majeure du fer-blanc actuel, on tire parti à la fois de la protection cathodique qu’assure l’étain à l’acier dans la boîte, ce qui élimine pratiquement le risque de perforation, et du milieu réducteur créé par les ions stanneux, favorable à la conservation des vitamines et au maintien de certaines couleurs des aliments. Pour améliorer l’aspect intérieur des boîtes, réduire la diffusion des ions stanneux dans l’aliment et abaisser les taux d’étain (c’est-à-dire mettre des épaisseurs plus faibles), donc rendre le fer-blanc plus avantageux techniquement et économiquement que par le passé, on développe actuellement l’usage du fer-blanc verni. Le fer-blanc actuel est donc fort différent de ses ancêtres des siècles passés : nature des couches définies et contrôlées, épaisseurs d’étain diminuées dans le rapport de 100, film d’oxydes d’étain modifié par incorporation d’oxydes de chrome trivalent avec ou sans addition de chrome métallique, etc. Dans les domaines d’application où les aliments sont peu corro- sifs mais où l’on recherche une meilleure adhérence des revête- ments organiques (vernis, couches, encres), on prend l’habitude de substituer un fer noir chromé en bande au fer-blanc. Ce fer chromé [en anglais : Tin Free Steel (TFS ), ou Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS )] ne s’emploie qu’à l’état verni, n’est pas assemblable par soudage aux soudures tendres ou par soudage électrique à grande vitesse. Dans l’emballage alimentaire, il sert à la fabrication de fonds et de corps de boîtes en deux pièces. Au paragraphe 4, nous indiquerons comment on l’élabore. La production annuelle française de fer-blanc, de fer chromé et de fer noir a peu varié au cours de ces deux dernières années, aux alentours du million de tonnes pour l’ensemble des produits : près de la moitié est exportée, ce qui place la France au deuxième rang des exportateurs mondiaux après le Japon. 1.2 Raisons des particularités du cycle de fabrication du fer-blanc De par son épaisseur, entre 0,14 et 0,49 mm d’après les normes américaines et européennes, le fer-blanc pourrait être fabriqué comme la tôle mince. Toutefois les nécessités d’étamer le fer noir, d’assurer au fer-blanc des qualités de résistance à la corrosion et de pouvoir le mettre en forme sont trois raisons qui conduisent à aménager le cycle de fabrication des tôles minces. La première tendra à ce que l’étamage se produise sur une surface d’acier aussi libre que possible d’oxydes, de carbures et de composés organiques. La deuxième, pour limiter le courant de pile entre l’étain et l’acier au cours de la corrosion, réduit les quantités des éléments d’alliage de l’acier. La troisième, destinée surtout aux modes de déformation du fer-blanc par expansion, conduit à des mesures à l’aciérie pour éviter la présence d’inclusions de taille critique (supérieure à 0,05 mm par exemple) dans le fer-blanc destiné à ces applications. 1.3 Normes et règles de l’art Bien que le fer-blanc ait la réputation justifiée d’un produit sur mesures, fabriqué suivant les besoins exprimés par le fabricant de boîtes, l’habitude s’est prise de se référer à des normes. Celles-ci codifient l’usage tiré de nombreuses années d’expérience : toutefois elles laissent un vaste domaine aux transactions entre producteur et client, qui permettent au producteur d’appliquer son savoir-faire. La sidérurgie française se reporte souvent aux normes américaines (ASTM) et européennes (EURONORM) citées dans la fiche documentaire [Doc. M 7 960]. Sans entrer dans les détails, nous indi- querons qu’elles traitent de caractéristiques mécaniques et dimen- sionnelles, d’aspect, de limites de composition de l’acier, de taux d’étain répartis symétriquement ou non sur les faces, de films de passivation, d’huilage, de méthodes d’essai et d’analyse... 2. Particularités du cycle de fabrication du fer-blanc La fabrication du fer-blanc, par rapport à celle des tôles minces, est décrite dans l’ordre des opérations sidérurgiques des usines modernes actuelles, les seules en service en France (figure 1). Ces usines ont abandonné la coulée en lingots pour adopter la coulée en continu d’aciers calmés à l’aluminium, conduisant à des aciers plus constants dans leurs propriétés, d’une meilleure propreté inclu- sionnaire et d’un prix de revient inférieur. 2.1 Usine à brames Les deux précautions particulières à ce stade correspondent à : — la réalisation des analyses pour l’obtention des caractéristiques mécaniques, pour satisfaire aux normes de limite de composition chimique [Doc. M 7 960] ; c’est aussi un des moyens connus de lutte contre la graphitisation superficielle du fer noir au cours du recuit sur base (§ 2.3.3) ; — l’élimination des inclusions non métalliques : le niveau moyen de propreté inclusionnaire de la production d’une usine à brames dépend des qualités de son équipement et de son savoir-faire ; en fonction des niveaux de ces deux qualités, le taux de réussite des très grandes propretés inclusionnaires impliquera un tri plus ou moins poussé des brames (déroutement de ces brames à risques que sont les brames de début et de fin de coulée et les brames de changement de séquence, voire des brames voisines de celles qui viennent d’être indiquées). 2.2 Train à chaud En dehors des soins classiques apportés aux tôles minces pour l’obtention des caractéristiques mécaniques (respect des tempéra- tures à l’entrée des finisseuses, de fin de laminage et de bobinage) et pour la propreté de surface (décalaminage, gestion des cylindres), il faut mentionner : — l’écueil des températures élevées de bobinage, souvent suspectées d’abaisser la tenue du fer-blanc à la corrosion ; — la fixation de l’épaisseur de la tôle à chaud par le taux de réduction imposé au laminoir à froid pour la production d’aciers à cornes contrôlées ; cela constitue une exception à la règle usuelle de la répartition de la réduction d’épaisseur entre les deux trains ; en effet, le niveau des cornes dépend du taux de réduction à froid, autour de 90 %, à côté de la composition de l’acier, du taux d’écrouissage, etc. ______________________________________________________________________________________________________________ ACIERS POUR EMBALLAGE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 7 960 − 3 2.3 Train à froid Nous allons regrouper dans ce paragraphe un certain nombre d’opérations où le traitement du fer noir se distingue de celui uploads/Industriel/ aciers-pour-emballage-pdf.pdf
Documents similaires




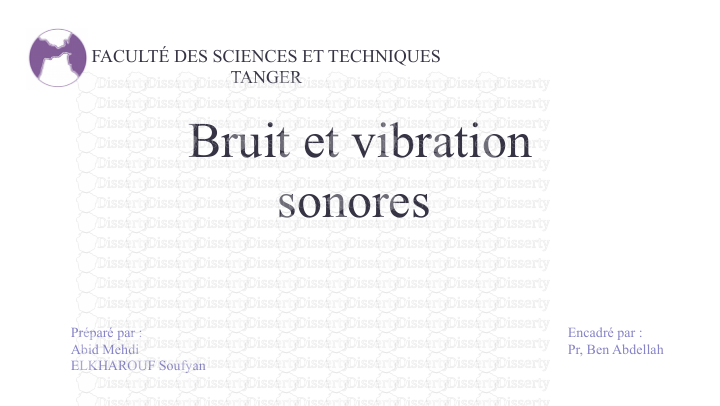





-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 14, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3011MB


