Ecole des Mines de Douai page 1 F. Leman FI 3A 2009-10 Electricité Industrielle
Ecole des Mines de Douai page 1 F. Leman FI 3A 2009-10 Electricité Industrielle Energies Renouvelables Cours - 1ère PARTIE F. Leman G.Galasso FI2A - Année 2010-11 Ecole des Mines de Douai page 2 F. Leman FI 3A 2009-10 Electricité Industrielle Energies Renouvelables COURS François Leman – Professeur Agrégé de Physique Appliquée Giuseppe Galasso – Professeur Agrégé de Génie électrique Ecole des Mines de Douai page 3 F. Leman FI 3A 2009-10 Présentation du cours d’électricité industrielle. L’ambition du cours « d’électricité industrielle » est de poser les règles de fonctionnement des systèmes l’électriques et de présenter quelques applications dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire. L’ensemble de la formation est répartie en 24 h de cours et 18 h de travaux dirigés. Cet horaire ne permet pas de développer de façon détaillée les différentes notions mais il donne un aperçu des domaines abordés : l’électrotechnique, l’électronique de puissance, les règles de sécurité… Il donne les « outils » permettant la compréhension des systèmes électriques. Une bibliographie permet d’approfondir les notions que vous serez amené à rencontrer dans votre vie professionnelle. Nous insisterons sur les énergies renouvelables pour la production d’électricité qui seront progressivement introduits dans les réseaux électriques pour faire fasse aux problèmes énergétiques et écologiques. Nous pouvons diviser le cours en deux parties 1ère partie : l’étude des circuits électriques industriels et tertiaires qui traite de la production, du transport, de la distribution, de l’appareillage électrique. Cette partie comprend : La place de l’énergie électrique (F. Leman) Les réseaux monophasés et triphasés (F. Leman). L’étude des transformateurs qui sont omniprésents dans la distribution et les systèmes électriques (F. Leman). La lecture de schéma électrique, le fonctionnement et de choix des protections des installations et des personnes. Le transport de l’énergie électrique (G. Galasso). Les risques électriques et la protection des personnes. Cette dernière partie est très importante pour des cadres qui ont du personnel en responsabilité. La distribution : SLT, protections du matériel (G. Galasso). Cette première partie sera l’occasion d’aborder les sources d’énergie renouvelables éoliennes et photovoltaïques qui auront un développement très important dans un avenir proche (G. Galasso).. La 2ème partie traite de la motorisation et de la production d’énergie électrique. Prés de 72 % de l’énergie électrique consommée dans l’industrie sert à faire tourner des moteurs. Cette partie comprend : L’étude des moteurs à courant continu ou alternatifs (F. Leman). L’électronique de puissance qui permet la commande de ces machines (F. Leman). L’étude des machines synchrones (ou des alternateurs) qui sont universelles pour la production de l’énergie électrique (F. Leman). La motorisation électrique a pris une place prédominante dans le transport train, tramway, métro, navire et a certainement une place à prendre dans l’automobile avec l’avènement des véhicules hybrides ou à piles à combustible (un véhicule compte déjà plus de 20 moteurs électriques : ventilateur, essuie-glace…). Ecole des Mines de Douai page 4 F. Leman FI 3A 2009-10 1ère partie : présentation de l’énergie électrique. 1. La production de l’énergie électrique en France. 1.1. L’énergie électrique dans l’ensemble des énergies primaires. La production de l’énergie électrique est obtenue de façon traditionnelle à partir de sources d’énergies fossiles pétrole, charbon et gaz ainsi que de réactions de fissions nucléaires utilisant l’uranium. Leur répartition est souvent très inégale et dépend principalement de critères et de choix économiques et politiques. Le caractère « renouvelable » de l’énergie est une donnée relativement récente, en France la source principale d’énergie renouvelable est l’énergie hydraulique. Les autres sources d’énergie se développent le vent (l’éolien), la biomasse, le solaire (photovoltaïque)… Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf. Unités: 1 tonne d'équivalent pétrole (tep) = 11 628 kW Remarques : il faut faire une distinction entre l’énergie primaire produite pour laquelle l’énergie nucléaire compte pour 41 % de l’ensemble (114,6/278,4) et l’énergie réellement consommée dont 21% (37,32/177,91) d’énergie électrique. Cette différence s’explique par le mauvais rendement des centrales électriques et notamment nucléaires (environ 33 %). Les stratégies d’économie d’énergie doivent intervenir sur les ressources primaires c'est-à-dire sur la consommation finale et sur le rendement des conversions. Ecole des Mines de Douai page 5 F. Leman FI 3A 2009-10 Note : la consommation mondiale annuelle d’énergie primaire est d’environ 1,4. 10+17 Wh ou 140 000 TWh (10+12 Wh) soit en divisant par le nombre d’heures dans l’année 16 TW. Cela donne une moyenne de plus de 2 kW par habitants (dans une plage de quelques W à des dizaines de kW par personne). 1.2. La production d’énergie électrique. Les deux tableaux suivant montrent la part prépondérante de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité en France. Production d’énergie électrique dans le monde Production d’énergie électrique en France 1.3. Comment équilibrer consommation et production ? 1.3.1. Utilisation des courbes de la demande. La fonction essentielle d’un réseau électrique est de satisfaire la demande du consommateur. Les générateurs (essentiellement les alternateurs) doivent s’adapter en permanence aux changements de la demande pour cela il faut une prévision très précise de la demande pour les raisons suivantes : On ne peut pas stocker l’électricité à faible coût (mis à part les barrages utilisant le pompage-turbinage) La plupart des centrales sont thermiques, le temps de démarrage d’un état « froid » jusqu’à la connexion au réseau est de plusieurs heures Les générateurs utilisant des turbines à vapeur ont une limite maximale de puissance (appelée nominale) mais aussi minimale : lorsqu’ils sont connectés au réseau ils doivent être chargés entre 30 % et 50% selon les constructeurs. Actuellement, les prévisions de consommation sont calculées à quelques % prés (en moyenne la précision d’un peu plus de 1%). 1.3.2. Equilibre sur une journée. En anticipant, un accroissement de la demande, les responsables du réseau doivent choisir quels générateurs sont concernés parmi ceux disponibles, les générateurs qui seront préparés, mis en pression puis connectés au réseau puis par la suite déconnectés : c’est un choix technique et économique compliqué. De plus dans le cas d’un marché privatisé, la compagnie en charge du réseau à pour rôle le choix des centrales mais sa décision est prise dans le contexte de relation contractuelle avec les différents participants au marché. La figure représente l’évolution journalière de la consommation électrique en France(journée d’hiver en 2007). Les proportions des divers moyens de production, c'est-à- dire des diverses sources d’énergies sont représentés sur 24 heures. On s’aperçoit que l’équilibre entre consommation et production nécessite une mise en œuvre d’un ensemble de mode de production : Ecole des Mines de Douai page 6 F. Leman FI 3A 2009-10 1° - Les centrales de masse : en France, elles sont essentiellement nucléaires (34 unités de 900 MW, 20 unités de 1300 MW et 4 unités de 1450 MW). Les temps de réponse des processus sont très longs (quelques heures) ; la mise en œuvre de ces centrales est programmée en fonction d’une prévision journalière de la consommation. 2° - Les centrales de production intermédiaires (inférieures à 1 GW): en France, elles utilisent des énergies fossiles (charbon et fuel). On peut y ajouter les centrales hydrauliques au fil de l’eau et des parcs éoliens selon les pays. 3° - Les centrales de production de pointe : elles ont un temps de mise en fonctionnement très court (de quelques minutes à quelques dizaines de minutes). Ces unités sont principalement des centrales hydrauliques ou au gaz). 1.3.3. Equilibre sur une année. Répartition de la production d’électricité pour répondre à la demande des consommateurs. Production par secteurs de juillet 2007 à juin 2008 Part de la production d’électricité à partir d’énergie fossile La pointe hivernale apparaît clairement. On voit également que la base nucléaire est régulée selon la saison (avec une production plus importante en hiver), mais que la majorité de la pointe est compensée par l'augmentation de la production d'électricité à partir d'autres combustibles fossiles que l'uranium. Les statistiques de l'UCTE (Union pour la Coordination de la Transmission de l'Electricité) permettent de détailler cette production fossile dans la mesure du possible Ecole des Mines de Douai page 7 F. Leman FI 3A 2009-10 2. Les différentes modes de production d’énergies électriques. 2.1. Les centrales nucléaires en France. En 2006, il y a 58 réacteurs nucléaires de puissance en activité dans 19 centrales en exploitation, un réacteur à neutrons rapides expérimental, 12 réacteurs nucléaires arrêtés, 2 centrales en cours de démantèlement et 3 centres de stockage de déchets radioactifs. Ecole des Mines de Douai page 8 F. Leman FI 3A 2009-10 2.2. Les centrales thermiques classiques. La mise en place du parc de centrales nucléaires c’est accompagnée d’une diminution des centrales thermiques. Actuellement, les centrales consomment essentiellement du gaz et du charbon. Production thermique classique (en France) par type de combustible (source : http://www.industrie.gouv.fr). 1: 1 TWh = I milliard de kWh. - 2 : Gaz de haut fourneaux, de raffineries, déchets ménagers, résidus industriels, - 3 : Fioul lourd, fioul domestique et coke de pétrole. 2.3. Les énergies renouvelables. 2.3.1. Extrait du rapport Stern (Les Energies renouvelables pour la production d’électricité – Freris et Infield – Dunod) Les deux uploads/Industriel/ cours-elect-indust-2010-1partie.pdf
Documents similaires








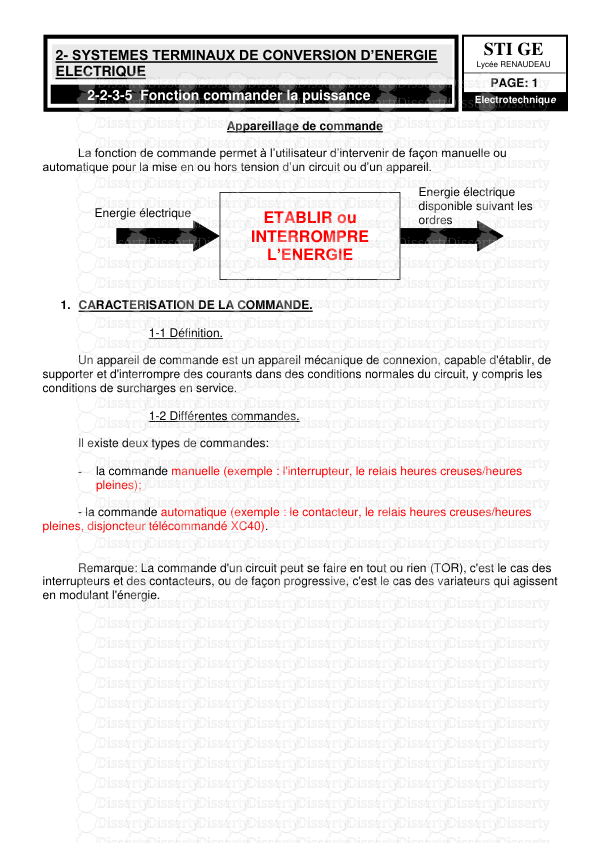

-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 19, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 2.5064MB


