IUT GMP ANGERS 1 CM – CONCEPTION MECANIQUE Etude de la conception Volume horair
IUT GMP ANGERS 1 CM – CONCEPTION MECANIQUE Etude de la conception Volume horaire 1h30 DS Objectifs du module : Appréhender de la conception de liaisons élémentaires. Initiation à la cotation fonctionnelle. 40h TP 9 TD Prérequis : M1101, M1102, M1103, M1104, M1201, M1203 0h CM SOMMAIRE 1. Méthodes d’analyse et cahier des charges fonctionnel A. Fonction d’un produit B. Diagrammes et méthodes d’analyse fonctionnelle 2. Cotation tolérancée, ajustements et chaînes de cotes C. Cotation dimensionnelle D. Cotation géométrique E. Ajustements F. Chaînes de cotes 3. Conception des liaisons A. Liaison complète B. Liaison pivot a. Paliers lisses b. Roulements C. Liaison glissière 4. Lubrification et étanchéité A. Lubrification à l’huile B. Lubrification à la graisse C. Joints d’étanchéité D. Etanchéité des roulements p. 2 p. 2 p. 3 p. 7 p. 7 p. 11 p. 14 p. 20 p. 22 p. 22 p. 25 p. 26 p. 29 p. 41 p. 43 p. 43 p. 48 p. 50 p. 52 Bibliographie Guide du dessinateur industriel – Hachette technique Guide des Sciences et Technologies Industrielles – Nathan M2101 IUT GMP ANGERS 2 1. METHODES D’ANALYSE ET CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL Ces méthodes sont utilisées dans les premières phases d’un projet pour étudier, analyser et décortiquer un produit envisagé dans le but de le rendre aussi compétitif que possible. A. Fonctions d’un produit. C’est une action réalisée par un produit, exprimée sous forme d’un but à atteindre. On utilise le verbe à l’infinitif qui dit ce que fait le produit, suivi par un complément, sur qui ou quoi agit le produit. Exemple : « Transporter le conducteur » est l’une des fonctions d’une automobile. Les différents types de fonctions Fonctions de service : fonctions liées au service ou à l’usage d’un produit. Elles décrivent ou définissent une action du produit répondant à un besoin ou une attente de l’utilisateur. Suivant les besoins, une fonction de service peut être classée en fonction d’usage ou d’estime, en fonction principale ou complémentaire, en fonction contrainte. Fonction d’usage : c’est une fonction de service liée à l’aspect utilitaire du produit. Elle définit l’utilité matérielle du produit. Exemple : « corriger la vue » est une fonction d’usage pour une paire de lunette. Fonction d’estime : c’est une fonction de service ayant un impact psychologique ou affectif sur l’utilisateur du produit. Exemple : « avoir une image sportive » est une fonction d’estime pour l’automobile. Fonction principale : fonction essentielle du produit, elle justifie sa création. Un même produit peut avoir plusieurs fonctions principales. Exemple : « couper le gazon » est la fonction de service principale d’une tondeuse à gazon. « ramasser le gazon coupé » peut être la seconde. Fonctions complémentaire : elles rassemblent toutes les fonctions, de service ou techniques, complémentaires aux fonctions principales du produit. Exemple : « être adaptable au réseau électrique en vigueur » est une fonction de service complémentaire d’un téléviseur. Fonctions contrainte : ce sont des fonctions imposant des limites aux fonctions principales. Exemple : « avoir des phares blanc » est une contrainte de service imposée aux automobiles par les normes européenne. IUT GMP ANGERS 3 B. Diagrammes et méthodes d’analyse fonctionnelle Méthode APTE ou diagramme pieuvre Cette méthode est utilisée pour analyser les besoins et identifier les fonctions de service d’un produit. Principe : le produit étudié est en relation avec certaines composantes du milieu extérieur repérées par 1, 2, 3, 4 et 5. Il doit s’adapter à 3 et agit sur 4 et 5. Il crée ou modifie les relations entre 1 et 2. Exemple : FP : Permettre à l’utilisateur de se protéger du soleil automatiquement. FC1 : pouvoir être commandé manuellement par l’utilisateur. FC2 : s’adapter à l’intensité de la lumière solaire. FC3 : s’adapter à l’intensité du vent. FC4 : utiliser l’énergie électrique à disposition. FC5 : être maintenu solidement par le support. Diagrammes à boites pour analyses descendantes Ces diagrammes décrivent et décortiquent les produits ou systèmes d’un point de vue fonctionnel, en détaillant l’aspect hiérarchique et en classant par niveaux d’importance l’ensemble des fonctions. Propriétés : l’approche progressive et systématique par niveaux successifs couvre l’ensemble des activités du système ou du produit pendant son cycle de vie. Principe de l’analyse descendante : les fonctions ou les supports d’activité sont inscrits dans des rectangles ou des boites et les relations entre celles-ci sont représentées par des flèches orientées. Exemple : diagramme simplifié d’une centrale thermique. Niveau 1 : fonction principale de la centrale « produire de l’électricité ». Niveau 2 : il décortique le niveau précédent, indique les parties principales de la centrale et les fonctions principales correspondantes (FP). - Chaudière : « Produire de la chaleur ». - Générateur de vapeur : « Produire de la vapeur à partir de la chaleur ». - Turbine : « Produire de l’énergie mécanique à partir de la vapeur ». - Générateur : « Transformer l’énergie mécanique en énergie électrique ». Niveau 3 : il poursuit l’analyse de manière descendante en fournissant de plus en plus de détails à chacune des parties du niveau 2. Remarque : le diagramme FAST et la méthode SADT sont d’autres exemples d’application. IUT GMP ANGERS 4 Diagramme FAST (Function Analysis System Technique) Lorsque les fonctions sont identifiées, cette méthode les ordonne et les décompose logiquement pour aboutir aux solutions techniques de réalisation. En partant d’une fonction principale, elle présente les fonctions dans un enchaînement logique en répondant aux trois questions : - Pourquoi cette fonction doit-elle être assurée ? - Comment cette fonction doit-elle être assurée ? - Quand cette fonction doit-elle être assurée ? Fonctions devant être réalisées en même temps Fonctions alternatives possibles IUT GMP ANGERS 5 Exemple de diagramme FAST avec ses différents niveaux d’analyse Méthode SADT Elle reprend les principes précédents mais utilise des règles précises et un formalisme plus complexe. Principe : elle utilise des boites numérotées et des flèches codifiant les relations ou contraintes entre celles-ci. Les côtés des boites ont une signification particulière : - Les données d’entrée (flèche arrivant côté gauche) sont transformées en données de sortie (flèche sortant côté droit) par la fonction indiquée dans la boite. La sortie de chaque boite peut devenir l’entrée ou le contrôle d’une ou plusieurs autres boites. - Les contrôles (flèches arrivant côté haut) indiquent les données et paramètres régissant la transformation réalisée par la fonction. - Les mécanismes (flèches arrivant côté bas) précisent le support de la fonction : machine, appareil, moteur, capteur, … Forme générale des boîtes Actigramme Datagramme IUT GMP ANGERS 6 Exemple : Store extérieur automatique Si l’intensité de la lumière solaire mesurée par le capteur solaire est suffisamment forte, le store s’abaisse automatiquement ou est déroulé par le tambour moteur. Si l’intensité du vent mesurée par l’anémomètre est à un niveau trop élevé, le store est remonté ou enroulé. Les mesures du capteur solaire et de l’anémomètre sont transmises à la centrale qui gère les informations et commande le tambour moteur. Niveau A-0 Niveau A0 Niveau A3 IUT GMP ANGERS 7 2. COTATION TOLERANCEE, AJUSTEMENTS ET CHAÎNES DE COTES A. Cotation dimensionnelle. Généralité La plupart des dimensions sont indiquées sous forme de côtes. Une cote se compose de 4 éléments principaux : - Une ligne de cote, - Deux lignes d’attache, - Deux flèches précisant la limite, - Un texte. Cotation multiple Elle peut être réalisée à partir d’une ligne commune (cas d’une surface de référence), avec un espacement régulier entre chaque cote ou suivant une ligne continue. IUT GMP ANGERS 8 Ecriture des tolérances Elles doivent être inscrites sous forme chiffrées à la suite de la dimension nominale. Deux valeurs sont nécessaires, l’une doit donner la valeur maximale de la cote et l’autre la valeur minimale. L’écriture est souvent réalisée à partir d’un écart supérieur et d’un écart inférieur. L’utilisation des limites est aussi possible mais très peu répandu. Cotation des diamètres Cotation des rayons, des sphères et des surplats carrés IUT GMP ANGERS 9 Cotation des perçages et lamages Cotation des chanfreins IUT GMP ANGERS 10 Règles pour réussir une cotation Organisation générale : - N’indiquer que les cotes nécessaires, éviter la surabondance, - Toutes les cotes doivent être écrites à partir de la même unité (mm), - Une même cote ne doit apparaitre qu’une seule fois dans tout le dessin, - Agencer et organiser la disposition des cotes afin d’obtenir un ensemble homogène, - Pour les trous, coter le diamètre plutôt que le rayon. Règle de tracé : - Placer de préférence la cote en dehors des vues, - Faire démarrer la ligne de rappel à partir des traits continus forts, ou des traits d’axes, - Placer les cotes à intervalle régulier si celles-ci se superposent. IUT GMP ANGERS 11 Faire une cotation suffisante, éviter toute cotation surabondante Une cotation surabondante provoque des choix et des priorités qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. Il faut éviter qu’au moment de la fabrication il y ait, pour une même forme, à choisir entre deux dimensions possibles. Il faut éviter l’inscription de chaînes de cotes dans uploads/Industriel/ m2101-cm-etude-de-la-conception.pdf
Documents similaires
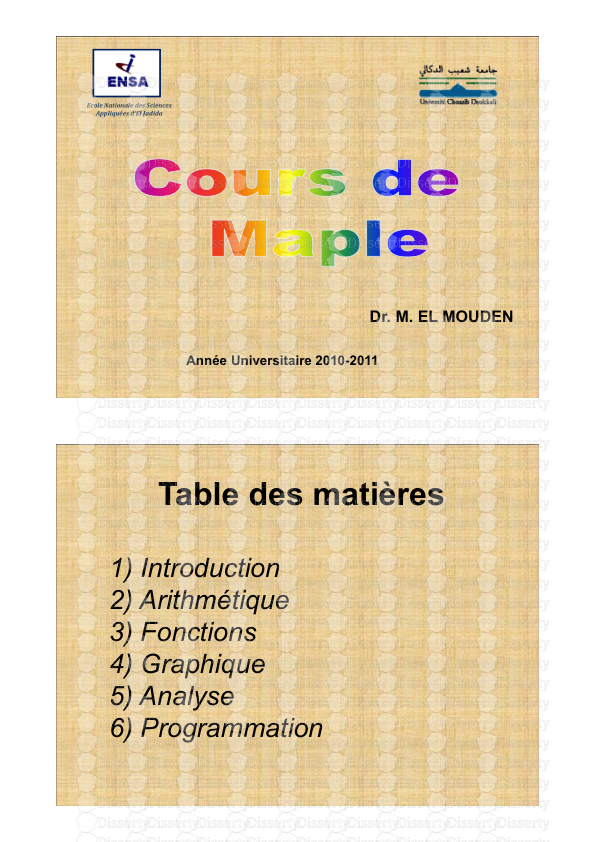

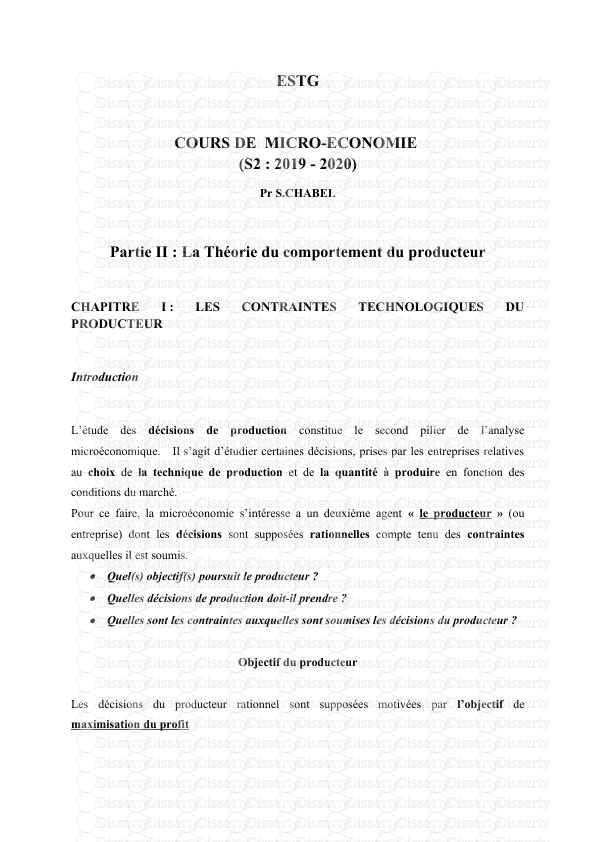







-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 3.7059MB


