Révisions : Dosage colorimétrique (2 Sujets et corrigés) Exercice 1 : Extrait d
Révisions : Dosage colorimétrique (2 Sujets et corrigés) Exercice 1 : Extrait de « Chimie et lutte contre les maladies de certaines plantations agricoles » Document 1. La chlorose des végétaux La chlorose des végétaux est une décoloration plus ou moins prononcée des feuilles, due à un manque de chlorophylle. La chlorophylle permet la photosynthèse et donne aux feuilles leur couleur verte. Le manque de chlorophylle peut provenir d'une insuffisance en magnésium, en fer, en azote, en manganèse ou en zinc, autant d'éléments chimiques indispensables à la synthèse de la chlorophylle. Dans le commerce, on trouve des solutions dites « anti-chlorose » riches en ions fer (lI) qu'il convient de pulvériser directement sur les plantes et les sols. Quelques noms commerciaux et caractéristiques des produits « anti-chlorose » Nom du produit commercial Teneur en fer (g.L−1) Utilisation référencée Fer A 400 LiquidoFer 400 40 Dépôt sur les sols Fer Cler 25 Dépôt sur les sols Fer Soni H39F 20 Dépôt sur les sols et pulvérisation sur les feuilles FerroTonus 40 Dépôt sur les sols PlantoFer 30 30 Dépôt sur les sols FerMi H31 10 Dépôt sur les sols et pulvérisation sur les feuilles Une solution inconnue « anti-chlorose » est à disposition d'un jardinier. Afin d'utiliser le plus efficacement possible ce produit, il doit retrouver le fournisseur du produit et ainsi consulter sur son site commercial la dose d'application nécessaire et suffisante pour traiter les rosiers. Pour cela, il doit doser les ions fer (lI) que la solution contient en suivant le protocole décrit dans le doc 2. Document 2. Protocole de titrage des ions fer (lI) dans une solution « anti-chlorose » Diluer 30 fois une solution « anti-chlorose » S contenant les ions Fe2+ de concentration molaire volumique c à déterminer. La solution ainsi obtenue est appelée S' ; Introduire dans un erlenmeyer un volume V1 = 20,0 mL de solution S' et de l'acide sulfurique ; Réaliser le titrage à l'aide d'une solution titrante de permanganate de potassium de concentration c2 = 5,0×10−3 rnol.L−1 en ions permanganate MnO4 −. L'équation de la réaction support du titrage s'écrit: MnO4 − (aq) + 5 Fe2+ (aq) + 8 H+ (aq) Mn2+ (aq) + 5 Fe3+ (aq) + 4 H2O(l) On admet que toutes les espèces chimiques mises en jeu au cours de ce titrage sont incolores ou peu colorées, à l'exception des ions permanganate MnO4− qui donnent au liquide une couleur violette. Donnée: Masse molaire atomique du fer : M(Fe) = 56 g.mol−1 1. En quoi l'usage d'une telle solution peut permettre de lutter contre la chlorose des végétaux ? 2. Lors du titrage réalisé, l'équivalence est obtenue pour un volume versé VE = 9,5 mL de la solution de permanganate de potassium. Comment cette équivalence est-elle repérée ? 3. À partir de ce titrage, le jardinier détermine le nom du produit commercial mis à sa disposition. Expliquer sa démarche, détailler ses calculs et donner le nom du produit commercial. 4. Pour estimer l'incertitude sur la valeur de la concentration obtenue par cette méthode de titrage, l'expérimentateur est amené à reproduire un grand nombre de fois la même manipulation dans les mêmes conditions. Un des titrages réalisés donne une valeur de concentration très élevée en ions Fe2+ par rapport aux autres. Il est possible d'identifier deux erreurs de manipulations : la solution titrante de permanganate de potassium a été diluée par mégarde ; le volume de solution à doser a été prélevé en trop faible quantité. 4.1. Indiquer dans quel sens chacune de ces deux erreurs de manipulation modifie la valeur expérimentale du volume VE de solution titrante versée à l'équivalence. Justifier chaque réponse. 4.2. Si l'on admet qu'une seule erreur de manipulation est la cause de la valeur très élevée de la concentration en ions Fe2+, laquelle a été commise ? Justifier votre réponse Exercice 2 : Les pluies acides Depuis le début des années 1950, on observe une augmentation de l’acidité des eaux de pluie dans diverses régions du monde. Ces « pluies acides » résultent essentiellement de la présence dans l’air de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote. Ces gaz sont issus de différentes activités industrielles et de la combustion de produits fossiles riches en soufre. Ils se dissolvent dans la vapeur d’eau de l’atmosphère et forment des espèces acides (notamment de l’acide sulfurique et de l’acide nitrique) qui acidifient les pluies […] D’après cnrs.fr Le dioxyde de soufre issu de l’activité humaine est, entre autres, émis par les industries pétrolières et les centrales thermiques ; ce gaz est un traceur de pollution industrielle. Il est donc important d’en évaluer la concentration. L’objectif de cet exercice est de savoir si une centrale thermique exploitant la combustion de carburants provenant du pétrole dépasse les seuils de qualité concernant le dioxyde de soufre. Pour cela, on fait barboter pendant soixante heures, 10,0 m3 de gaz émis par la centrale dans 1,0 L d’eau : on obtient la solution S0 que l’on analyse. On place 25,0 mL de la solution S0 dans un erlenmeyer. On verse ensuite, goutte à goutte une solution de permanganate de potassium de concentration molaire 1,0010–4 mol.L-1 jusqu’à persistance de la coloration violette, le volume de solution de permanganate de potassium alors versé est de 5,4 mL. 1. Questions préliminaires 1.1. Sachant que les couples oxydant/réducteur mis en jeu sont MnO4 – (aq)/Mn2+ (aq) et SO4 2– (aq)/SO2(aq), retrouver l’équation de la réaction modélisant l’action du dioxyde de soufre avec les ions permanganate MnO4 – (aq). 1.2. Expliquer l’évolution de la couleur de la solution contenue dans l’erlenmeyer au fur et à mesure de l’ajout de la solution de permanganate de potassium. 2. Problème : En faisant l’hypothèse que la totalité du dioxyde de soufre présent dans les effluents gazeux de la centrale thermique se dissout dans l’eau recueillie, déterminer si les gaz émis par la centrale sont conformes aux normes de qualité de l’air. L’analyse des données ainsi que la démarche suivie seront évaluées et nécessitent d’être correctement présentées. Les calculs numériques seront menés à leur terme avec rigueur. Il est aussi nécessaire d’apporter un regard critique sur le résultat et de discuter de la validité de l’hypothèse formulée. Données : Élément S O Masse molaire atomique 32,1 g.mol-1 16,0 g.mol-1 le dioxyde de soufre a des propriétés réductrices et l’ion permanganate est un puissant oxydant. Ces deux espèces chimiques réagissent ensemble selon la réaction d’équation : 2 MnO4 – (aq) + 5 SO2(aq) + 2 H2O(l) 2 Mn2+ (aq) + 5 SO4 2– (aq) + 4 H+ (aq) couleur des solutions aqueuses : Solutions aqueuses Solution d’acide sulfurique (2H+ (aq) + SO4 2– (aq)) Solution de sulfate de manganèse (Mn2+ (aq) + SO4 2– (aq)) Solution de permanganate de potassium (K+ (aq) + MnO4 – (aq)) Solution de dioxyde de soufre SO2(aq) couleurs des solutions aqueuses incolore incolore violet incolore Document : Normes de qualité de l’air relatives au dioxyde de soufre (SO2) : La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe fixe des normes pour le SO2 : Seuil d’information et de recommandation(1) : 300 g/m3 en moyenne sur 1 heure Seuil d’alerte(2) : 500 g/m3 sur 3 heures consécutives (1) Le seuil d’information correspond à un niveau de concentration de substances polluantes au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires. (2) Le seuil d’alerte correspond à un niveau de concentration de substances polluantes au- delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent impérativement prendre des mesures. Eléments de réponse – Exercice 1 Chimie et lutte contre les maladies de certaines plantations agricoles 1. L’usage d’une telle solution permet de combler la carence en fer à l’origine de la chlorose. 2. La solution titrante (contenue dans la burette) contient la seule espèce colorée (MnO 4 –). Avant l’équivalence, les ions MnO4 − sont consommés par les ions Fe2+ de la solution titrée qui reste incolore. Lorsque l’équivalence est atteinte, les ions MnO4 − ne sont plus transformés et colorent alors la solution contenue dans le bécher en violet : l’équivalence est donc repérée par la persistance de la coloration violette dans le bécher. 3. Afin de déterminer le nom du produit commercial, le jardinier doit déterminer sa concentration massique en fer. L’équation de la réaction du titrage de S’ (de concentration c’ = [Fe2+]S’) est donnée dans le document 2 : MnO4 − (aq) + 5 Fe2+ (aq) + 8 H+ (aq) → Mn2+ (aq) + 5 Fe3+ (aq) + 4 H2O(liq) À l’équivalence, les espèces réagissantes ont été introduites en quantités stœchiométriques : = n = 5 × n n = [MnO4 −] × VE = c2 × VE n = [Fe2+]S’ × V1 = c’ uploads/Industriel/ revisions-titrage-colorimetrique.pdf
Documents similaires


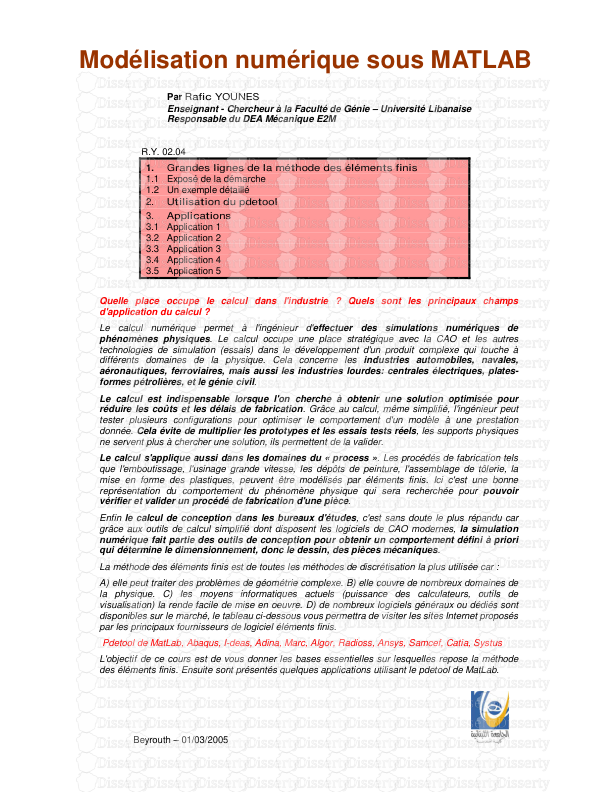







-
55
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 03, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1518MB


