Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Niveau(x) : Terminale S
Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Niveau(x) : Terminale S Type d’activités : activités documentaire et de modélisation Support : modèles moléculaires et revues scientifiques Durée estimée : 1 h 30 si étude des documents préalablement préparée à la maison Prérequis : o molécules organiques colorées : structures moléculaires, molécules à liaison conjuguées ; liaison covalente ; formule de Lewis ; géométrie des molécules ; isomérie Z/E (programme de 2nde) o molécules simples ou complexes : structures et groupes caractéristiques ; formules et modèles moléculaires ; formules développées et semi-développées ; isomérie (programme de 1ère S) Compétences exigibles (BO) : o A partir d’un modèle moléculaire ou d’une représentation, reconnaitre si des molécules sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence des propriétés différentes de diastéréoisomères. o Visualiser, à partir d’un modèle moléculaire ou d’un logiciel de simulation, les différentes conformations d’une molécule. Compétences travaillées : Extraire et exploiter ; utiliser un modèle moléculaire pour comprendre REPRESENTATION SPATIALE DES MOLECULES Résumé : Lors de ce TP, les élèves découvrent par la manipulation de modèles moléculaires l’existence d’isomères qui se distinguent uniquement par une représentation spatiale des atomes : les stéréoisomères. Une étude de documents sera également l’occasion de mentionner l’importance des conformations et configurations dans le milieu biologique. Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Extrait de « Le monde de la chiralité » Auteurs : Claude Gros doctorant, Gilles Boni docteur ès sciences Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR TP-COURS : STEREOISOMERIE Introduction : En seconde et en première, nous avons défini des isomères comme étant des molécules de mêmes formules brutes mais de formules semi-développées différentes. Une représentation plane suffit pour distinguer ces isomères de constitution (de chaîne, de position et de fonction). Il existe d’autres isomères qui se distinguent uniquement par une représentation spatiale des atomes : ce sont les stéréoisomères. Il y a les stéréoisomères de configuration (énantiomères et diastéréoisomères) et les stéréoisomères de conformation. Les stéréoisomères peuvent avoir des propriétés physiques, chimiques et biochimiques différentes. Quelques indications: - Modifier la configuration d’un carbone revient à casser deux liaisons pour les intervertir. - Modifier la conformation d’une molécule revient à faire une rotation autour d’une liaison simple C-C. - Un carbone asymétrique C* est un carbone lié à quatre atomes ou groupes d’atomes différents. - Une molécule est chirale si elle n’est pas superposable à son symétrique dans un miroir, quelle que soit sa conformation. Dans la suite du TP, vous utiliserez la boite de modèle moléculaire mise à votre disposition dont le code couleur est le suivant : Boule verte : Cl Boule rouge : Br Boule bleu : I Représentation de Cram : Représentation de Newman : On regarde la molécule vue dans l’axe de rotation C-C. Le carbone à l’arrière est représenté par un cercle. Le carbone à l’avant est représenté par un point. Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR 1. Stéréoisomères de configuration 1.1. Molécule chirale Pour chacune des molécules suivantes : CH2BrI, CHBrICl, CHClBr-CHClBr (deux cas de figure), construire la molécule A à l’aide de la boîte de modèles moléculaires puis son symétrique B dans un miroir et compléter le tableau. Quel lien y a-t-il entre plan ou centre de symétrie, chiralité et nombre de carbones asymétriques ? 1.2. Enantiomères Une molécule chirale A, a deux énantiomères : elle-même et son symétrique B dans un miroir. Construire et représenter les deux énantiomères A et B de la molécule chirale CHICl- CHClBr. Molécules A Représentation de Cram Plan ou centre de symétrie ? Nombre de carbones asymétriques ? Représentation de Cram du symétrique B dans un miroir Chirale ? CH2BrI CHBrICl CHClBr- CHClBr CHClBr- CHClBr Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR 1.3. Diastéréoisomères La molécule chirale CHICl-CHClBr a deux autres stéréoisomères C et D, différents de ses énantiomères A et B (non superposables) : ce sont des diastéréoisomères. Consignes : - En vous regroupant avec la table voisine, construire trois molécules A identiques et une molécule B, énantiomère de A. - Modifier la configuration d’un seul carbone asymétrique d’une molécule A pour obtenir une nouvelle molécule C. - Construire la molécule D. 1.3.1. Donner la représentation de Cram de chaque molécule. 1.3.2. Qu’obtiendra-t-on si on modifie la configuration des deux carbones asymétriques de A ? Vérifiez-le. 1.3.3. Pour les plus rapides, vérifier que CHBrCl-CHBrCl n’a que trois stéréoisomères, sans construction, à partir du 1.3.1. 1.4. Diastéréoisomères Z, E La rotation autour d’une double liaison C=C étant impossible, - construire puis représenter les deux stéréoisomères possibles du 1,2-dibromoéthène CHBr=CHBr ; - indiquez leurs noms. - conclure : cette molécule est-elle chirale ? Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR 2. Stéréoisomères de conformation A l’aide de la boîte de modèles moléculaires, construire la molécule d’éthane CH3-CH3 et modifier sa conformation. Représentez sa conformation la moins stable et sa conformation la plus stable en utilisant la représentation de Newman. Quelle est d’après vous la conformation qui a la plus grande proportion dans un échantillon d’éthane ? Justifier. 3. Propriétés différentes de diastéréoisomères Matériels : balance, capsule, tubes à essais, éprouvette graduée, papier pH, verre de montre, pipette simple, eau distillée, acide fumarique A et acide maléique B en poudre. A et B sont deux diastéréoisomères Z/E. Consignes : - Suggest a protocol allowing to determine which of A or B is the more soluble in water. Please, do this experiment only after your teacher’s approval. - Suggest a protocol allowing to determine which of A or B is more acidic in water. Please, do this experiment only after your teacher’s approval. - Conclure sur les propriétés physiques des diastéréoisomères. Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Etude de documents Doc.1 Document 1 : Historique : le mystère de l’acide racémique La lumière « naturelle » peut être décrite comme une onde qui vibre dans toutes les directions perpendiculaires à sa direction de propagation. Une lumière polarisée ne vibre que dans une seule direction. Dès le début du XIXe siècle, les Savants comme Jean-Baptiste Biot en 1815 constatèrent que certains composés (cristal de quartz, essence de térébenthine) font tourner la direction de vibration de la lumière polarisée qui les traverse alors que d’autres (éthanol, eau) ne la modifient pas (Fig.1). Fig.1 Déviation de la direction d'une lumière polarisée. Fig.2. Dessins de cristaux d’acide tartrique. L`acide tartrique est une molécule présente dans de nombreuses plantes ; elle peut aussi être synthétisée. Vers 1820, un industriel constata l’apparition d`un nouvel acide dans ses préparations d`acide tartrique. Les chimistes s'y intéressèrent et l’appelèrent acide racémique : ils constatèrent qu`il avait la même formule brute que l'acide tartrique (C4H6O6) mais était sans effet sur la lumière polarisée alors qu'une solution d'acide tartrique naturel déviait la direction de polarisation vers la droite. En 1848, en examinant à la loupe un dérivé d`acide tartrique, Louis Pasteur constata que les minuscules cristaux qui le constituaient présentaient une dissymétrie, toujours orientée de la même façon (Fig.2). Dans le même dérivé d'acide racémique, Pasteur observa la coexistence de deux types de minuscules cristaux en quantités égales : l’un était celui du dérivé d`acide tartrique, l’autre était son image dans un miroir (Fig. 2b). Ces deux formes étaient non superposables. Pasteur sépara à la pince les deux types de cristaux : la solution dans l’eau d'une des formes fit tourner la direction de polarisation de la lumière vers la gauche (Lévogyre). L’autre solution la fit tourner en sens inverse (Dextrogyre). Pasteur venait de mettre en évidence le lien entre l’activité optique et la chiralité, qui est la propriété des corps qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir plan, dénommés énantiomères ou antipodes optiques. D’après « Molécules chirales : Stéréochimie et propriétés » Auteurs : André Collet, Jeanne Crassous, Jean-Pierre Dutasta, Laure Guy Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Document 2 : Propriétés physiques de l’acide tartrique 1. Qu’est-ce qu’un mélange racémique? 2. Que peut-on dire sur les propriétés physiques de deux énantiomères ? 3. Comment expliquer que l’acide tartrique racémique n’a pas d’effet sur la lumière polarisée ? 4. Identifier le ou les carbones asymétriques sur la représentation de la molécule d’acide tartrique ? Académie de Clermont-Ferrand Groupe de travail TZR Document 3: Propriétés biologiques des énantiomères Au XIXème siècle, on utilisait déjà des principes actifs chiraux comme la morphine, administrée comme antidouleur et extraite du pavot ou la quinine, prescrite comme antipaludique et extraite des écorces de quinquina. La structure chimique et tridimensionnelle de ces molécules n'était cependant pas connue. Malgré les idées énoncées par Pasteur à la fin du XIXème, les chimistes ont mis beaucoup de temps pour comprendre que la chiralité pouvait avoir un impact considérable sur les organismes vivants. Cette prise de conscience a eu lieu dans les années 1960 avec le drame de la thalidomide, médicament qui fut administré aux femmes enceintes comme anti-vomitif, et qui provoqua chez les nouveau-nés de graves malformations. On connaît aujourd'hui la raison de ce drame : alors que l'énantiomère uploads/Ingenierie_Lourd/ activite-stereoisomerie.pdf
Documents similaires


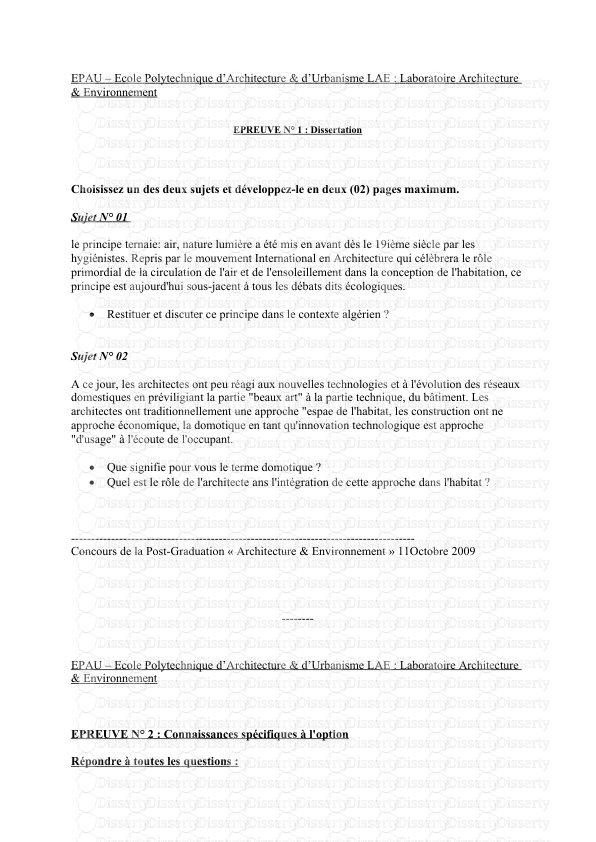







-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 31, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7744MB


