Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°4
Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°4 - 2017 -1- Déchéance des métiers traditionnels du bâtiment en Tunisie sous le protectorat français : causes, effets et tentatives de préservation Faiza Matri Résumé La conservation du patrimoine architectural est entravée par plusieurs handicaps dont le plus sérieux est causé par la disparition des savoirs et savoir-faire indispensables à la réussite de tout projet de préservation. La raréfaction du nombre d’artisans traditionnels est causée par la crise des métiers artisanaux qui remonte au XIXe siècle. En remontant aux origines de cette crise, le présent article a pour objectif d’exposer les spécificités des métiers traditionnels du bâtiment en Tunisie ; d’examiner, par la suite, les solutions adoptées pour leur sauvegarde ; et de faire finalement le diagnostic des corporations artisanales en suivant leurs activités dans les chantiers de construction et de restauration du XXe siècle. Mots-clés : Savoir-faire, artisan, corporation, conservation, architecture. Pour citer cet article : Faiza Matri, « Déchéance des métiers traditionnels du sous le protectorat français : causes, effets et tentatives de préservation », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°4, Année 2017. URL: http://www.al-sabil.tn/?p=3355 Maitre- Assistante – ENAU - Université de Carthage. . Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°4 - 2017 -2- Dans leur rapport avec le patrimoine, les architectes et les historiens de l’art se sont surtout intéressés à la création des modèles et images à partir de l’art traditionnel. La réinterprétation de l’architecture traditionnelle a abouti à la création de nouveaux modèles architecturaux en utilisant les nouvelles techniques et modalités de gestion et d’organisation du chantier centralisé par l’architecte qui, depuis la Renaissance, devient le chef d’orchestre. Ce changement progressif des modes de vie, d’une façon générale, s’est accentué sous l’influence d’une économie capitaliste pendant le protectorat français et a aggravé la crise des vieilles industries tunisoises, notamment celles du bâtiment. Plusieurs solutions ont été adoptées telles que la pédagogie artistique ou les expositions et conservations muséologiques. L’apprentissage du savoir-faire traditionnel était une question qui préoccupait les praticiens, techniciens et acteurs du chantier. Il s’agissait souvent d’expériences ponctuelles dictées par des conditions politiques et économiques spécifiques. D’ailleurs, il n’y a jamais eu de suivi quant à ces expériences. I- Les métiers traditionnels du bâtiment : corporations autonomes ou structures dépendantes de l’architecte ? Le statut de l’architecte a été instauré en Occident depuis la Renaissance et a été défini en tant que personne capable de concevoir et tracer les plans d’un édifice et d’en diriger l’exécution1. Dans les pays du monde arabe, la maîtrise d’ouvrage a souvent été confiée à l’amine des maçons. Les connaissances techniques et artistiques attachées à sa profession lui permettaient la direction d’autres corps de métiers tels que les menuisiers, sculpteurs sur plâtre et peintres qui étaient chargés de la construction et de la décoration du bâtiment. Pouvons-nous qualifier les amines des maçons d’architectes, selon la compréhension occidentale du terme ? Le statut de l’architecte a été inauguré à Florence au XVe siècle en tant qu’intellectuel et artiste. L’architecture de la Renaissance n’était pas seulement un corps de connaissances pratiques, mais elle est devenue une nouvelle discipline basée sur la théorie et soumise à l’expérience. L’œuvre architecturale était conçue ; dessinée ; et exécutée par la suite sous la supervision de l’architecte. Ce dernier était également un théoricien qui rédigeait des traités sur l’architecture (Léon Battista Alberti, Francesco du Giorgio Martini, Andréa Palladio). Certains ateliers d’artistes comme ceux de Verrocchio ou de Bramante représentaient l’équivalent de clubs d’artistes qui attiraient, outre les peintres, les philosophes ; et dans lesquels on apprenait la musique et on s’intéressait aux mathématiques2. Quant à la Tunisie, le statut du maître d’œuvre en tant qu’expert chargé de la gestion des aspects techniques et esthétiques de l’ouvrage n’a pas fait défaut, avant le Protectorat. Cette tâche a souvent été confiée à l’amine des maçons. 1 Définition de l’architecte selon le petit Robert. 2 J. Castex, 2004. Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°4 - 2017 -3- Bien que certains amines des maçons aient été qualifiés d’architectes par les architectes occidentaux, l’amine était en réalité un artisan qui remplissait la fonction d’expert et de référent technique. En effet, les corps de métiers traditionnels étaient organisés en corporations, groupant à la fois apprentis, compagnons et maîtres soumis à la surveillance de l’amine. 1- Caractéristiques et organisation des corporations L’organisation intérieure des corporations était marquée par une division hiérarchique tripartite entre maîtres, compagnons et apprentis qui constituaient les trois grades de l’organisation corporative. L’apprentissage et l’attribution de ces grades se faisait sous forme de stages professionnels durant lesquels le futur « maître » devait parcourir les échelons de la formation commençant par le grade d’apprenti, puis compagnon pour devenir enfin maître. Cette formation pratique couvrait une période de 8 à 10 ans en moyenne3. Bien que la formation ait été purement pratique, elle était gérée par des codes coutumiers. Dans les corporations des tisserands ou des menuisiers, l’ascension au grade du maître était accompagnée par l’enregistrement du candidat au registre de corporation. L’usage de ce registre corporatif a disparu au début du XXe siècle4. Dans d’autres corporations comme celles des menuisiers ou des balghagiya, l’ascension au grade du maître était accompagnée par une épreuve pratique. Au sein de la corporation des balghagiya par exemple, le travail du candidat devait être évalué par l’amine assisté d’un jury qui évaluait la qualité du travail et remettait au nouveau maître un Baillot, un signe de sa nouvelle fonction5. Quant aux corporations des maçons, les auteurs n’ont jamais mentionné d’épreuves de passage. 2- L’amine des corporations et ses compétences Chaque corps de connaissances était placé sous l’autorité d’une amine. Le terme signifiait « un homme de confiance » et par extension « administrateur, surveillant »6. Bien que plusieurs catégories d’amines aient existé à l’exemple des amines de vives et des marchés chargés de la vérification des denrées et du contrôle de tous les commerçants de produits alimentaires ou encore les amines de l’agriculture - experts aux fonctions variées - dont certains étaient plus spécialisés que d’autres comme les amines des ouvriers des presses à l’huile7, les amines des corporations étaient les plus nombreux en Tunisie. L’amine était à la fois un agent de l’autorité et un représentant des corps de métiers. Il était choisi par les maîtres et présenté à l’agrément du bey, par l’intermédiaire de cheikh al médina, pour être nommé à vie par décret beylical. 3 La durée de l’apprentissage varie selon les métiers et les aptitudes de l’apprenti, pour lequel aucun âge minimum n’est fixé. La durée de l’apprentissage dans un grade a été estimée à 4 ou 5 ans environ ; P. Pennec, 1964, p. 34- 39 ; A. Atger, 1909, p. 109. 4 P. Pennec, 1964, p. 175. 5 A. Atger, 1909, p. 111. 6 Encyclopédie de l’Islam, 1960, Tome I, p. 331. 7 P. Pennec, 1964, p. 41. Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°4 - 2017 -4- L’amine avait également pour tâche de résoudre les désaccords entre patrons et ouvriers et de faire échec à toute forme de fraude en contrôlant le prix du travail et de la marchandise et en vérifiant les poids et les mesures8. Il était doté d’un pouvoir juridictionnel puisqu’il représentait l’auxiliaire de justice qui remplissait les fonctions d’experts : afin de réprimer les infractions aux coutumes, l’amine pouvait prononcer certaines sanctions à l’exemple de la destruction ou la confiscation de marchandises. Bien que l’amine ait rempli plusieurs fonctions administratives et économiques, et qu’il ait été doté d’un pouvoir juridictionnel, l’amine demeurait un artisan comme les autres. Il ne recevait ni salaire ni indemnité, mais plutôt un pourcentage à l’occasion de certaines opérations : l’amine appelé en contestation avait droit à une vacation de 2 % de la valeur de l’objet de litige9. 3- Les corporations des métiers du bâtiment Les métiers du bâtiment étaient classés en deux groupes : les corporations qui fournissaient les matériaux et celles qui les mettaient en œuvre. Les corps de métiers qui fournissaient les matériaux étaient les briquetiers, les fabricants d’enduits, les céramistes, les potiers qui fabriquaient aussi les tuiles auxquels on peut ajouter les ferronniers qui fabriquaient les grilles pour protéger les ouvertures. Les corps de métiers qui mettaient en œuvre les matériaux étaient les plâtriers, les menuisiers et les maçons ainsi que les puisatiers et les sculpteurs sur plâtre ou nakachas. Il existait parfois plusieurs amines pour un seul corps de métier, en particulier quand le nombre de celui-ci était dispersé dans plusieurs quartiers à l’exemple des maçons dont le nombre des amines s’élevait à 6 en 192410. Dans le domaine architectural, on a confié aux amines des maçons des projets de construction ou de réparation d’édifices. D’ailleurs, les architectes qui ont œuvré en Tunisie au cours du XIXe et XXe siècle nous ont laissé des descriptions et nous ont donné des indications sur leurs activités. Henri Saladin11, qui a fait des voyages successifs en Tunisie à partir de uploads/Ingenierie_Lourd/ al-sabil-n4faiza-matri-pdf.pdf
Documents similaires







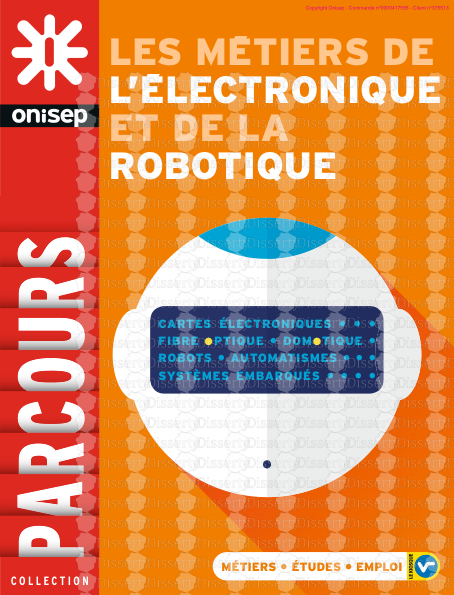


-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 06, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7688MB


