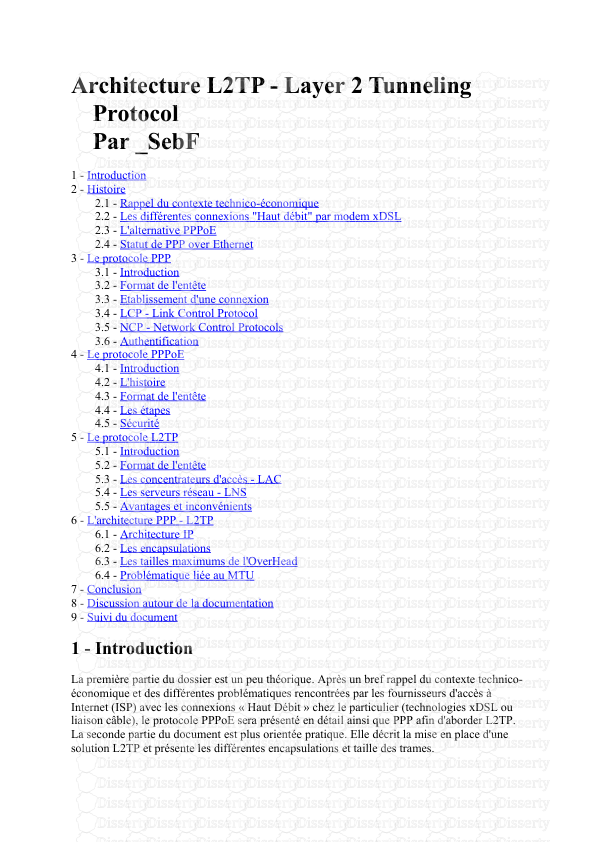Architecture L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol Par _SebF 1 - Introduction 2 - H
Architecture L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol Par _SebF 1 - Introduction 2 - Histoire 2.1 - Rappel du contexte technico-économique 2.2 - Les différentes connexions "Haut débit" par modem xDSL 2.3 - L'alternative PPPoE 2.4 - Statut de PPP over Ethernet 3 - Le protocole PPP 3.1 - Introduction 3.2 - Format de l'entête 3.3 - Etablissement d'une connexion 3.4 - LCP - Link Control Protocol 3.5 - NCP - Network Control Protocols 3.6 - Authentification 4 - Le protocole PPPoE 4.1 - Introduction 4.2 - L'histoire 4.3 - Format de l'entête 4.4 - Les étapes 4.5 - Sécurité 5 - Le protocole L2TP 5.1 - Introduction 5.2 - Format de l'entête 5.3 - Les concentrateurs d'accès - LAC 5.4 - Les serveurs réseau - LNS 5.5 - Avantages et inconvénients 6 - L'architecture PPP - L2TP 6.1 - Architecture IP 6.2 - Les encapsulations 6.3 - Les tailles maximums de l'OverHead 6.4 - Problématique liée au MTU 7 - Conclusion 8 - Discussion autour de la documentation 9 - Suivi du document 1 - Introduction La première partie du dossier est un peu théorique. Après un bref rappel du contexte technico- économique et des différentes problématiques rencontrées par les fournisseurs d'accès à Internet (ISP) avec les connexions « Haut Débit » chez le particulier (technologies xDSL ou liaison câble), le protocole PPPoE sera présenté en détail ainsi que PPP afin d'aborder L2TP. La seconde partie du document est plus orientée pratique. Elle décrit la mise en place d'une solution L2TP et présente les différentes encapsulations et taille des trames. L2TP, définit par la Rfc 2661, est issu de la convergence des protocoles PPTP et L2F. Il est actuellement développé et évalué conjointement par Cisco Systems, Microsoft, Ascend, 3Com ainsi que d'autres acteurs clés du marché des réseaux. Il permet l'encapsulation des paquets PPP au niveau des couches 2 (Frame Relay et ATM) et 3 (Ip). Lorsqu'il est configuré pour transporter les données sur IP, L2TP peut être utilisé pour faire du tunnelling sur Internet. L2TP repose sur deux concepts : les concentrateurs d'accès L2TP (LAC : L2TP Access Concentrator) et les serveurs réseau L2TP (LNS : L2TP Network Server). L2TP n'intègre pas directement de protocole pour le chiffrement des données. C'est pourquoi L'IETF préconise l'utilisation conjointe d'IPSEC et L2TP. 2 - Histoire 2.1 - Rappel du contexte technico-économique Les services Internet proposés au particulier et aux petites entreprises sont de plus en plus nombreux (connexion via un fournisseur d'accès, travail à distance, services à valeur ajoutée tels que l'e-mail, serveur Web hébergé, VPN, etc.). Cette population appelée communément SOHO (Small Office / Home Office) est la cible des grands de l'industrie du réseau (opérateurs, constructeurs, etc.). En effet, le besoin de connexion à « Haut-débit » est de plus en plus fort, mais face à des technologies de plus en plus complexes, les déploiements sont ralentis car trop coûteux (liens fibres optiques, terminaux de connexion ATM), trop spécifiques (encapsulations multiples des protocoles pour interfacer PC et modem) ou encore trop difficiles à mettre en place par les opérateurs (configuration, formation des utilisateurs). Différentes propositions ont été faites afin de « standardiser » et « simplifier » le mode de connexion entre un micro-ordinateur personnel PC et un modem de type xDSL ou modem câble. Ces différentes solutions sont présentées en paragraphe II.2. Rappelons que les objectifs qui animent ces recherches sont la facilité et la vitesse de déploiement des connexions « Haut débit » chez les consommateurs SOHO, et de surcroît à moindre coût ! 2.2 - Les différentes connexions "Haut débit" par modem xDSL Dans le cas de connexion par RTC (Réseau Téléphonique Commuté), les utilisateurs finaux (SOHO ou particuliers pour un usage privé) sont habitués à utiliser un matériel « banalisé » comme un modem analogique fonctionnant en bande téléphonique analogique (30Hz -> 3,6 KHz), dont le coût d'achat est faible, et surtout dont la configuration est minimale (utilisation des protocoles PPP, SLIP, RAS, etc. nativement gérés par les systèmes d'exploitations les plus répandus du marché). Dans le cadre des connexions « Haut-débit », un matériel plus sophistiqué de type modem xDSL ou modem câble est nécessaire. Son coût d'acquisition est plus élevé que dans le cas précédent, et la configuration est plus complexe car elle s'appuie sur des technologies plus élaborées. Les recherches menées par l'industrie du réseau et des télécommunications ont abouti à plusieurs propositions d'architecture décrites ci-après, chacune basée sur les technologies ATM sur xDSL. Un des objectifs étant la simplicité de configuration, le protocole PPP a été retenu comme point de départ. Chacune des solutions diffère sur le mode de connexion entre le micro-ordinateur et le modem xDSL. 2.2.1 - ATM sur interface xDSL Le schéma suivant présente la première proposition de configuration. Une carte d'interface xDSL est implantée directement dans le micro-ordinateur, sur lequel sont installés un driver PPP et un driver ATM. L'avantage principal est l'utilisation de PPP pour l'utilisateur, donc la configuration et la procédure de connexion est connue car identique à celle utilisée dans le cas de connexion analogique par RTC. La connexion PPP s'effectue au travers de la boucle locale jusqu'au réseau de données régional vers un POP (Point-Of- Presence) de fournisseur d'accès. Deux inconvénients majeurs à cette architecture : Le marché des interfaces xDSL n'en est qu'à ses premiers pas et le manque d'inter-opérabilité entre les différents équipements xDSL ne permet pas la réalisation d'économies d'échelles nécessaires pour la production d'interfaces xDSL standards à coût réduit. La ligne xDSL ne peut être utilisée que par un seul micro-ordinateur à la fois, ce qui limite l'intérêt de ce type de connexion pour les SOHO. 2.2.2 - Interface ATM et modem xDSL La seconde proposition d'architecture est présentée dans le schéma ci-dessous. Les limites reconnues d'une interface xDSL, les approches suivantes, dont celle-ci, s'appuient sur un équipement xDSL externe (modem). La configuration proposée ici repose sur un lien ATM entre le micro-ordinateur et le modem xDSL. A cet effet, une interface ATM est implantée dans le PC. Les inconvénients de cette proposition sont les suivants : Les interfaces ATM sont peu répandues chez les utilisateurs finaux. Cette configuration était la première hypothèse des opérateurs pour le déploiement des connexions « Haut débit » chez le consommateur. Pour rappel, elle n'a pas été retenue pour des raisons économiques. De plus, ce type d'interface est difficile à installer et à configurer par l'utilisateur. Cette complexité risque de ralentir le déploiement et l'acceptation de la technologie xDSL chez les consommateur. Il n'existe pas d'interface ATM pour les micro-ordinateurs portables, ce qui est un inconvénient pour les SOHO, le plus souvent nomades. Le partage d'une telle connexion nécessite l'utilisation d'un commutateur ATM, ce qui rend difficile, voir quasi impossible le déploiement d'un telle solution. 2.2.3 - Interface Ethernet, L2TP sur IP et modem xDSL La troisième solution est présentée dans le schéma suivant. Cette architecture est plus « ouverte » dans la mesure où le lien entre le micro-ordinateur et l'équipement xDSL repose sur une technologie éprouvée : Ethernet. En effet, le modem xDSL dispose d'un banal connecteur Ethernet qui peut être soit attaché directement à une carte Ethernet implantée dans le client PC (liaison à l'aide d'un câble « croisé » ou « droit » ), soit indirectement via un Hub (ou Switch) Ethernet. Le micro-ordinateur doit être configuré comme sur un réseau local d'entreprise (LAN : Local Area Network), c'est à dire : posséder un driver de carte réseau (NIC Ethernet), une pile de protocole TCP/IP, et une couche logicielle permettant la gestion de sessions PPP (pour la connexion à l'ISP). Cette topologie a l'avantage de permettre le partage de la connexion xDSL au travers d'un réseau. Autre avantage d'un telle architecture : le coût peu élevé de l'équipement. A noter quand même les quelques inconvénients suivants : Cette configuration n'intègre pas nativement ce qui est nécessaire au départ, à savoir un mécanisme de transport et de gestion de sessions PPP au travers d'Ethernet. L'utilisation d'un protocole de « tunneling » comme L2TP (ou PPTP) peut s'avérer un moyen pour assurer le transport de PPP sur IP, mais ajoute une complexité à la configuration. Le modem xDSL doit, dans ce type de solution, posséder une adresse IP (configurable de préférence) pour la communication au niveau du réseau Ethernet. Le client PC a donc quant à lui deux adresses IP : la première pour la connexion au réseau Ethernet (afin d'établir correctement le tunnel L2TP), la seconde pour la liaison PPP vers un ISP. Quelles adresses IP utiliser pour établir le tunnel L2TP entre le client PC et le modem xDSL ? Une des réponses possibles à cette problématique est l'implantation et l'utilisation combinée de mécanismes comme NAT (Network Address Translation : translation d'adresses IP d'un réseau vers un autre) et DHCP (attribution dynamique d'une adresse IP à un client, à partir de plages définies). Même si ces techniques sont connues et maîtrisées dans le monde du réseau, elles sont loin d'être à la portée des utilisateurs finaux. 2.2.4 - Interface uploads/Ingenierie_Lourd/ architecture-l2tp.pdf
Documents similaires




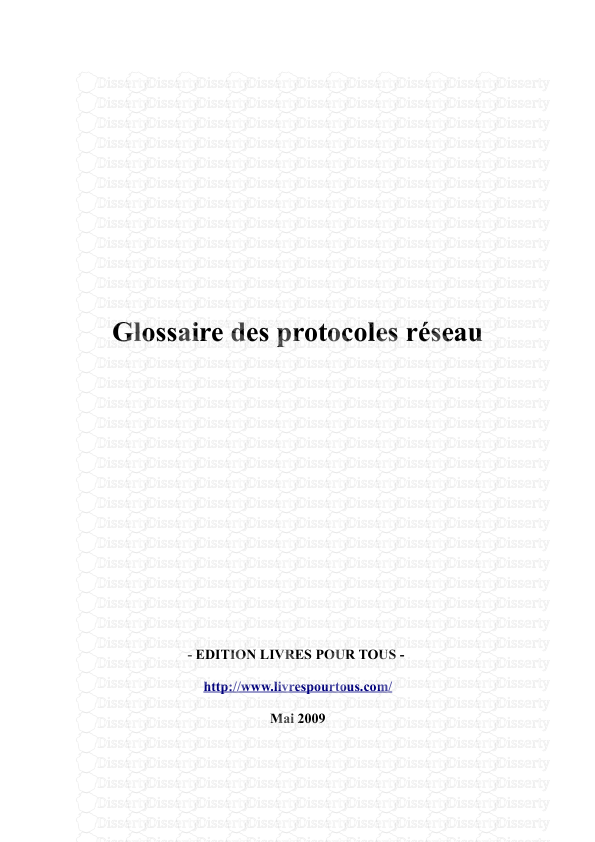





-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 23, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2321MB