` \ I- INTRODUCTION II- PRINCIPES DE BASE DE L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 1- L’
` \ I- INTRODUCTION II- PRINCIPES DE BASE DE L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 1- L’architecture bioclimatique en quelques mots 2- Les climats chauds 3- Les principes 4- Méthodologie de projet 5- Insertion dans le territoire 6- Matériaux et chantier 7- Confort et santé à l’intérieur III- PROBLEMES OBSERVES ET SOLUTIONS TECHNIQUES IV- METHODES D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 1- Capter ou se protéger de la chaleur 2- Transformer ou diffuser la chaleur 3- Conserver la chaleur ou la fraîcheur 4- Valoriser l’environnement V- NOTIONS THEORIQUES 1- Caractéristiques énergétiques des matériaux 2- Inertie thermique 3- Effusivité 4- Diffusivité 5- Amortissement thermique 6- Déphasage thermique 7- Gestion de l’air VI- RESULTATS ATTENDUS ET STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE VII- CONCLUSION Exposé sur L’Architecture Bioclimatique Page 2 I- INTRODUCTION : L’architecture bioclimatique est l’architecture la plus ancienne : utilisation de matériaux locaux, volonté de se protéger des contraintes climatiques, recours à des systèmes ingénieux pour améliorer le confort, habitations troglodytes ou vernaculaires, etc. La standardisation actuelle tend à éloigner l’architecture de son environnement, mais le retour de tels concepts apparaît inévitable dans des pays confrontés à un manque de moyens et à un problème d’accès à l’énergie ne leur permettant pas de disposer autrement de logements confortables. Ainsi, l’architecture bioclimatique répond en partie à cette problématique par l’intégration de concepts passifs permettant de minimiser le recours à la consommation énergétique (notamment pour la climatisation dans les pays chauds) et l’impact sur l’environnement sans négliger le bien-être de l’occupant. L’enjeu est de proposer des habitations confortables et économes énergétiquement en utilisant au maximum les ressources disponibles à proximité (ressources matérielles, main-d’œuvre, valeurs culturelles également). II- PRINCIPES DE BASE : 1- L’architecture bioclimatique en quelques mots : L’architecture bioclimatique utilise le potentiel local (climats, matériaux, main-d’œuvre…) pour recréer un climat intérieur respectant le confort de chacun en s’adaptant aux variations climatologiques du lieu. Elle rétablit l’architecture dans son rapport à l’homme et au climat. C’est pourquoi on ne peut définir une unique typologie de l’architecture bioclimatique : il y en a autant que de climats. Ceci est d’autant plus vrai que le confort de chacun se déplace avec les conditions climatologiques. L’architecture bioclimatique passe donc inévitablement par une excellente connaissance de son environnement. 2- Les climats chauds : Les climats chauds sont caractérisés par des températures moyennes annuelles comprises entre 20 et 35 °C et se répartissent en deux catégories Exposé sur L’Architecture Bioclimatique Page 3 principales en fonction de l’humidité, qui a un effet conséquent sur la proportion de radiations solaires directes ou diffuses (figures 1 et 2) : – sec, pour une humidité relative inférieure à 55 % (climats tropical sec, désertique, chaud d’altitude) ; – humide, pour une humidité relative supérieure à 55 % (climats équatorial, tropical de mousson, tropical humide, méditerranéen). Figure 1 : Rayonnement solaire Figure 2 : Les zones climatiques chaudes Equatorial Tropical de mousson Tropical humide Tropical sec Désertique Chaud d’altitude Méditerranéen 3- Les principes : À partir de là, il est tout à fait possible de définir une stratégie de conception architecturale au cas par cas et proposer une habitation permettant de se protéger des fortes chaleurs et des fortes radiations solaires, utilisant une ventilation naturelle et offrant un abri confortable en toute saison. Il est alors envisageable d’estimer grossièrement les besoins énergétiques car même si Exposé sur L’Architecture Bioclimatique Page 4 l’accès à l’électricité (éclairage principalement) et à l’eau chaude est indispensable, la production de chaleur et/ou de froid peut être évitée ou largement limitée. L’intégration du bâtiment dans son environnement est le premier principe de l’architecture bioclimatique : il est indispensable d’avoir une parfaite connaissance des vents dominants, de la radiation solaire incidente et des masques solaires voisins, des risques d’inondations, de la végétation environnante et des objectifs de confort… Faut-il se protéger du vent dominant ? Peut-on en tirer parti ? A t on besoin de gains solaires ? Si oui, comment trouver un juste milieu entre ces derniers et la limitation des risques de surchauffe ? Une construction sur pilotis est-elle nécessaire contre les risques d’inondation ? La réponse à ces questions permettra d’optimiser la forme géométrique du bâtiment, son implantation, la position et le type d’ouvertures ou encore l’aménagement intérieur. L’implantation du bâtiment doit aussi tenir compte de son impact futur sur l’environnement immédiat. L’architecture bioclimatique impose également des bases de conception : Utiliser des matériaux de construction locaux : le coût sera plus faible, la main-d’œuvre plus adaptée tant au niveau de la construction que de l’entretien. Les revêtements de façade influent sur le rayonnement thermique. Faut-il valoriser l’inertie thermique ? Faut-il isoler le bâtiment ? Comment gérer les radiations solaires ? Comment exploiter la ventilation naturelle ? La valorisation de l’énergie solaire et/ou éolienne et/ou biomasse pour la production d’énergie (électrique ou thermique) fait aussi partie du concept de bio climatisme. Elle tire parti de la nature et limite les problèmes d’accès à l’énergie ainsi que l’impact global sur l’environnement. Tous ces principes de conception sont à adapter suivant les contraintes climatiques, socio-économiques et architecturales. Malgré tout, une excellente conception du bâtiment peut devenir dérisoire si l’usage qui en est fait est en contradiction avec la réflexion globale du projet. C’est là que le rôle de l’occupant intervient. Si tout est mis en œuvre pour limiter les risques de surchauffe, l’occupant se doit de limiter la dissipation de chaleur interne. De ce fait, les appareils de cuisson ou autres équipements producteurs de chaleur (compresseur des réfrigérateurs ou d’appareils de climatisation) doivent être impérativement disposés à l’extérieur des zones de vie. Un comportement responsable influera sur le choix de luminaires (influence de l’éclairage naturel, basse consommation si possible) et de tout appareil Exposé sur L’Architecture Bioclimatique Page 5 électrique : une stratégie de développement durable est à adopter à tous les niveaux. Le bon fonctionnement du bâtiment quant à lui nécessite une sensibilisation : utilisation des protections solaires et de la ventilation naturelle si celles-ci ne sont pas automatisées, entretien du bâtiment et des équipements… Deux stratégies sont à adopter suivant les besoins : – La stratégie du chaud consiste à capter l’énergie solaire et la stocker dans la masse pour un déphasage et un écrêtage des pics de température. La redistribution de cette chaleur se fait lorsque les températures extérieures sont plus faibles que les températures intérieures désirées. – La stratégie du froid consiste à se protéger des apports solaires, adopter des solutions passives de refroidissement par humidification ou ventilation naturelle et limiter les charges internes. 4- Méthodologie de projet : Une architecture bioclimatique doit avant tout s'inscrire dans son environnement, et donc s'y adapter. La connaissance de cet environnement est indispensable pour concevoir le projet architectural, elle est en conséquence un préalable indispensable à la conception architecturale : géographie environnante, climat, biodiversité existante, risques naturels, ... Une architecture bioclimatique se fixe par ailleurs des objectifs précis du point de vue du bilan énergétique global sur la durée de vie du projet, mais également sur la pression environnementale qu'il va générer, et sur le confort et la santé des futurs utilisateurs du bâtiment. Exposé sur L’Architecture Bioclimatique Page 6 Intégrer l'ensemble de ces contraintes en préalable à la conception architecturale est indispensable pour réussir un projet bioclimatique, ce qui implique dans un premier temps de se poser les bonnes questions, sur le choix du site en fonction de la densité urbaine, de l'emplacement, des transports, des commerces et services disponibles à proximité. À titre d'exemple, construire bioclimatique en un lieu qui va générer de nombreux déplacements automobiles n'est pas cohérent. Il faut ensuite rédiger un programme architectural clair, fixant les objectifs à atteindre, et s'informer sur les matériaux, les techniques et les savoir-faire disponibles régionalement. C'est seulement après que l'architecte pourra imaginer et mettre en œuvre son Art, conforté par une vision claire du projet qui lui est confié. 5- Insertion dans le territoire : La réussite de cette insertion implique une économie par rapport à l'emprise sur les territoires naturels, soit éviter le "mitage" du territoire. Elle implique également un bon équilibre entre les différents services offerts, qu'il s'agisse de limitation des besoins en transport ou de pertinence économique et sociale de l'implantation, par la mixité des équipements de logement, de travail, d'éducation, d'approvisionnement et de loisir. Cette mixité permet, en densifiant les centres-villes et les agglomérations périurbaines, en se réappropriant les friches, en reconstruisant la ville sur la ville, de réduire les besoins en infrastructures et donc le coût public de la construction. 6- Matériaux et chantier : Les matériaux de la santé et le confort des occupants peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement, la santé humaine et la qualité de vie des individus et des sociétés des nuisances lors de son recyclage final ou de sa mise au rebut en fin de vie du bâtiment. Il est nécessaire de privilégier des matériaux sains, à faible dont la production, la transformation, la mise en œuvre et le recyclage nécessitent un minimum d'énergie. 7- Confort et santé à l’intérieur : Le confort et la santé à uploads/Ingenierie_Lourd/ chap2-l-x27-architecture-bioclimatique-plan-et-le-reste-1.pdf
Documents similaires


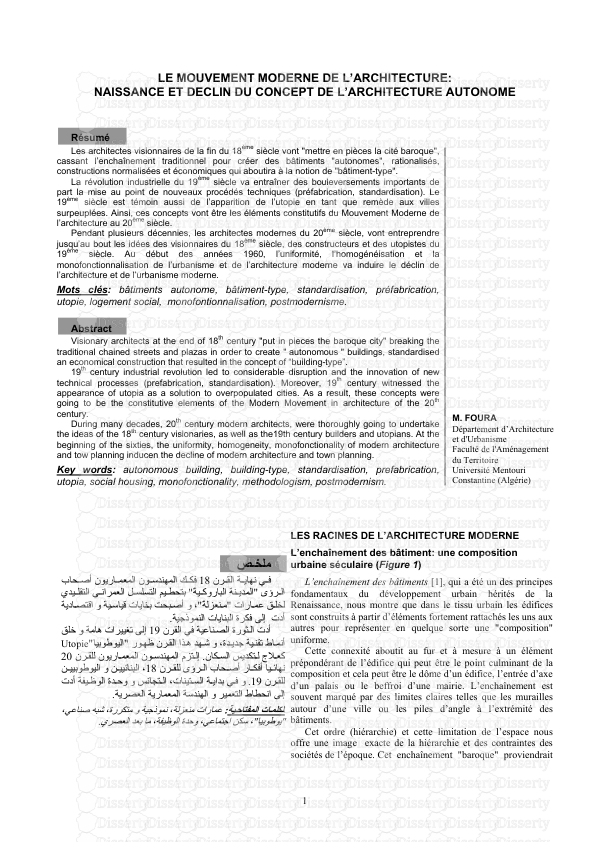







-
78
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 05, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.5195MB


