service d'Études techniques des routes et autoroutes Sétra Instruction techniqu
service d'Études techniques des routes et autoroutes Sétra Instruction technique Surveillance et entretien des ouvrages d'art 2ème partie – Fascicule 4 – Topométrie octobre 2006 page blanche Document édité par le Sétra dans la collection "les outils". Cette collection regroupe les guides, logiciels, supports pédagogiques, catalogues, données documentaires et annuaires. Instruction technique Surveillance et entretien des ouvrages d'art 2ème partie – Fascicule 4 – Topométrie collection les outils 2 Le présent document est l’un des fascicules dont l’ensemble constitue la deuxième partie de l’Instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art du 19 octobre 1979 révisée. La liste de ces fascicules est la suivante : Fasc. 01. Dossiers d’ouvrages Fasc. 02. Généralités sur la surveillance Fasc. 03. Mesures de sécurité - Auscultation - Surveillance renforcée - Haute surveillance Fasc. 04. Surveillance topométrique Fasc. 10. Fondations en site aquatique Fasc. 11. Fondations en site terrestre Fasc. 12. Appuis Fasc. 13. Appareils d’appui Fasc. 20. Zone d’influence - Accès - Abords Fasc. 21. Equipements des ouvrages (protection contre les eaux - revêtements - joints de chaussée et de trottoirs - garde-corps - dispositifs de retenue) Fasc. 30. Ponts et viaducs en maçonnerie Fasc. 31. Ponts en béton non armé et en béton armé Fasc. 32. Ponts en béton précontraint Fasc. 33. Ponts métalliques (acier, fer, fonte) Fasc. 34. Ponts suspendus et ponts à haubans Fasc. 35. Ponts de secours Fasc. 40. Tunnels, tranchées couvertes, galeries de protection Fasc. 50. Buses métalliques Fasc. 51. Ouvrages de soutènement Fasc. 52. Déblais et remblais Fasc. 53. Ouvrages de protection Avertissement 3 L ’élaboration du présent fascicule a été confiée à un groupe de travail placé sous la pré- sidence de M. Claude Bois, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, membre du Collège Génie Civil et ouvrages d’art du CGPC, dans lequel sont représentés : la MISOA, les Directions Départementales de l’Equipement, le réseau technique (CETE, Sétra, LCPC, CETU, DREIF), des maîtres d’ouvrages extérieurs (SNCF, RATP, Concessionnaires d’autoroutes). Le fascicule 04 de l’instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvra- ges d’art «TOPOMETRIE» a été réalisé par le groupe de travail suivant : M. BERNARD Gilbert - DREIF (retraité) M. CHAGNEAU Patrick - LRPC Clermont-Ferrand M. COCHET Dominique - LRPC Strasbourg M. ESBRAT Daniel - LRPC Aix (retraité) M. DELMON Guy - Conseil général de Charente-Maritime (retraité) M. FAUCHOUX Gilbert - LRPC Angers M. GREZES Bernard - CETE du Sud-Ouest (retraité) M. SCHELSTRAETE Daniel IGN Rapporteur : M. DELFOSSE Gérard - maintenant à la DIR Ouest. 4 5 1. Champ d’application 7 2. Généralités 9 2.1. Définitions 9 2.2. Objet des actions topométriques 10 2.3. Les acteurs de la topométrie 10 2.4. Le contexte 11 3. Les différents objectifs de la topométrie 13 3.1. Préambule 13 3.2. Topométrie initiale 13 3.3. Topométrie d’auscultation 14 3.4. Topométrie de surveillance 14 3.5. Optimisation des actions de topométrie 15 4. Champ d’application de la topométrie de surveillance 17 4.1. Critères d’opportunité de recours à la topométrie de surveillance 17 4.2. Vérification de l’opportunité de mettre en place la topométrie de surveillance 18 5. Les paramètres influençant les résultats des mesures topométriques 21 5.1. Le paramètre temps 21 5.2. Les autres paramètres 22 6. L’interprétation des résultats 27 6.1. Intérêt et fiabilité des mesures 27 6.2. Mesures de flèches et de rotations (tabliers) 27 6.3. Mesures de tassement (appuis - remblais) 28 6.4. Mesures de déplacements ou de déformations des appareils d’appui 28 Annexes 29 Annexe 1 Processus de mise en œuvre d’une action de topométrie 30 Annexe 2 Schéma de détermination du type de topométrie 32 Annexe 3 Définitions en topométrie d’ouvrages d’art 34 Annexe 4 Éléments pour la rédaction d’un cahier des charges de topométrie 42 Annexe 5 Méthodes et matériels 51 Annexe 6 Fiches-guide d’implantation des repères et points de mesure en topométrie initiale 85 Sommaire 6 Chapitre 1 Champ d’application L e présent fascicule contient les dispositions applicables à l’ensemble des ouvrages d’art, au sens de la présente instruction. Son champ d’application s’étend à l’utilisation de la topométrie dans l’ensemble des actions de gestion des ouvrages d’art (surveillance, entretien, auscultation, diagnostic). Il ne constitue pas un guide d’entretien, ou une aide à l’établissement de diagnostics liés aux pathologies. Il présente un moyen d’investigation particulier. Il doit permettre au gestionnaire de juger de l’opportunité de recourir à la topométrie. Il a pour objet d’indiquer les conditions d’utilisation de la topométrie, ainsi que quelques- unes de ses possibilités et de ses limites. 7 Chapitre 1 - Champ d’application Chapitre 2 Généralités Les opérations de topométrie, souvent dénommées à tort topographie, constituent histo- riquement et culturellement un acte traditionnel de l’ingénieur gestionnaire d’un patri- moine d’ouvrages d’art. Elles présentent l’avantage de pouvoir être mises en œuvre simplement dans la plupart des cas. Les spécialistes susceptibles de réaliser des mesures ont généralement une for- mation de géomètre, donc au plus proche du terrain. Cependant, cette facilité ne doit pas masquer le fait que les résultats issus de la topomé- trie sont difficilement interprétables sans précaution. En effet, l’expérience montre que les campagnes de topométrie, souvent réalisées systématiquement dès qu’un désordre apparaît, ont rarement pu être entièrement exploitées. Il paraît donc nécessaire de mettre à sa juste place la topométrie dans la panoplie des outils au service des gestionnaires, dans le cadre de la surveillance et des opérations préalables à l’établissement d’un diagnostic. 2.1. Définitions Dans le présent fascicule, la topométrie est définie comme l’ensemble des opérations techniques permettant d’établir un réseau ou un ensemble de réseaux de points de mesure adaptés au fonctionnement attendu d’un ouvrage et des pathologies éventuellement asso- ciées, et : de le compléter si nécessaire ; de quantifier les déplacements des points de ce réseau ou de cet ensemble de réseaux ; d’exprimer les résultats de façon exploitable. Il est le plus souvent nécessaire de repérer l’ouvrage par rapport à un système d’axes orthonormé. En général, en ce qui concerne les ouvrages droits et horizontaux, l’axe Oz est pris suivant la verticale, et dirigé vers le haut, Ox et Oy étant respectivement parallèle et perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’ouvrage. Bien souvent, c’est la mesure suivant une direction qui constitue le paramètre signifi- catif. Il est donc nécessaire d’adapter les mesures topométriques au type de structure à surveiller. L ’annexe 6 constitue un guide qui décrit la position des repères et la distribution spatiale des points de mesure, en matière de topométrie initiale. 9 Chapitre 2 - Généralités 2.2. Objet des actions topométriques Les actions topométriques, sur les ouvrages achevés, ont pour objet la constitution d’un état initial au travers du levé d’un réseau de points de mesure ; le suivi de l’évolution dans le temps des déplacements des points de mesure de ce réseau, éventuellement complété. Cette évolution sera appréciée au travers de tout ou partie : de déplacements des points de mesure attachés à l’ouvrage, par rapport à un réseau de points extérieurs, dans la mesure où celui-ci a pu être établi, et dans la mesure où l’on peut être certain de sa stabilité (cf. annexe 3) ; de déplacements de parties d’ouvrage, les unes par rapport aux autres ; de modifications de la géométrie de ces parties d’ouvrage. En effet, la géométrie et la position des diverses parties d’un ouvrage ne sont pas immua- bles. Elles peuvent évoluer sous l’action de phénomènes : irréversibles tels que : tassements, mouvements de terrain, travaux dans la zone d’in- fluence, déformations différées, pertes de précontrainte, corrosion ... ; réversibles comme ceux liés aux variations de phénomènes naturels cycliques : tem- pérature, niveau de nappe, marnage ... Dans le cas où ces phénomènes ont été pris en compte lors de la conception et sous réserve qu’ils se produisent conformément aux prévisions, la structure est normalement conçue pour en supporter les conséquences sans dommage. Dans le cas contraire ou lorsque le fonctionnement de la structure n’est pas celui prévu, ces phénomènes peuvent être à l’origine de mouvements et déformations, mais aussi d’efforts et sollicitations parasites susceptibles d’engendrer des désordres. Enfin, la géométrie est susceptible d’être affectée à chaque fois que l’on modifie le com- portement de l’ouvrage, suite à des travaux. La topométrie est un des moyens qui permettent de quantifier ces déplacements ou déformations : soit pour confirmer le bon fonctionnement de la structure ; soit pour contribuer à l’établissement du diagnostic. 2.3. Les acteurs de la topométrie 2.3.1. Le service constructeur Il a en charge l’établissement de la topométrie initiale en associant le futur gestion- naire. Cette topométrie fait partie de l’État de Référence, au même titre que l’Inspection Détaillée Initiale (I.D.I.) - cf. fascicules 01 & 02 de la deuxième partie de la présente instruction. 10 Fascicule 4 - Instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art 2.3.2. Le gestionnaire Le gestionnaire d’un patrimoine d’ouvrages d’art juge de l’opportunité de recourir aux actions uploads/Ingenierie_Lourd/ dt4144.pdf
Documents similaires






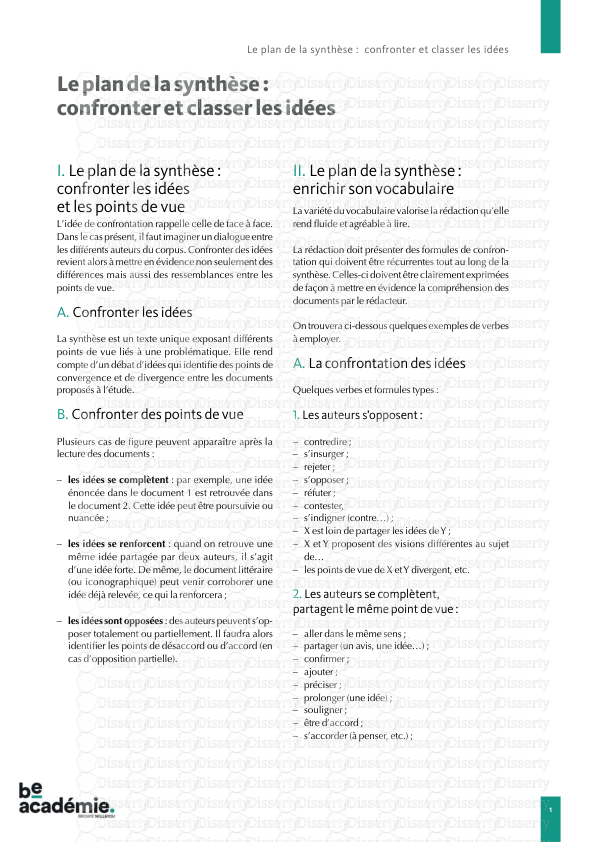



-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 16, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.8352MB


