Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 3 180 − 1 Emboutissage des tôles Importance des modes de déformation par Alain COL Ingénieur-conseil, Consultac, expert en mise en forme des tôles minces Ancien responsable mise en forme à Sollac ’emboutissage des tôles est une opération qui permet d’obtenir des pièces de formes complexes non développables, contrairement aux opérations plus simples que sont le pliage, le roulage ou le profilage à froid. Ce procédé, d’utilisa- tion très générale, permet de fabriquer les pièces de carrosserie automobile, des appareils électroménagers ou des ustensiles de cuisine, des emballages métal- liques, des pièces mécaniques... Outre la forme de l’outil, qui dépend de la complexité de la pièce à obtenir, de nombreux paramètres conditionnent la réussite de l’opération : ceux liés au 1. Différents modes de déformation..................................................... M 3 180 - 2 1.1 Examen d’une pièce .................................................................................. — 2 1.2 Exemples industriels ................................................................................. — 3 1.3 Marquage des réseaux.............................................................................. — 4 1.4 Mesure des déformations......................................................................... — 5 2. Courbes limite de formage.................................................................. — 6 2.1 Représentation des déformations............................................................ — 6 2.2 Détermination des courbes limite de formage ....................................... — 8 2.2.1 Moyens de déformation.................................................................. — 8 2.2.2 Méthodes de détermination de la striction.................................... — 9 2.3 Paramètres influents ................................................................................. — 10 2.3.1 Épaisseur du métal .......................................................................... — 10 2.3.2 Moyens de déformation.................................................................. — 11 2.3.3 Influence de la grille utilisée ........................................................... — 11 2.3.4 Méthodes d’estimation de l’apparition de la striction.................. — 11 2.3.5 Influence des trajectoires de déformation..................................... — 11 2.4 Prédiction des courbes limite de formage............................................... — 11 2.5 Utilisation industrielle des CLF................................................................. — 12 2.5.1 Utilisations les plus courantes........................................................ — 12 2.5.2 Quelques pièges à éviter................................................................. — 13 3. Caractérisation de la formabilité des tôles .................................... — 13 3.1 Essais simulatifs ........................................................................................ — 13 3.2 Latitude de réglage de la force de serre-flan........................................... — 14 3.3 Essai de traction conventionnel ............................................................... — 15 3.3.1 Domaine élastique........................................................................... — 16 3.3.2 Limite d’élasticité............................................................................. — 16 3.3.3 Consolidation ................................................................................... — 16 3.3.4 Striction ............................................................................................ — 16 3.3.5 Allongement à rupture .................................................................... — 17 3.4 Essai de traction rationnel ........................................................................ — 17 3.4.1 Lois constitutives ............................................................................. — 18 3.4.2 Coefficients d’anisotropie ............................................................... — 19 3.5 Influence du mode de déformation sur les contraintes ......................... — 19 3.5.1 Cas de la limite d’élasticité.............................................................. — 19 3.5.2 Comportement dans le domaine plastique ................................... — 20 Pour en savoir plus......................................................................................... Doc. M 3 182 L EMBOUTISSAGE DES TÔLES ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. M 3 180 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques process d’une part, tels que réglages de la presse, vitesse d’emboutissage, lubrification, et ceux liés aux qualités de la tôle elle-même et à sa capacité de for- mage, encore appelée formabilité, qui fait l’objet de cet article. La mesure des caractéristiques mécaniques des tôles ainsi que l’interprétation de leur relation avec l’aptitude au formage ont fait de grands progrès. Il en est de même pour la compréhension de l’opération d’emboutissage, entre autre par le biais de la simu- lation numérique qui permet maintenant de visualiser virtuellement le compor- tement du métal dans l’outil. Les systèmes de mesure de déformation sont également un outil qui permet des analyses quasi quantitatives sur pièces réelles. Néanmoins, la conception des outils et l’emboutissage restent encore partiel- lement un art basé sur l’expérience. On peut cependant prédire que, d’ici cinq à dix ans environ, les méthodes de conception et de fabrication automatique des outils auront pris le pas sur celles actuellement pratiquées. Ce qui suit est surtout axé sur le matériau. Nous essayerons de montrer quelles sont les caractéristiques des tôles métalliques qui sont influentes vis-à-vis de la mise en forme, en particulier en relation avec les modes locaux de déformation qui jouent ici un grand rôle. Ce texte traite essentiellement des tôles minces, c’est-à-dire, dans la pratique, les tôles d’épaisseur comprise entre 0,2 et 3 ou 4 mm. Pour le formage des tôles épaisses, on se reportera à l’article « Formage des tôles fortes ». Les matériaux considérés sont essentiellement l’acier et les alliages d’alumi- nium. Il sera fait quelques allusions aux alliages cuivreux, dont l’emploi tend à décroître pour des questions de prix. Les « tôles sandwich », les « flans soudés » sont des matériaux relativement nouveaux qui nécessiteraient un article à eux seuls. Ils ne sont donc pas considérés. L ’étude complète du sujet comprend les articles : — M 3 180 - Emboutissage des tôles. Importance des modes de déformation (le présent article) ; — M 3 181 - Emboutissage des tôles. Aspect mécanique ; — Doc. M 3 182 - Emboutissage des tôles. 1. Différents modes de déformation Les métaux en feuille sont très sensibles au mode de déforma- tion qu’on leur applique. Pour un matériau donné, les efforts nécessaires ainsi que les capacités de déformation peuvent différer profondément d’un mode à l’autre et c’est la raison pour laquelle nous allons aborder l’étude de la formabilité des tôles par la défi- nition de ces différents modes, en utilisant la terminologie conventionnellement utilisée en emboutissage. 1.1 Examen d’une pièce La figure 1 présente une pièce simple, un carter de chaîne de distribution, qui va nous servir à identifier les principaux modes de déformation. On part d’un élément de tôle prédécoupé à la forme voulue, qui prend alors le nom de flan (en tiretés sur la figure 1). L ’outil, schématisé en coupe sur la figure 2, comporte une matrice, ayant sensiblement la forme extérieure de la pièce et un poinçon qui oblige la tôle à pénétrer dans la matrice ; on dit que la tôle est ava- lée dans la matrice. Avant l’emboutissage, le flan est pincé sur ses bords contre la matrice par une pièce annulaire appelée serre-flan qui, d’une part s’oppose à la formation de plis, d’autre part freine et régularise l’entraînement de la tôle à l’intérieur de l’outil. Sur la figure 1, l’extrémité de la pièce repérée R résulte de l’avalement du métal à travers une partie semi-circulaire de la matrice : ses éléments convergent vers le centre. La comparaison de la bordure initiale du flan, en tiretés, et de celle de la pièce emboutie montre que la tôle a subi une compression circonféren- tielle ; le segment R1 s’est raccourci pour donner le segment R2. La déformation dans la collerette est dite en rétreint pur. Assem- blés, trois secteurs du genre de R donneraient un godet cylin- drique. Figure 1 – Carter de chaîne E2 TP TP1 TP2 R R1 R2 E E1 _____________________________________________________________________________________________________________ EMBOUTISSAGE DES TÔLES Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 3 180 − 3 Le côté repéré TP a subi un mode de déformation appelé trac- tion plane ou encore traction large. Sous l’effet des efforts résis- tants dus à la pression du serre-flan et aux efforts de pliage et dépliage sur le rayon de matrice rm (ces notions seront précisées dans l’article [M 3 181]) se produit un allongement dans la direc- tion verticale. Le bord de la matrice étant rectiligne, le métal ne subit pas l’effet de « convergence » ou rétreint déjà vu à propos de la zone R. Il n’y a donc pas de modification de la largeur de ce sec- teur droit et c’est pourquoi un segment tel que TP1 vient en TP2 sans que sa longueur ne change. La partie supérieure du « dôme », marquée E, a été poussée par le poinçon, surtout vers la fin de l’emboutissage (1), alors que le métal du flan était retenu de toutes parts ; la surface du dôme a donc augmenté au détriment de son épaisseur (conservation du volume). Le cercle E1 tracé sur le flan est devenu le cercle E2 plus grand. Le dôme est une zone dite en expansion. Nota (1) : dans la réalité, l’emboutissage commencerait par le dôme. Mais l’outil, nette- ment plus compliqué, ne se prêterait pas bien à une description introductive. Nous venons d’examiner les trois principaux modes de déforma- tion existant en emboutissage. Avant d’en aborder l’étude d’une façon plus détaillée, nous allons montrer que ces modes se retrouvent sur tous les types de pièces embouties. 1.2 Exemples industriels Il n’existe pas de pièces embouties sur lesquelles un mode stric- tement unique soit présent. I L ’embouti dit en « oméga » de la figure 3 est souvent cité comme l’archétype de la traction plane. Le métal est retenu latéralement par la pression de serre-flan et les efforts nécessités par son passage sur le rayon de matrice. Les bords de celle-ci étant parfaitement rectilignes, la déformation majeure est effectivement de type traction plane, dirigée perpendi- culairement au grand axe. Néanmoins, les rives A et B de la pièce sont libres. Elles sont donc partiellement en traction uniaxiale, ce qui entraîne parfois un léger rétrécissement sur le nez de poinçon (non visible sur uploads/Ingenierie_Lourd/ emboutissage-des-toles-importance-des-modes-de-deformation.pdf
Documents similaires
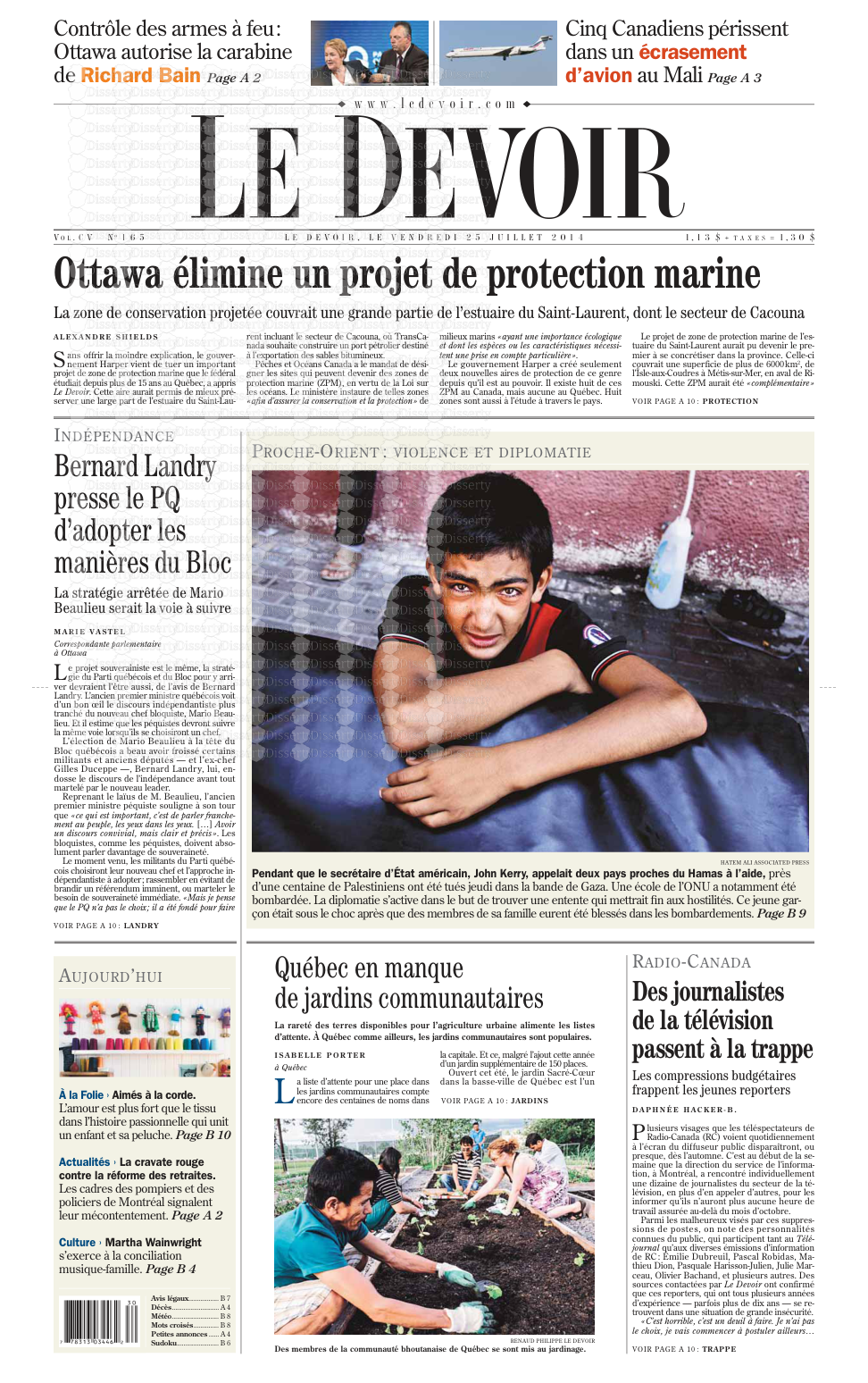









-
25
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 03, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0119MB


