DESSIN INDUSTRIEL Les conventions du dessin industriel : lire les plans du Bouv
DESSIN INDUSTRIEL Les conventions du dessin industriel : lire les plans du Bouvet Le dessin industriel répond à des règles, à des conventions strictes. Mais au Bouvet, il nous arrive parfois de les transgresser, ou plus exactement de les adapter pour plus de commodités et de compréhension ! La lecture des plans que nous publions peut représenter une barrière parfois diffi cile à franchir. Mais Le Bouvet se veut ouvert à tous aussi notre volonté est d’abattre cette barrière, sans pour autant ennuyer les plus chevronnés. Voici donc l’essentiel des règles du dessin, que certains ont peut-être oubliées, avec des commentaires qui vous aideront à mieux comprendre les plans tels que nous les publions dans votre Bouvet. LE CROQUIS Le plus souvent réalisé à main levée, le croquis est une sorte d’esquisse simplifi ée à laquelle on apporte les cotes (mesures) d’encombrement des éléments importants de notre objet. LE SCHÉMA Le schéma est un dessin plus ou moins poussé, mais simplifi é et symbolique, qui met en évidence la relation entre différents organes d’un ensemble. Il est très utilisé en mécanique. L ’ÉPURE C’est un dessin abouti, tracé à l’aide d’instruments, le plus souvent aux dimensions réelles de l’objet à reproduire (dans ce cas on dit qu’il est à l’échelle 1). L’épure peut aussi être un simple tracé géométrique qui nous permet la recherche des pièces en vraie grandeur (Fig. 2). Les différentes formes de tracés Dessins, esquisses, croquis, schémas, épures… Tous ces ter- mes ont une signifi cation différente parfois très proche et parfois diffi cile à distinguer. Nous allons vous donner notre approche de ceux que nous utilisons le plus souvent. LE DESSIN C’est un terme générique qui nous permet de désigner toutes formes de représentations graphiques. L ’ESQUISSE Dans notre domaine, lorsque l’on crée un meuble ou un objet, notre première démarche consiste à dessiner au crayon, parfois à main levée (sans appareils de traçage) une vue d’ensemble de notre projet. Ce dessin préliminaire auquel on apporte l’essentiel des détails s’appelle l’esquisse : elle est la base de notre future réalisation (Fig. 1). HS Le Bouvet 1 Fig. 1 Esquisses d’un projet de meuble et d’objet utilitaire X X' A C B D a' b1 c1 d1 1' 2' 4' 3' 1 2 4 3 O Y Y' g' h' e' f' E F 1 3 et 2 4 Exemple : épure d'un arêtier Fig. 2 même si parfois elles peuvent paraître un peu complexes. Les projets de normes sont étudiés dans des bureaux de normalisation, puis soumis pour validation à l’association française de normali- sation (AFNOR). Sans entrer dans les détails, sachez qu’en dessin industriel nous utilisons une norme internationale ISO (sigle an- glais qui signifi e organisation internationale de normalisation). La représentation des plans LE FORMAT Les dessins, ou si vous préférez les plans, sont tradi- tionnellement faits sur une feuille dont les dimensions cor- respondent à un format bien établi. Le format original part d’une feuille de 1 m2 de dimen- sions égales à 841 x 1 189 mm : c’est le format A0. Il est surtout utilisé dans le bâtiment. Viennent en- suite les subdivi- sions de ce format, plié en deux dans le sens de sa lon- gueur. On obtient le format A1 (594 x 841 mm). Celui-ci plié à nouveau en deux dans le sens de sa longueur donne le format A2 (420 x 594 mm) et ainsi de suite jusqu’au format A4 (210 x 297 mm) qui correspond à celui des pages du Bouvet (Fig. 4). LES ÉCHELLES Dessiner sur une feuille les plans d’un objet plus ou moins gros nécessite d’abord de choisir le format le mieux approprié. Ensuite, il convient de pouvoir représenter lisiblement cet objet en entier LE PLAN Le plan est un dessin très poussé qui répond à des normes. C’est l’aboutissement de l’esquisse et du croquis selon différentes vues : de face, de dessus, de gauche, de l’arrière… Le plan peut aussi comporter des coupes, des sections, des vues partielles… En principe, il est coté (on y voit les mesures de largeur, longueur, hauteur…). Son but est de permettre de reproduire exactement l’objet représenté. LE PLAN SUR RÈGLE Terminons ce petit tour d’horizon par le fameux plan sur règle sur lequel bon nombre de non-initiés se posent des questions ! Nous y faisons souvent référence dans Le Bouvet, il a d’ailleurs déjà été décrypté dans les numéros 18 et 110. Le plan sur règle est un dessin en grandeur réelle qui se trace sur un élément ri- gide : en général, on emploie une « règle » ayant une face propre et dégauchie (planchette de bois massif, médium, mélaminé…). Cette règle de 15 à 20 cm de large a au moins un des ses chants dressé (dégauchi et raboté) et possède une longueur suffi sante pour contenir la plus grande dimension de la pièce à reproduire. Cette dernière est alors dessinée sur la face propre et dégauchie de la règle, simplement en section verticale et en section horizontale. L’objet est dessiné en grandeur réelle (échelle 1/1), la cotation est donc inutile. De plus, les sections font apparaître les assemblages en traits continus. Le chant dressé de la règle est le chant de réfé- rence : tout se trace à partir de lui. Il est orienté vers l’opérateur tout comme les parements de la pièce à dessiner (faces visibles au fi nal). Dans cette situation, le haut de l’objet est considéré à gauche de l’opérateur (Fig. 3). Cela peut sembler compliqué, mais retenez surtout le côté prati- que du plan sur règle qui, une fois tracé, permet de reporter les traits des usinages (rainures, tenons, mortaises…) en posant les pièces rabotées sur la règle. Ainsi à chaque instant, il est facile de contrô- ler le bon déroulement des opérations. C’est une solution simple et pratique, très prisée par les professionnels (en milieu artisanal). La normalisation Que ce soit l’industrie du bois, l’industrie mécanique, électri- que… Tout est régi par des normes ! Elles ne sont pas là pour nous embêter, bien au contraire, c’est une sorte de code qui nous permet de communiquer, de nous comprendre et de nous simplifi er la vie, HS Le Bouvet 2 Section verticale Section horizontale sur soubassement Section horizontale sur partie vitrée Règle Chant de référence Exemple d’un plan sur règle : une porte vitrée Opérateur Plan sur règle classique auquel ont été ajoutés les assemblages en arêtes cachées. Il s'agit donc d'une section « améliorée ». Le plan se dessine en vraie grandeur. Note : les assemblages sont tracés selon les normes « Ébénisterie ». Haut Bas Tenon vu en bout, ne pas confondre avec la représentation d'un tasseau vu en bout Mortaise vue en bout Fig. 3 594 x 841 A1 A0 841 x 1189 A2 420 x 594 297 x 420 A3 A4 210 x 297 210 x 297 A4 Les formats normalisés Fig. 4 de bien visualiser les détails d’un plan ! Nous nous efforçons de toujours faire au mieux. Nos plans sont pratiquement toujours co- tés et si vous souhaitez par exemple reproduire par photocopie un motif de sculpture à l’échelle 1, il vous suffi t de relever la dimen- sion réelle du dessin et d’établir le rapport avec la cote indiquée. LES VUES La représentation d’un objet par un dessin fait appel à des vues, normalisées elles aussi. ■ LA VUE EN PERSPECTIVE C’est une vue très appréciée car, au premier coup d’œil, elle permet de visualiser un objet, d’imaginer son aspect général. L’ar- tisan a souvent recours à cette méthode pour présenter à ses clients les meubles qui leur sont destinés. Mais elle n’est pas suffi sante pour reproduire l’objet à l’identique, c’est plus une sorte de pho- tographie. Il existe différents types de vues en perspective : citons les perspectives cavalière, isométrique, dimétrique ou trimétrique (Fig. 6a). Dans notre domaine, la perspective cavalière est la plus aborda- ble, même si le rendu ne contente pas entièrement l’œil. En voici la défi nition telle qu’elle est enseignée en dessin industriel : « la pers- pective cavalière est une projection oblique, parallèlement à une direction donnée, sur un plan de projection parallèle à l’une des faces du cube de projection ». Cela peut sembler un peu complexe aussi rien ne vaut un bon croquis explicatif (Fig. 6b) ! Dans Le Bouvet, nous représentons parfois les objets simples ou complexes en vues en perspective cavalière. Le dessin (infor- matique) en trois dimensions (3D) nous offre également la pos- sibilité de représenter une forme de perspective. Mais à présent, grâce à la technologie numérique et à la qualité du papier, nous avons plus fréquemment recours à la photographie numérique ce qui, reconnaissons-le, est beaucoup plus rapide. ■ LES VUES PROJETÉES Nous venons de voir que la perspective était idéale pour vi- sualiser un objet, mais pas suffi sante pour le reproduire. Pour cela, nous utilisons le système de projection normalisé des vues, ce que l’on appelle les vues projetées. La fameuse « vue de face » uploads/Ingenierie_Lourd/ fiche-ledessinindustriel.pdf
Documents similaires
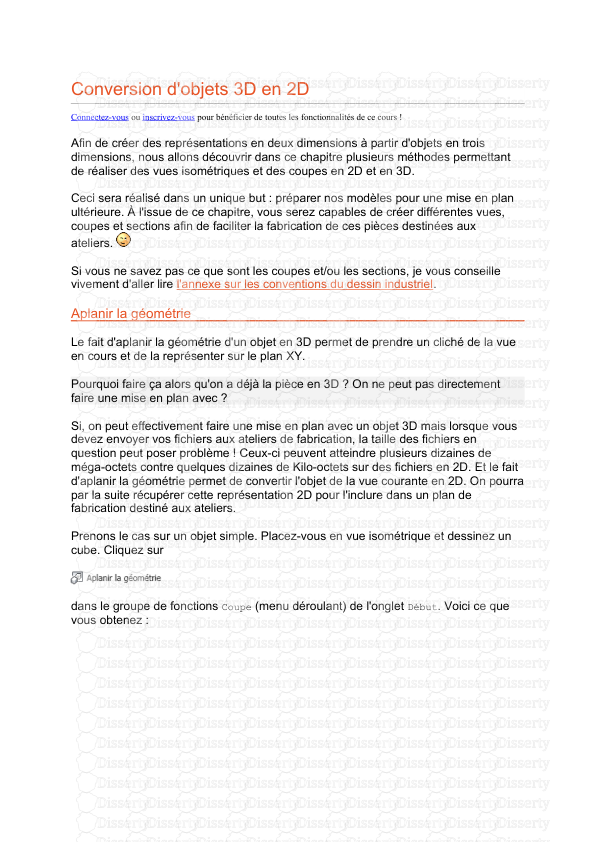









-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 1.5922MB


