1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RU
1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction de l’Espace Rural et de la Forêt DOCUMENT TECHNIQUE FNDAE N°4 E EL LA AB BO OR RA AT TI IO ON N D DE ES S D DI IS SP PO OS SI IT TI IO ON NS S L LO OC CA AL LE ES S D DE E S SE EC CO OU UR RS S P PO OU UR R L LA A D DI IS ST TR RI IB BU UT TI IO ON N D D’ ’E EA AU U P PO OT TA AB BL LE E FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D’EAU Office International de l’Eau SNIDE Nouvelle version rédigée par Jean-Marc BERLAND Décembre 2002 Méthodologie pour l’étude et la préparation des mesures à prendre en local en cas de pollution accidentelle d’un réseau de distribution d’eau potable. 2 PLAN Pourquoi ce guide ?_________________________________________________________ 5 Partie I : Guide méthodologique_______________________________________________ 6 1 OBJECTIFS ___________________________________________________________ 7 2 A quelle instance confier l’établissement de dispositions locales de secours articulées avec le PSS-Eau Potable ?___________________________________________________ 11 3 Elaboration des dispositions locales de secours pour la distribution d’eau potable __ 12 3.1 Evaluation des risques _________________________________________________ 12 3.1.1 Identification des causes de pollution ____________________________________________ 12 3.1.1.1 Origine des pollutions accidentelles _________________________________________ 12 3.1.1.1.1 Pollutions de la ressource._______________________________________________ 13 3.1.1.1.2 Pollution sur le réseau__________________________________________________ 13 3.1.1.2 Les attentats ___________________________________________________________ 14 3.1.2 Evaluation des conséquences d’une pollution : les usages particuliers de l’eau de distribution publique ________________________________________________________________________ 15 3.1.2.1 Les abonnés prioritaires __________________________________________________ 15 3.1.2.2 La desserte incendie _____________________________________________________ 15 3.1.3 Prévention des pollutions accidentelles ___________________________________________ 16 3.2 Réalisation d’un document de planification des secours en local__________________ 17 3.2.1 Utilité du document de planification _____________________________________________ 17 3.2.2 Présentation et contenu du document de planification des secours : ______________________ 18 3.2.3 Fiches du document local de planification des secours________________________________ 19 3.2.3.1 Fiches constituant le document local de planification des secours.___________________ 19 3.2.3.2 Fiches de données générales traitant de problèmes annexes et complétant le dispositif. ___ 22 3.2.4 Elaboration d’une Alimentation en Eau de Secours __________________________________ 23 3.2.4.1 Catalogue des solutions de s ecours préconisées par la circulaire du 27 Septembre 1988___ 23 3.2.4.1.1 Mesures internes à l’unité de distribution ___________________________________ 24 3.2.4.1.2 Utilisation de ressources prévues en secours _________________________________ 24 3.2.4.1.3 Utilisation d’interconnexions ____________________________________________ 25 3.2.4.1.4 Augmentation de la quantité d’eau fournie par des ressources non contaminées. ______ 27 3.2.4.1.5 Distribution d’eau extérieure au réseau _____________________________________ 28 3.2.4.1.6 Traitement de l’eau par des unités de traitement temporaires _____________________ 28 3.2.4.1.7 Gestion de la pénurie __________________________________________________ 29 3.2.4.2 L’évacuation de la population______________________________________________ 30 4 Mise à jour des documents relatifs au secours en cas de perturbations importantes au niveau du réseau d’eau potable. ______________________________________________ 31 Partie II : Fiches « méthode »________________________________________________ 32 AVANT-PROPOS___________________________________________________________ 33 SOMMAIRE DES FICHES ___________________________________________________ 34 LE CONTENU DU PLAN DE SECOURS QUE CHAQUE ACTEUR LOCAL DOIT POUVOIR TROUVER EN PREFECTURE.________________________________________________ 35 PRESENTATION DE LA CELLULE D’EVALUATION QUE LE PREFET DOIT METTRE EN PLACE EN CAS DE CRISE. __________________________________________________ 37 PRESENTATION DE LA DISTRIBUTION D’EAU ________________________________ 40 CAS DE POLLUTION RETENUS ______________________________________________ 41 3 POLLUTION OU MENACE DE POLLUTION DES EAUX INTERIEURES – ARBRE DES DECISIONS POSSIBLES ____________________________________________________ 43 POLLUTION LOCALISEE SUR UNE PARTIE DU RESEAU – ARBRE DES DECISIONS POSSIBLES_______________________________________________________________ 44 CONSTATER______________________________________________________________ 45 ALERTER ________________________________________________________________ 48 COMMENTAIRES SUR LA FICHE « ALERTER » _________________________________ 50 ANALYSER _______________________________________________________________ 52 RECHERCHER L’ORIGINE D’UNE POLLUTION_________________________________ 54 Commentaires sur la rubrique « Sources potentielles de pollution » ______________________ 55 FICHE D’ENQUETE « TYPE »________________________________________________ 57 AUPRES DE POLLUEURS POTENTIELS_______________________________________ 57 DECIDER ________________________________________________________________ 60 MESURES EXCEPTIONNELLES______________________________________________ 64 POLLUTION CHIMIQUE ____________________________________________________ 64 MESURES EXCEPTIONNELLES POLLUTION MICROBIENNE _____________________ 65 ALIMENTATION EN EAU DE SECOURS _______________________________________ 66 AVERTISSEMENT DE LA POPULATION _______________________________________ 69 ABONNES PRIORITAIRES __________________________________________________ 72 EAU EMBOUTEILLEE______________________________________________________ 73 ADRESSES ET N° DE TELEPHONE UTILES ____________________________________ 74 LIMITER L’ETENDUE, ENLEVER ____________________________________________ 75 ET TRAITER UN DEVERSEMENT ACCIDENTEL ________________________________ 75 SURVEILLANCE DE L’EAU__________________________________________________ 77 JUSTIFICATION DES CHOIX ________________________________________________ 78 ANALYSES _______________________________________________________________ 82 DESINFECTION___________________________________________________________ 86 REMISE EN SERVICE DES OUVRAGES _______________________________________ 86 PRELEVEMENT D’URGENCE________________________________________________ 90 UTILISATION DE PUITS PRIVES POUR L’ALIMENTATION - DESINFECTION ________ 91 MAINTENANCE EN VUE DU RECOURS A UNE ALIMENTATION EN EAU DE SECOURS 92 IDENTIFICATION DE PRODUITS TRANSPORTES PAR VOIE ROUTIERE ____________ 93 FINANCEMENT ___________________________________________________________ 94 Partie III : Etudes de cas____________________________________________________ 99 Bibliographie ____________________________________________________________ 106 4 P Po ou ur rq qu uo oi i c ce e g gu ui id de e ? ? Les services déconcentrés de l’Etat ont pour mission de mettre en place, sous l'autorité du préfet, des plans de secours spécialisés ayant pour objet la lutte contre des perturbations importantes sur un réseau de distribution d’eau potable. Néanmoins, c’est le maire qui assumera dans un premier temps la responsabilité de ces interventions. Il ne sera relayé par le préfet qu’après le déclenchement du plan de secours spécialisé. Par ailleurs, plusieurs cas de crise dans différents contextes ont mis en évidence une très grande exigence de la part des administrés envers le maire. Celui-ci peut se trouver dans une position très délicate en cas de perception par la population d’un défaut dans l’organisation des secours. L’exemple récent des inondations dans le Sud–Est de la France est assez significatif. Certains maires, fortement critiqués, se sont d’ailleurs retournés contre l’Etat. L’objectif de ce nouveau guide est d’être un document de travail pour chaque intervenant concerné par les situations de crise relatives aux réseaux d’eau potable. Il doit leur permettre : ð de prendre conscience de l’importance de leur place dans la chaîne des secours au niveau départemental ; ð de formuler des propositions pour l’amélioration de la préparation des secours en local en ayant à l’esprit l’ensemble des enjeux relatifs à la sécurité des populations en cas de pollution accidentelle des eaux ; ð d’œuvrer à l’élaboration du plan de secours spécialisé si celui-ci n’existe pas encore au niveau préfectoral ; ð de mettre en place, au niveau du territoire pour lequel ils ont compétence, les moyens pour que le plan de secours préfectoral soit bien relayé : • information, • affectation de missions claires à différents agents, • sensibilisation du personnel concerné au plan de secours préfectoral, • rédaction d’un document, articulé avec le plan préfectoral, planifiant en local les secours… Il est donc essentiel de réfléchir en local aux crises possibles « à froid » afin de limiter autant que faire se peut les dysfonctionnements et retards qui ne manquent pas de se produire lorsque l’on n’est pas préparé à une situation d’urgence. 5 P Pa ar rt ti ie e I I : : G Gu ui id de e m mé ét th ho od do ol lo og gi iq qu ue e 6 1 OBJECTIFS Au 1er janvier 1995, 98,5 % de la population rurale française était desservie par un réseau public d'eau potable, au travers de 15.000 collectivités distributrices (370.000 habitants permanents restaient à alimenter). La ressource en eau est assurée par plus de 30.000 points d'eau, dont la grande majorité est constituée de prises d'eau souterraines (plus de 31.000) (source : site Internet du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales – 2002 : http://www.agriculture.gouv.fr/) Au niveau des collectivités urbaines, on peut considérer que la quasi-totalité des logements est connectée au réseau d’eau potable bien que l’on ne dispose pas d’enquêtes récentes concernant ce taux de desserte en milieu urbain. La longueur des réseaux ainsi que les volumes distribués sont considérables. L’enquête IFEN menée auprès de 5 000 communes en 1998 nous fournit les éléments suivants. Tableau 1. Longueur du réseau d’eau potable (valeurs brutes) communes classées selon la population (nombre d’habitants) longueur du réseau (km) nombre d'habitants nombre de communes volume facturé (*1000m3) < 400 150 800 3 494 856 18 005 269 352 400 à 999 170 281 5 433 262 8 556 346 868 1000 à 1999 123 845 5 376 884 3 835 319 832 2000 à 3499 92 584 4 515 288 1 732 304 438 3500 à 9999 102 627 9 132 222 1 536 595 415 10000 à 19999 40 086 5 687 799 406 379 394 20000 à 49999 34 554 8 287 494 270 557 230 50000 et + 36 876 12 486 773 98 997 790 ensemble 751 656 54 414 578 34 438 3 770 322 Source : IFEN, Scees, Agences de l’Eau - 1998 Ces valeurs brutes sont à prendre avec précaution car elles concernent une extrapolation France entière de l’enquête menée auprès de 5 000 communes et ne prennent pas en compte les non-réponses. La longueur totale du réseau corrigée serait de l’ordre de 792 000 km. Une exploitation des données brutes permet d’obtenir une répartition par taille des communes (Berland JM, Juery C – 2002) La population est donc dépendante et ce de manière exclusive des réseaux publics pour : ð l’alimentation en eau proprement dite des individus ; ð l’assurance d’un bon niveau de confort domestique et d’hygiène ; ð abreuver le uploads/Ingenierie_Lourd/ fndae-04-bis.pdf
Documents similaires


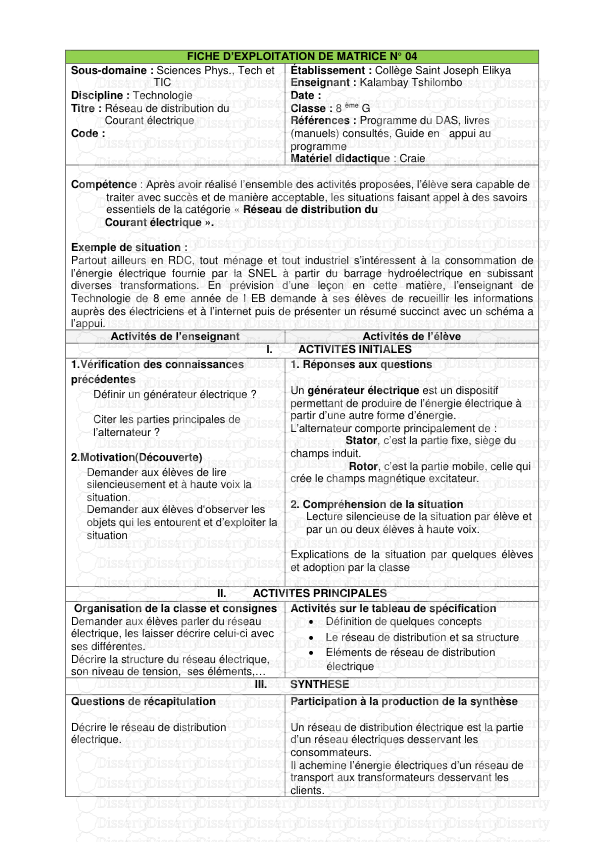







-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 12, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2788MB


