Le paysage ethnobotanique en France Les folkloristes, le peuple et la nature Av
Le paysage ethnobotanique en France Les folkloristes, le peuple et la nature Avant d’envisager les contours de l’ethnobotanique française d’aujourd’hui, nous proposons un détour par le passé afin de connaître les idées et les personnes à l’origine de la discipline : nous ouvrons une page d’histoire consacrée aux folkloristes du XIXe siècle et aux chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle qui ont marqué la matière du sceau universitaire. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la démarche des folkloristes précède et amorce les premiers pas des études ethnographiques des sociétés européennes. Du point de vue de la thématique ethnobotanique et selon des critères strictement méthodologiques, leurs apports peuvent être considérés comme mineurs. Malgré cela, leurs ouvrages abondent en annotations, descriptions des pratiques et informations sur les sociétés que l’on ne doit pas négliger. A titre d’exemple, l’Académie Celtique* s’intéresse aux usages des végétaux et les insère dans ses questionnaires (1807) : il y figure des questions sur les usages ayant trait au calendrier (plantation des jeunes arbres au début du mois de mai ; cueillette des herbes la veille de la Saint Jean…). Le culte des arbres est mentionné au titre des «Croyances et superstitions». Deux auteurs intéressent aujourd’hui les travaux ethnobotaniques. Les études menées par E. Rolland offrent une œuvre monumentale, Flore populaire (11 tomes)4, Faune populaire (13 tomes). Les plantes sont répertoriées d’après leurs noms dans les diverses cultures européennes et leurs multiples usages symboliques, médicinaux… P. Sébillot, fondateur de la Société des traditions populaires en 1886, est notamment reconnu pour son travail sur le folklore breton - en Haute-Bretagne essentiellement. Les volumes sur les plantes et les arbres, issus de sa référence principale Le folklore de France, ont été réédités en 1985 sous le titre La Flore5. Il y livre des interrogations d’un grand intérêt sur le symbolisme et l’imaginaire. La démarche des folkloristes, pour être comprise, doit être replacée dans son contexte. La majorité d’entre eux procède à des inventaires et des collectages les plus larges possibles des usages d’un monde rural dont on augure déjà la disparition à cette époque. Leur idéalisation des sociétés rurales, voilée de nostalgie, d’un monde paysan dépositaire de traditions immémoriales, doit nous mettre en garde face à l’exploitation de ces données, marquées par une méthodologie parfois peu rigoureuse. Les sources ne sont pas toujours égales, issues de témoignages indirects, obtenues par des intermédiaires, des érudits locaux (notables, instituteurs etc.). Leur approche n’est donc pas à proprement parler scientifique. En France, le folklore n’a jamais été reconnu par le milieu universitaire. Deux visions du monde s’affrontent alors sur un arrière-plan idéologique : les folkloristes empruntent les voies de la tradition conservatrice, chrétienne et contre-révolutionnaire du second Empire et se situent en réaction à la politique républicaine, jacobine, d’inspiration évolutionniste, défendue par le milieu universitaire et l’école française de sociologie. La démarche scientifique et sociologique s’affirme par son « opposition idéologique basée sur le rejet du rôle attribué à la tradition et du folklore tels que l’incarnaient en particulier un P. Saintyves et un P. Sébillot »6, en raison de leur rejet de « l’unification républicaine, leur catholicisme militant et le rôle excessif accordé à l’esthétique et à l’emblématique. ». Du bord universitaire, le parti pris jacobin dont le corollaire est d’ignorer les particularismes locaux, à une époque où les intérêts colonialistes et républicains sont tournés vers les tropiques, éloignera durablement la recherche ethnologique des diversités culturelles de l’Hexagone. Les précurseurs de la discipline En réalité, pour découvrir l’origine d’une approche des sociétés humaines au travers des plantes, selon un cadre méthodologique et scientifique en France, il faut se tourner vers le Muséum national d’Histoire naturelle, à la fin du XIXe siècle. Institution fondamentale en matière de recherche dans le domaine des sciences naturelles et des sciences humaines, il constitue le creuset de la discipline ethnobotanique. En 1879, l’archéologue et botaniste Alphonse Trémeau de Rochebrune, préparateur d’anthropologie au Muséum, étudie les restes végétaux qui entourent des momies péruviennes. Il qualifie alors son travail d’ethnographie botanique. En parallèle, en 1883, le botaniste suisse Alphonse de Candolle publie un important ouvrage de synthèse L ’Origine des plantes cultivées, qui combine une approche botanique, archéologique et philologique*. L ’ethnobotanique au Muséum national d’Histoire naturelle se structure surtout sous l’impulsion d’Auguste Chevalier (1873-1956), héritier de la tradition ancienne des naturalistes voyageurs du Muséum de l’époque coloniale. Spécialisé dans le champ de l’agronomie tropicale et des plantes utiles, il manifeste un grand intérêt pour l’action de l’homme sur 4 Rolland, E., 1896 - 1914. Flore populaire ou histoire naturelle des plantes dans leur rapport à la linguistique et le folklore. 11 t. en 6 vol., rééd. 1967, Paris, Maisonneuve et Larose. 5 Sébillot, P., 1985. Le folklore de France, 1906, Vol. 6, La Flore, réédit. Paris Imago. 6 I. Chiva, 1987. « Entre livre et musée. Emergence d’une ethnologie de la France », in Ethnologies en miroir, Paris. Guide ethnobonatiste - 5 la nature. Son œuvre a contribué à dégager la notion fondamentale de domestication des plantes. La thématique de l’ethnobotanique française va progressivement prendre corps au Muséum tout au long du XXe siècle, sous l’influence des chercheurs qui se succèdent à la tête des programmes de recherche sur les questions de la relation homme-nature. L’ethnobotanique au Muséum national d’Histoire naturelle depuis les années 19507 Roland Portères (1906-1974) dans les années 1950 et 1960 prend ses distances avec la recherche appliquée au développement agricole et donne ses lettres de noblesse à l’ethnobotanique en déclarant qu’elle appartient aux sciences humaines bien plus qu’à la biologie végétale. Il définit le «taux d’ethnobotanicité» d’une société par le nombre de plantes perçues (qu’elles soient nommées et/ou utilisées) rapporté au nombre de plantes recensées d’un territoire donné. Ce taux constitue un témoin efficace d’évaluation du rapport société-milieu. R. Portères a accordé une large place à la linguistique au sein de ces travaux, témoignant ainsi de son intérêt pour le lien entre les sociétés et leurs milieux. Fasciné par les rapports non matériels des relations homme-végétal, R. Portères en donne une illustration dans «Le caractère magique originel des haies vives»8. Il y développe l’idée que «la réalité magique» des plantes choisies pour constituer ces haies prime sur les qualités physico-chimiques car la haie est à la fois un obstacle mécanique et un obstacle magique : «elle possède une puissance magique de protection et se trouve être un compagnon apaisant avec lequel ont conversé des générations d’hommes». André-Georges Haudricourt (1911-1996), à l’image de C. Lévi-Strauss, défend une ethnologie française soucieuse de mettre en résonance savoirs, savoir-faire et représentations symboliques. Dès 1943, son ouvrage intitulé L ’Homme et les plantes cultivées donne forme à la démarche ethnobotanique par l’étude de la domestication des plantes, en abordant les plantes cultivées d’un triple point de vue : botanique, linguistique et ethnologique9. Dans une publication scientifique considérée comme fondamentale, “ Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui ”, il propose une typologie des mentalités occidentales et orientales en relation avec les attitudes respectives envers les animaux et les plantes. D’une manière globale, A.-G. Haudricourt défend la thèse que ce sont les modalités techniques de socialisation de la nature qui influencent les rapports sociaux. En Asie et en Mélanésie, pour les cultures du riz irriguées et de l’igname, chaque plant bénéficie d’une action individuelle, sans contrôle direct sur les végétaux mais en aménageant au mieux l’environnement (butte pour les ignames, systèmes d’irrigation...). En Europe, la culture des céréales requiert une série d’opérations collectives et directes sur les plantes (herser, semer, favoriser le tallage en passant un rouleau, désherber...). De même, dans l’aire méditerranéenne, l’élevage de moutons, exige un contact permanent avec le berger qui dirige son troupeau (conduite avec sa houlette et son chien, défense contre les prédateurs...). Selon A.-G. Haudricourt, l’opposition entre l’action indirecte asiatique et l’action directe occidentale est également perceptive dans les comportements à l’égard des humains. En Occident, le chef, le roi ou Dieu appréhendent leurs sujets comme un corps collectif, ils les guident et interviennent directement dans leur destinée. En Océanie et en Extrême-Orient, le chef serait moins autoritaire et davantage dans le respect de la volonté générale de la communauté. Le traitement des humains y est davantage non-interventionniste. Jacques Barrau (1925-1997) considère la plante comme un outil d’insertion humaine au sein des écosystèmes. Il prône une étude globale des systèmes «naturels», homme compris. Il faut prendre en compte l’action des hommes dans la nature dont ils font partie, une nature marquée par un processus d’interaction et de transformation permanentes. Claudine Friedberg a suivi une démarche de terrain en Indonésie (Timor) où elle a développé une analyse approfondie du rapport à la flore de l’ethnie Bunaq et mis en évidence son système de classification botanique10. Elle a essentiellement consacré ses recherches à l’étude des systèmes botaniques indigènes, à travers les modes de perception, de dénomination, d’usages et les « croyances » ayant trait au monde végétal. A la lumière de ses observations, elle estime que les classifications populaires sont construites par la complémentarité de trois opérations : l’identification des plantes et des animaux (par uploads/Ingenierie_Lourd/ les-precurseurs-de-l-x27-ethnobotanique-flora.pdf
Documents similaires






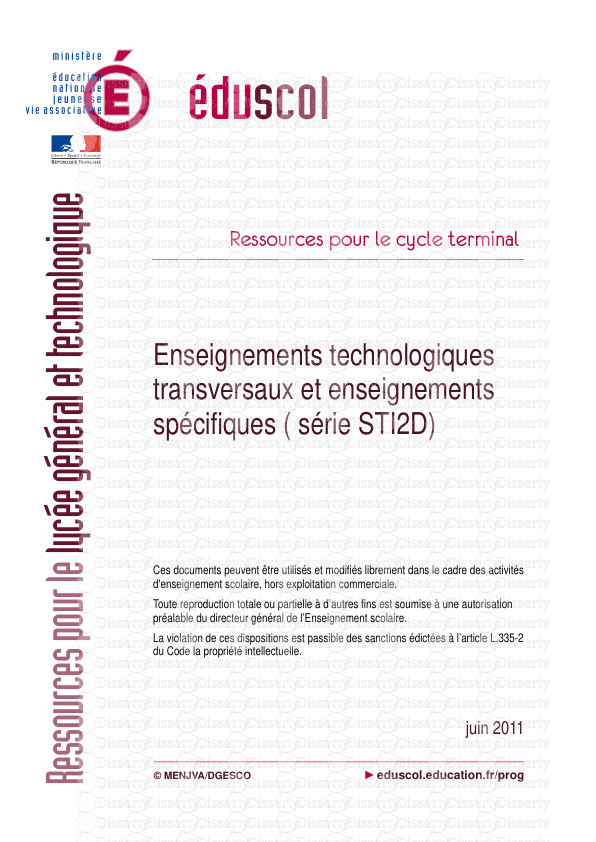



-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1845MB


