SNCF Direction de Lyon DTER Rhône-Alpes 10 cours de Verdun 69286 Lyon CEDEX02 U
SNCF Direction de Lyon DTER Rhône-Alpes 10 cours de Verdun 69286 Lyon CEDEX02 Université Lyon 2 Faculté de Sciences Economiques 16 quai Claude Bernard 69002 Lyon Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat 3 rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin DEFINITION D’UN PLAN DE TRANSPORT ADAPTE POUR LE SILLON ALPIN SUD Rapport principal Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes Pierre BERTHELIN Maître de stage : Thierry HERDA Mémoire soutenu le 13 septembre 2006 2 T TA AB BL LE E D DE ES S M MA AT TI IE ER RE ES S Remerciements_____________________________________________________ 4 Introduction________________________________________________________ 5 1. Le Sillon Alpin Sud, troisième axe régional ________________________ 5 2. Un projet d’ampleur, à court et long termes _______________________ 7 3. Définition et enjeux d’un plan de transport adapté __________________ 7 4. Pourquoi refondre un plan de transport ? _________________________ 9 I. Méthodologie de travail ________________________________________ 10 A. Les contours de la mission ___________________________________ 10 1. Travailler sur le « plan de transport adapté » _____________________ 10 2. Bornes géographiques et temporelles___________________________ 12 a. Le Sillon Alpin Sud________________________________________ 12 b. L’été 2007 ______________________________________________ 12 3. Les rendus________________________________________________ 13 B. Cartographies de travail _____________________________________ 14 1. Les acteurs du « produit-train »________________________________ 14 a. Le matériel ______________________________________________ 15 b. Les agents de conduite (ADC)_______________________________ 15 c. Les agents du service commercial du train (ASCT)_______________ 16 d. L’horairiste EF ___________________________________________ 17 e. Le pôle routier ___________________________________________ 17 2. Calendrier de préparation du plan de transport ferroviaire ___________ 18 C. Les différentes phases ______________________________________ 21 1. Connaissance de l’axe ______________________________________ 23 2. Les travaux et leurs impacts __________________________________ 24 3. Définition d’une grille d’evaluation______________________________ 25 4. Conception et evaluation des scénarii___________________________ 26 5. Finalisation du plan de transport selectionne _____________________ 27 II. Enjeux et conraintes d’un axe en travaux _______________________ 28 A. Le marché des déplacements _________________________________ 28 1. Contexte socio-économique __________________________________ 28 2. L’offre actuelle _____________________________________________ 29 3. Structure de la clientèle et des déplacements_____________________ 33 a. Généralités______________________________________________ 33 b. La période de plein été ____________________________________ 37 B. La production de l’offre ______________________________________ 39 1. caracteristiques techniques de l’infrastructure ____________________ 39 a. Grenoble – Moirans _______________________________________ 39 b. Moirans – St Marcellin _____________________________________ 40 c. St Marcellin – Romans - Bourg de Péage ______________________ 40 d. Romans - Bourg de Péage – Valence _________________________ 41 2. Les acteurs de la production de l’offre___________________________ 41 C. Une opération d’envergure ___________________________________ 43 1. Genèse du projet___________________________________________ 43 2. La consistance des travaux___________________________________ 45 a. La phase 1A_____________________________________________ 45 b. Les phases suivantes _____________________________________ 46 3. Les contraintes liées aux travaux ______________________________ 47 a. Les contraintes de desserte_________________________________ 47 3 b. Les contraintes techniques _________________________________ 48 III. Les differents scenarii : conception et evaluation_________________ 50 A. Quelle grille d’évaluation ? ___________________________________ 50 1. Quelle situation de référence ? ________________________________ 50 a. Le « fil de l’eau » _________________________________________ 50 b. Une situation de référence pour quelles mesures ? ______________ 51 2. Quel périmètre d’évaluation ? _________________________________ 52 a. La période ______________________________________________ 52 b. Les variables ____________________________________________ 53 c. Le portefeuille de dessertes pris en compte : les réponses à deux problèmes 55 3. Quels indicateurs pour l’offre ferroviaire ?________________________ 57 a. Les indicateurs financiers___________________________________ 57 b. Les indicateurs de performance______________________________ 57 B. L’élaboration des scénarii ____________________________________ 60 1. Les grands axes directeurs ___________________________________ 60 a. Un problème méthodologique majeur : le manque de données « plein été » 60 b. Les scénarii envisagés et leur faisabilité _______________________ 61 2. Les scénarii proposés _______________________________________ 63 a. Quelle vocation ? _________________________________________ 63 b. Le scénario de base : Desserte ferroviaire maximale St Marcellin – Valence (DFS Max) ________________________________________________ 64 c. Les deux autres propositions ________________________________ 64 3. Optimiser la production ferroviaire______________________________ 65 a. La base : les roulements du matériels roulant ___________________ 65 b. Les roulements des « roulants » _____________________________ 68 4. La desserte routière de substitution ____________________________ 72 a. Les projets de référence ___________________________________ 72 b. Les nouvelles propositions__________________________________ 73 C. Evaluation des scénarii ______________________________________ 78 1. Comparaison économique____________________________________ 78 a. Scénario de référence vs scénarii alternatifs ____________________ 79 b. Comparaison des trois scénarii entre eux ______________________ 79 2. Les indicateurs de performance _______________________________ 80 a. Le matériel roulant ________________________________________ 80 b. Les agents ______________________________________________ 81 Conclusion _______________________________________________________ 84 Sources __________________________________________________________ 86 Lexique des abréviations Hors codes gares ____________________________ 89 Lexique des codes des noms de gares ________________________________ 91 Table des illustrations ______________________________________________ 92 Table des annexes _________________________________________________ 93 4 R RE EM ME ER RC CI IE EM ME EN NT TS S Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un stage effectué à la Direction du TER à Lyon, du 18 avril au 29 septembre 2006, sous la responsabilité de Thierry Herda, responsable du programme de production dans le cadre de la négociation de la convention Région Rhône-Alpes / SNCF. Je tiens avant tout à remercier celui-ci pour le suivi permanent qu’il a assuré pendant mon stage, nos fréquents points d’étape et sa disponibilité constante, qui m’ont permis de surmonter les difficultés que j’ai pu rencontrer. Ses remarques et conseils m’ont « aiguillé » tout au long de mon travail afin que ma mission apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. Parallèlement à cet encadrement, Thierry Herda m’a laissé une grande autonomie dans la conduite de mon travail, me permettant de prendre de réelles responsabilités, ce qui n’a fait que valoriser les nombreux acquis de mon stage. Le sujet de mon stage, que je remercie Thierry Herda de m’avoir confié est particulièrement intéressant par sa complexité. En effet, il a nécessité un travail multidisciplinaire, qui m’a permis d’approfondir ma connaissance d’une entreprise aux métiers tellement variés que le risque existe de n’en avoir qu’une vision partielle. Ce travail m’a par ailleurs amené à rencontrer de nombreux cheminots, qui m’ont tous beaucoup apporté, à la fois en termes de savoir et de savoir-faire, mais également sur le plan humain. Tous m’ont considéré comme un collègue de travail à part entière, me permettant ainsi de conduire ma mission de la meilleure manière possible. Parmi ces partenaires de travail, je souhaiterais particulièrement remercier ceux qui, du fait de la proximité de leur mission avec la mienne, m’ont accordé beaucoup de leur temps, notamment : Corinne Santrand, Philippe Andagnotto, Jaques Martin, Jacques Desprez et l’ensemble des concepteurs du PPOM, Philippe Prive, Michel Daumard, Patrick Cuizinaud et l’ensemble des concepteurs du BRC, Anne-Cécile Barraud et l’ensemble du Pôle Gestion de la DTER, Bernard Lozet, Claude Montané, Michel Bastidon, mais également Daniel Cazals, Tiziana Vinci, Alain Doillon, Thierry Guibard, Sylvie Boutier, Sophie Marchal, Alain Divoux, Serge Delenne, Dominique David et les agents-circulation de la gare de St Marcellin, et, pour leur soutien indispensable, Jacques Weill, François Pedron et Pascal Gentil. Je souhaiterais également souligner ma reconnaissance toute particulière envers mes collègues de bureau : Catherine Bouchet, pour son « sans fautes » à mes questions constantes et son soutien lors du pointage des roulements, Elisabeth Dubos pour ses cours sur la maintenance et le renouvellement des infrastructures ferroviaires et Jonathan Bourcet pour sa passion communicative pour le matériel. Enfin, je tiens à remercier les responsables du Master TURP, Bruno Faivre d’Arcier et Patrick Bonnel, pour la qualité du programme du diplôme, notamment la méthode et les connaissances pratiques que j’ai pu acquérir durant celui-ci, et qui m’ont permis d’être opérationnel rapidement pour mon stage. Pierre BERTHELIN Août 2006 5 I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N Avec une augmentation de la fréquentation de la clientèle de près de 9% entre mars 2005 et mars 20061, le réseau TER rhône-alpin donne la preuve de son succès, et de la pertinence du mode ferroviaire comme moyen de transport, que ce soit régional ou périurbain. En effet, cette augmentation se vérifie non seulement sur des lignes irriguant les zones périurbaines des principales agglomérations de la Région, mais également sur des liaisons de moyennes et longues distances. Ainsi, dans un contexte d’augmentation des distances domicile travail, le trafic sur des lignes que l’on pourrait associer à un réseau d’agglomération explose, tel que sur l’axe Lyon – St Etienne, second de la région, qui a vu sa fréquentation annuelle augmenter de 11% entre 2004 et 2005, si bien que l’on peut aujourd’hui quasiment associer cette ligne cadencée au quart d’heure en heure de pointe à une ligne de banlieue. L’axe longue distances Lyon – Vallées de Savoie (Annecy, Modane et Bourg St Maurice), si différent soit-il par sa vocation, présente également d’excellents résultats, soit +8% de trafic en 2005 par rapport à 2004. En outre, ces résultats probants récompensent les efforts conjoints du Conseil Régional et de la SNCF, pour développer et améliorer le TER, et incitent à leur poursuite. Ceux-ci portent non seulement sur les aspects quantitatifs de l’offre, dont la prochaine étape marquante sera le cadencement du réseau au service unique de 2008, mais également sur la qualité de la prestation offerte au client, par exemple sur le confort, via la modernisation massive du parc de matériel roulant ou grâce à la certification de certains axes. A l’heure uploads/Ingenierie_Lourd/ memoire-berthelin-pierre.pdf
Documents similaires






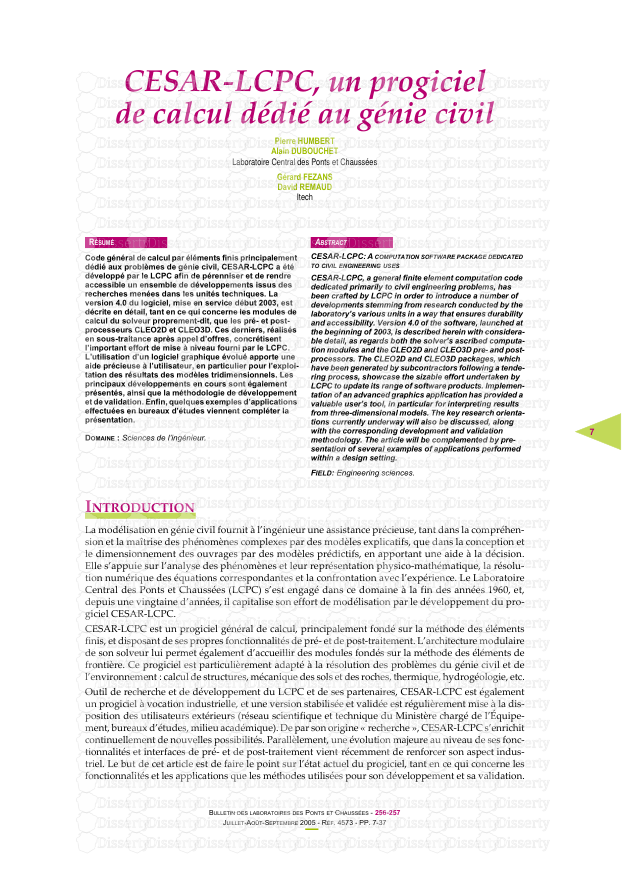



-
93
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 23, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5605MB


