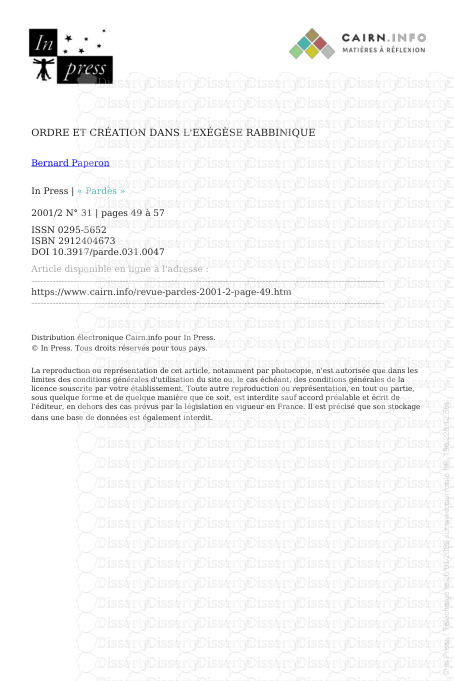ORDRE ET CRÉATION DANS L'EXÉGÈSE RABBINIQUE Bernard Paperon In Press | « Pardès
ORDRE ET CRÉATION DANS L'EXÉGÈSE RABBINIQUE Bernard Paperon In Press | « Pardès » 2001/2 N° 31 | pages 49 à 57 ISSN 0295-5652 ISBN 2912404673 DOI 10.3917/parde.031.0047 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-pardes-2001-2-page-49.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour In Press. © In Press. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) Ordre et création dans l’exégèse rabbinique BERNARD PAPERON Nous essaierons ici de suivre un certain tracé des concepts d’ordre, de structure – et de création, pris dans leur relation réciproque. Notre champ de recherche, comme le titre l’annonce, sera l’exégèse rabbi- nique : nous aurons ainsi l’occasion de suivre le développement et les rebondissements d’une pensée, dans des textes d’époques différentes, et parfois même éloignées – mais reliés par le fil d’une tradition. Tradition dans laquelle les auteurs de ces textes se reconnaissent, et qui explique que par-delà les différences d’époque ces commentaires évoluent en soli- darité les uns avec les autres, tel commentaire citant tel autre, ou renvoyant à tel autre – même si cela ne supprime pas bien sûr les particularités spécifiques de tel ou tel courant d’exégèse. Un Midrach ancien donne le ton à l’intérieur de ce thème. On y retrouve, avant la lettre, le fameux argument de l’horloger avancé par Voltaire, en apparence du moins : Un mécréant vint trouver Rabbi Aqiba et lui demanda : Ce monde, qui l’a créé? Il lui répondit : le Saint, béni soit-Il. −Démontre-le-moi de manière évidente. −Reviens me voir demain. Le lendemain [cet homme] revint, [Rabbi Aqiba] lui demanda : De quoi es- tu vêtu? Il lui répondit : D’un vêtement. −Qui l’a fait? −Le tisserand. −Je ne te crois pas, démontre-le-moi de manière évidente. −Que vais-je te démontrer? Ignores-tu donc que c’est le tisserand qui l’a fait! −Ignores-tu donc que le Saint, béni soit-Il a créé son monde! PARDÈS N° 31/2001 © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) Ce mécréant décéda, et les élèves [de Rabbi Aqiba] lui demandèrent : où est l’évidence? Il leur répondit : Tout comme la maison révèle l’existence du maçon, le vêtement l’existence du tisserand, et la porte celle du menui- sier, de même le monde révèle l’existence du Saint, béni soit-Il, Qui l’a créé, que Son Nom soit loué et exalté à jamais et pour l’éternité1… Quand on analyse les trois exemples donnés par le Maître : maison, vêtement, porte, nous avons chaque fois une structure formée d’éléments plus simples, et assemblés selon une conception préétablie; cette struc- ture exerce une fonction bien définie. Cette conception et la réalisation de la structure sont le fait d’un expert (maçon, tisserand, menuisier). Nous avons là l’idée, posée comme une évidence (davar barour), de l’impossibilité d’une structure complexe autogénérée. Cette idée qui traverse, nous le verrons, l’exégèse rabbinique se retrouve dans le droit talmudique, appliquée cette fois à des enjeux pure- ment juridiques. Ainsi ce droit fait une obligation de restituer à son propriétaire un objet que celui-ci aurait égaré : quiconque trouve l’objet égaré doit s’ef- forcer de retrouver à qui ce dernier appartient. Néanmoins ce devoir-là est à nuancer selon les circonstances. La notion de propriété (Ba‘alout) semble être sous-entendue par un lien presque affectif à l’objet. Un exemple : quiconque perd un objet, et «désespère» (Yéouch) de le retrouver rompt en quelque sorte son lien à cet objet, et c’est comme s’il abandonnait sa propriété. Ainsi l’individu qui trouverait cet objet n’aurait plus d’obligation de le restituer. Mais comment cet individu peut-il savoir si son propriétaire d’ori- gine «désespère» ou non de retrouver l’objet? Si l’objet est marqué d’un «signe distinctif» (siman), on doit supposer que le propriétaire escompte le retrouver, car ce signe permet justement de rechercher et d’identifier le propriétaire 2. À ce propos le Talmud distingue deux cas : celui d’objets visible- ment «tombés» et celui d’objets «posés»; ces derniers se reconnais- sent entre autres par la structure selon laquelle ils sont déposés et agen- cés. Un exemple : des pièces de monnaie posées sur le sol en forme de pyramide ne sont pas perdues ou abandonnées, une main les a forcé- ment déposées là, ce qui montre une intention de les reprendre (même si entre-temps on peut supposer que ces objets ont été oubliés); l’ordre, la structure excluent l’idée d’une chute d’objet non orchestrée, et pure- ment «fortuite». 50 BERNARD PAPERON © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) En fait cette idée d’un ordre excluant la possibilité d’une organisa- tion spontanée n’est pas aussi simple que les textes cités semblent le dire – en tout cas dans la manière dont les commentaires postérieurs ont fait écho à ce thème de l’ordre renvoyant au Créateur. Le Zohar 3 met en relation deux versets bibliques évoquant l’idée de création. Citons-les : Levez vos yeux vers les hauteurs et voyez : qui a créé ceux-là? Qui fait défi- ler les légions [d’étoiles], en bon ordre? Toutes, Il les appelle par leur nom (Isaïe, 40,26). Au commencement de la création par Dieu des cieux et de la terre, la terre était informe et vide, et le souffle divin planait sur la surface des eaux (Gen 1,1-2). Nous avons traduit selon Rachi 4 qui voit dans l’expression « au commencement» (Be-réchit) un «état construit», une expression forcé- ment liée à la suite : au commencement de… Le Zohar fait remarquer que les mots de la question du prophète Isaïe : Qui a créé ceux-là (Mi bara élé) comportent les mêmes lettres que les mots du premier verset de la Genèse : Dieu a créé (Bara Elohim). Le même verbe au passé «a créé» (bara) se retrouve ici et là, et l’as- sociation des mots «qui» (mi) et «ceux-ci» (élé) forme le nom de Dieu (Elohim). Essayons de comprendre cela. La question du prophète semble n’être qu’une pure interrogation : elle constate l’ordre qui structure les constellations, mais ne nomme pas Dieu derrière ce phénomène. Elle demande simplement « qui ? », en excluant par là l’idée d’une auto-création, ou même d’un auto-agence- ment du «ceux-là» – le pluralisme et la diversité infinie du phénomène- phaïnoumaï : apparaître. Or le Zohar fait remarquer que la constatation de ce phénomène (élé : ceux-là) renvoyant à l’énigme d’une organisation pensée (mi : qui? et non «quoi» 5) amène au nom de Dieu : Elohim. Essayons de l’analyser plus en détails. La constatation d’une structure complexe ne semble pas forcer, dans un premier temps à nommer Dieu : elle pose simplement un «qui» en forme d’interrogation, qui élimine à sa façon, l’hypothèse «hasard» celle d’une auto-création de la structure. «Cela n’a pu se faire tout seul», d’où le «qui?», pure interrogation qui cependant implique déjà l’absence d’auto-création. ORDRE ET CRÉATION 51 © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) © In Press | Téléchargé le 26/01/2022 sur www.cairn.info (IP: 196.228.12.56) A partir de là il semble que le concept de Dieu Créateur vienne dans un deuxième temps : si «ceux-là» renvoie forcément au «qui», ce ne peut être qu’un Être parfait, sans doute à l’image de la complexité infi- nie de la structure contemplée (le ceux-là). Dès lors que le «ceux-là» par sa complexité structurée, renvoie forcé- ment à un «qui», qui donc peut être ce qui, si ce n’est en quelque sorte, un «qui» à la hauteur des exigences de «ceux-là»? D’où le fait que le nom divin (Elohim), dans ses lettres mêmes, est la rencontre d’un phénomène (ceux-là – élé) avec l’évidence d’une orga- nisation extérieure au phénomène (qui = mi). On peut le dire autrement : les lettres mêmes qui écrivent la question du prophète (qui a créé ceux-là : mi bara élé) composent aussi la réponse claire trouvée en Genèse (Dieu a créé : Elohim bara) comme pour dire : poser la question c’est déjà avoir la réponse, accepter de demander «qui a créé», c’est être déjà en possession de la réponse («Dieu a créé»), le pas décisif étant d’accepter l’impossibilité d’une autostructuration de la structure. Ainsi se retrouverait, dans cette réflexion sur le créé, la démarche que Pascal situe sur un plan ontologique : à l’homme perplexe qui se ques- tionne à propos de l’existence de Dieu, Dieu Lui-même répond uploads/Ingenierie_Lourd/ parde-031-0047.pdf
Documents similaires










-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 04, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3574MB