Review Reviewed Work(s): Molière by Roger Duchêne Review by: C. E. J. Caldicott
Review Reviewed Work(s): Molière by Roger Duchêne Review by: C. E. J. Caldicott Source: Revue d'Histoire littéraire de la France, 99e Année, No. 5 (Sep. - Oct., 1999), pp. 1099-1103 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40533915 Accessed: 19-05-2022 14:59 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue d'Histoire littéraire de la France This content downloaded from 161.116.100.31 on Thu, 19 May 2022 14:59:47 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms COMPTES RENDUS 1099 tation aux vœux de cette clientèle, dans une alter de servilité. Sur ce plan, les arguments de Caldico bilité avec certaines grandes idées de la critique m Le critique a même le courage de mettre en que des modèles d'interprétation qui voient derrière Γ jet avorté de réforme de la société ou un program d'un programme à réaliser, clairement défini par est une forme d'idéalisme académique, incompat de l'innovation théâtrale qui est si évident chez tances dans lesquelles il travaillait » (p. 24). Beaucoup de thèses émises dans l'ouvrage vont sion ; certaines, du reste, sont trop brièvement ar audace ou pourront être formulées avec plus de cl pas moins que La Carrière de Molière entre prot de nouvelles directions de recherches, devrait f resque. On se prend dès lors à regretter que C. E. qu'un modèle d'explication de l'œuvre délibérém rement ?) à pousser jusqu'à ses ultimes prolongem devenir le pendant de l'étude de Raymond Picard Claude Bourqui. Roger Duchêne, Molière. Paris, Fayard, 1998. Un vol. de 789 p. Somme imposante de nos connaissances actuelles sur Molière, présentée en quatre-vingt-quinze chapitres, copieusement illustrée (quarante-neuf illustrations, avec neuf tables analytiques, trois tableaux généalogiques, et un index), à un prix relativement modique, cette dernière biographie à sortir de la plume de Roger Duchêne fut manifestement conçue par la maison d'édition comme une locomo- tive de grande diffusion. Heureux pays que la France où le « blockbuster », ou pour mieux dire le bestseller, s'inspire de la vie d'un grand auteur : si la littérature est la religion nationale, la vie du grand auteur devient à son tour un bréviaire auquel tout citoyen a droit d'accès. Après ses biographies de Mme de Sévigné (1982), Ninon de l'Enclos (1984), Mme de Lafayette (1988), La Fontaine (1990), et Marcel Proust (1994), l'éminent spécialiste de la correspondance de Mme de Sévigné (son édition de ses lettres parut dans la collection de la Pléiade en trois volumes de 1972 à 1978) se sent toujours assez d'attaque pour écrire la vie de l'auteur le plus populaire du xvne siècle. Immense, majestueux dans son universa- lité, le simple titre Molière annonce une finalité canonique, mais devant l'absence des documents ayant trait à sa vie privée et la variété éblouissante de son œuvre, comment peut-on tout dire sur Molière ? Cela n'empêche pas d'essayer, et là aussi les parallèles avec la vie de Shakespeare sont frappants. Si le grand public réclame la vie du grand auteur, que cherchent les spécia- listes ? Y a-t-il une thèse à promouvoir ou a discréditer, un canon à respecter, ou des faits nouveaux à déceler ? Et comment satisfaire les exigences des deux publics ? Quelles sont les difficultés telles qu'elles sont définies par Roger Duchêne, et quelles sont ses nouvelles découvertes ? Son livre est avant tout un récit de la vie de Molière, raconté à travers les seules traces écrites/imprimées que nous ayons de lui, c'est-à-dire les nombreux baux et actes de baptême qu'il signa, et son œuvre théâtrale. Les problèmes de conception sont évidents : Paul Mesnard (1812-1890?) les avait bien définis dans sa propre vie de Molière, toujours la This content downloaded from 161.116.100.31 on Thu, 19 May 2022 14:59:47 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms 1 100 REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE meilleure qui existe sous son titre si modeste, Notice biographique sur Molière (1889), dans le tome X de la magistrale, irremplaçable édition des Œuvres de Molière (dans la collection « Les grands Écrivains de la France ») qu'il procura avec Eugène Despois (1818-1876): «C'est plaisir de chercher l'histoire de Molière dans celle de ses ouvrages ; car elle y est avant tout, et s'y offre à nous aussi claire que glorieuse ; mais à l'époque où nous voici parvenu, il faut, non sans regret, nous détourner de la brillante route de son génie vers sa vie privée, qui n'est pas éclairée d'une manière aussi évidente, aussi pure non plus » (p. 249). R. Duchêne connaît bien l'œuvre de Mesnard, on en trouve des échos tout au long de son nouveau récit, et comme son prédécesseur il compare et soupèse les divers témoignages de l'époque, mais l'absence de documents intimes l'oblige finalement à se replier sur l'œuvre littéraire pour reconstituer la vie de l'homme : et la vie de l'homme, les ressorts de sa créativité, restent si inaccessibles qu'il est difficile de formuler une thèse cohérente et comprehensive là-dessus. Celle de R. Duchêne surgit à partir du chapitre intitulé « La première "idole" moderne » (p. 551). La thèse la plus courante d'aujourd'hui, celle d'un Molière avant - et après - Tartuffe, zélé réformateur avant et simple amuseur après, est évoquée rapidement dans les notes bibliographiques regroupées à la fin du livre (« nous partageons le point de vue de Gérard Defaux dans Molière ou les métamorphoses du comique 1980 », p. 718), mais elle n'est pas examinée dans le texte. Suivant l'ordre qui est imposé par la chronologie des rôles, des baptêmes et déménagements de Molière, les quatre-vingt-quinze chapitres sont relativement brefs ; ils ne sont pas numérotés mais portent chacun un titre évocateur (« Faire alliance avec le Marais ? », ou « Deux fours et un triomphe ») qui cherche à insuf- fler le suspense, le sens du drame, ou même de l'actualité. Avançant par tranches chronologiques, écrits dans un style clair, alerte, et libre du jargon universitaire, les chapitres brassent l'analyse littéraire, la documentation immobilière et les commérages de l'époque ; très souvent l'analyse comprend un résumé d'intrigue ou un commentaire du genre « Rotrou, l'un des meilleurs auteurs de théâtre de l'époque » (p. 54), indiquant ainsi la nature du public ciblé. Pas un seul nom de critique ou d'historien contemporain n'est cité dans le texte : à la place des notes au bas de la page qui permettraient d'identifier les nombreuses sources qu'il exploite, l'auteur renvoie ses lecteurs à des commentaires bibliographiques regroupés à la fin du livre. Pour le grand public ainsi visé, la priorité serait donc une synthèse bien documentée plutôt que les thèses nouvelles ou les origines de nos connaissances actuelles, et le Molière de Roger Duchêne est avant tout un admirable travail de synthèse. En tant que synthèse son livre dépend des recherches déjà faites, déjà publiées dans les études antérieures. De tous les biographes, historiens ou archivistes qui se sont penchés sur la vie de Molière proprement dite, à distinguer des grands spécialistes littéraires de son œuvre tels que Aimé-Martin (1786-1847), qui découvrit un exemplaire de l'édi- tion non cartonnée de 1682, P. Dandrey, G. Forestier, J. Grimm, M. Gutwirth, Hall, G. Howarth, Moore, et j'en passe, ceux et celles qui ont contribué le plus à nos connaissances actuelles sont les suivants : Grimarest (1705), La Serre (qui fut pré- féré à Voltaire pour la composition de la préface à l'édition de 1734), Eudore Soulié (1863), Paul Mesnard (1889), et Madeleine Jürgens et Elizabeth Maxfield- Miller {Cent ans de recherches sur Molière, 1963). A l'exception possible de La Serre, qui n'est cité nulle part dans son livre, Roger Duchêne les a tous lus, pui- sant copieusement dans leurs travaux, mais l'identification précise de ses sources est rendue impossible pour beaucoup de ses lecteurs à cause de l'absence des notes au bas de la page. Le renvoi aux commentaires d'ordre bibliographique à la fin du livre ne peut offrir la précision nécessaire aux chercheurs. Pour un ouvrage This content downloaded from 161.116.100.31 on Thu, 19 May 2022 14:59:47 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms COMPTES RENDUS 1101 qui se veut un instrument de recherche ce serai une œuvre de haute vulgarisation le besoin d'all tement compréhensible, et Ton peut admettre sance de la vie de Molière, justifie les moyens rat critique habituel. L'accueil critique du livre dépendra donc des teurs. L'auteur a tout lu, sa biographie est admi n'y trouvera pas de nouveaux renseignement créer à partir des travaux déjà faits une synthès Des sources les plus souvent sollicitées, c'est l Eugène Despois et Paul Mesnard qui domine : des échos de leur grand travail : par exemple, l moliéromane Lacroix suivant laquelle Molière uploads/Litterature/ 40533915.pdf
Documents similaires





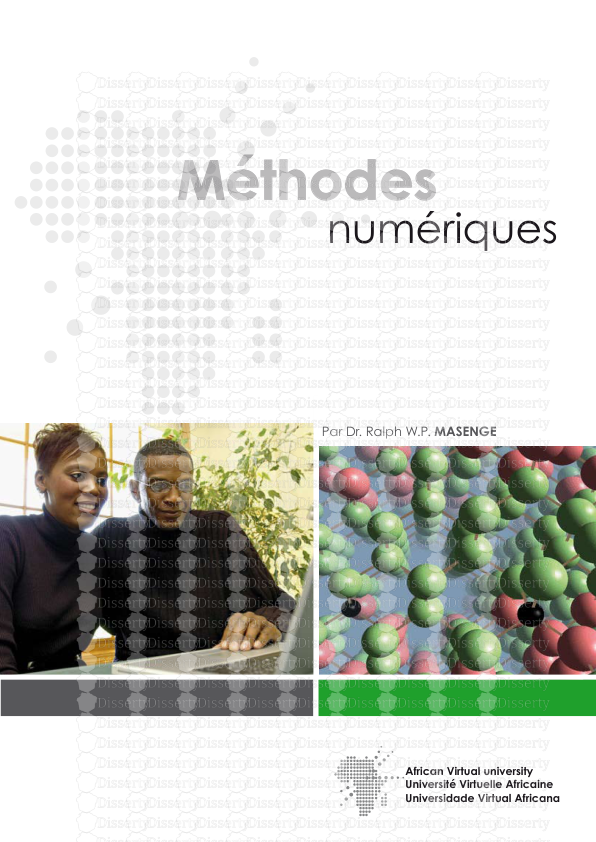




-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 03, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.6558MB


