Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Univ
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : erudit@umontreal.ca Article « Antonio Rocco, Alcibiade enfant à l’école. Clandestinité, irréligion et sodomie » Jean-Pierre Cavaillé Tangence, n° 81, 2006, p. 15-38. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/014959ar DOI: 10.7202/014959ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html Document téléchargé le 27 April 2015 05:32 Antonio Rocco, Alcibiade enfant à l’école. Clandestinité, irréligion et sodomie Jean-Pierre Cavaillé, École des Hautes Études en Sciences Sociales L’article est consacré à la fois à l’histoire de la publication clan - destine d’Alcibiade enfant à l’école, du XVIIe siècle à nos jours, et à l’analyse de son dispositif fictionnel et de ses ressources argu men - tatives. L’ouvrage relate en effet l’entreprise de séduction amou - reuse et sexuelle d’un maître de philosophie sur son jeune élève, Alcibiade, fondée sur la persuasion et l’efficacité d’une argumen - tation idoine, où la philosophie joue un rôle déterminant : un ratio nalisme foncièrement naturaliste au service d’une éthique résolument hédoniste. Par l’étroite association d’une initiation sexuelle et d’un apprentissage philosophique, ce livre contribue ainsi à la constitution d’un genre qui trouvera une expression ulté rieure dans la Satire sotadique de Chorier (ou Académie des dames), Thérèse philosophe et les romans de Sade. On se pro - pose ici de réfléchir sur le sens de la clandestinité de cette œuvre envisagée au premier chef dans sa composition même, comme discours puissamment transgressif, tout à la fois du fait de ses modes d’écriture, de sa représentation des mœurs et des idées exprimées, et rendu attractif pour ces raisons, mais contenant aussi en lui-même les modalités de son acceptabilité restreinte, comme un livret inoffensif de simple divertissement. «Un livre on ne peut plus sale et exécrable pour sa louange et sa science du crime sodomitique», «un livret […] tel que l’on ne puisse rien représenter de plus obscène et de plus détestable», «un livre néfaste et abominable, qui eût mérité à son auteur d’être brûlé avec tous ses exemplaires 1 ». C’est en ces termes que les biblio graphes du XVIIIe siècle évoquent l’Alcibiade fanciullo a scola. Tangence, no 81, été 2006, p. 15-38. 1. J. Vogt, Catalogus historico-criticus librorum rariorum, Amburgi [Hambourg], 1747, p. 52 : « Liber spurcissimus, atque execrandus de criminis sodomitici laude ac arte ». F. G. Freytag, Analecta litteraria de libris rarioribus, Lipisae L’éducation du jeune Alcibiade est confiée à Filotimo, maître très renommé d’Athènes. Charmé par l’insigne beauté du fanciullo, Philotime entreprend de le séduire, joignant des gestes pressants aux paroles melliflues. L’ouvrage consiste tout entier dans la rela - tion de la longue entreprise de séduction, fondée sur la persuasion et l’efficacité d’une argumentation idoine qui réfute une à une toutes les objections par lesquelles Alcibiade justifie sa résistance. C’est l’occasion pour le maître de livrer un enseigne ment philo - sophique on ne peut plus subversif, qui développe un ratio na lisme foncièrement naturaliste au service d’une éthique résolu ment hédoniste. Des arguments redoutables y voisinent avec des jeux d’esprit qui, loin de discréditer le maître rhéteur et philo sophe, le rendent suffisamment drôle et aimable à l’enfant, lui-même d’une grande sagacité, pour que celui-ci finisse en riant par soulever ses vêtements et offrir à son précepteur les doux objets de sa convoi - tise amoureuse. Le texte se termine en introdui sant les termes les plus crus dans la prose la plus raffinée, avec l’évocation des délices de la sodomie, pour l’élève comme pour le maître: «Non avendo il cazzo del suo maestro nel culo non sapeva che cosa fusse dolcezze 2.» Ce court résumé suffit à mettre en évidence, dans ce texte clandestin de la première moitié du XVIIe siècle, l’étroite association entre initiation sexuelle et apprentissage philosophique qui carac té risera plus tard des textes plus fameux, eux aussi soumis à la clan destinité, comme la Satire sotadique de Chorier (ou Académie des dames), Thérèse philosophe et, bien sûr, les œuvres de Sade. Évidemment, le thème premier et central de la pédérastie, dont l’œuvre est à première vue un long, soutenu et vibrant éloge, est décisif dans le jugement qu’on a porté sur elle. 16 TANGENCE [Leipzig], 1750, p. 853-854: «Opusculum […] quo nihil obscoenius et detes - ta bilius effigi potest ». J. J. Bauer, Bibliotheca librorum rariorum universalis, Nürnberg [Nuremberg], Martin Jacob Bauer, 1770, tome I, p. 28 : « Liber nefandus et abominabilis, dignusque ut autor ejus cum omnibus suis exem - pla ribus fuisset combustus». Ces références sont données par Laura Coci dans son édition critique, Antonio Rocco, Alcibiade Fanciullo a Scola, Rome, Salerno Editrice, 1988, p. 9. Voir également Louis Godbout, avant-propos de son édition du texte en français (traduction anonyme de 1866), Alcibiade enfant à l’école, édition de Louis Godbout, Montréal, Balzac, 1995, p. 11. 2. «Lorsqu’il n’avait pas la bite de son maître dans le cul, il ignorait ce qu’était la douceur» (Antonio Rocco, Alcibiade Fanciullo a Scola, ouvr. cité, p. 87). Notons que nous renverrons désormais à cette édition pour l’italien et lorsque nous traduisons nous-mêmes. Ce seul motif suffisait à la condamner pour des siècles à la plus stricte clandesti nité, personne, sinon quelques critiques négligents ou de mauvaise foi, ne pouvant prendre pour une clé de lecture suffisante et satis fai sante les pièces liminaires qui présentent le texte comme une dénonciation des mœurs de mauvais maîtres (voir plus bas). Cependant, il est vrai que le texte est complexe, qui multiplie les procédures expressives et argumentatives obliques ; une obli - quité visiblement destinée en premier lieu à divertir le lectorat auquel il s’adresse, un lectorat spécifique, capable de ne pas s’offus quer de ce qui lui est dit, tant en matière de mœurs que d’idées. Il s’agira ici de s’interroger sur le sens de cette longue clandestinité factuelle, mais d’abord choisie par l’auteur, qui a lui- même prudemment dissimulé son nom, et à laquelle le vouait sa manière même d’écrire et de destiner son texte à un public averti, un public que l’on peut aussi qualifier de clandestin, au sens où ses modes de lecture — et d’abord le simple fait d’être capable de lire un tel texte sans s’offusquer et en se réjouissant — ne sau - raient être acceptables publiquement, c’est-à-dire faire l’objet d’une reven dication publique, même s’il y a lieu de penser que cette manière déculpabilisée d’envisager des textes et des images jugées publiquement immorales et impies était en réalité beau - coup plus diffuse dans la société d’Ancien Régime que l’histo rio - graphie dominante veut bien l’admettre. Le paradoxe qui se fait alors jour, que l’on ne pourra guère traiter ici, est celui de l’extrême difficulté rencontrée dans la diffusion et la circulation d’un texte, dont on peut cependant penser qu’il participe d’une culture assez large ment présente, à Venise et ailleurs. Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons de réfléchir sur le sens de cette censure reconduite de l’œuvre et de sa clandestinité parta - gée, non seule ment en aval, comme produite par le texte, mais en amont, dans sa composition, comme discours puissamment transgressif, tant dans ses modes d’écriture que sur le plan de sa représentation des mœurs et de l’expression des idées, et rendu attractif pour ces rai sons, mais contenant aussi en lui-même les modalités de son ac cep tabilité restreinte, comme ouvrage de divertissement inoffensif. Publications et attributions L’ouvrage parut dans la plus grande clandestinité, probable - ment entre 1650 et 1652, avec de fausses indications de lieu et JEAN-PIERRE CAVAILLÉ 17 d’éditeur (Orange, Jann Vvart 3) et, pour toute mention d’auteur, les initiales DPA. Ces initiales le firent faussement attribuer à l’Arétin lui-même (Di Pietro Aretino). Mais surtout, on le consi - déra longtemps (et parfois encore aujourd’hui) comme une œuvre de Ferrante Pallavicino, le jeune et téméraire auteur du Corriere Svaligiato condamné à la décapitation en Avignon en 1643 pour ses écrits pornographico-politiques contre Urbain VIII et la curie romaine. Il est vrai que plusieurs des lettres du Corriere Svaligiato (1641) traitent de pédérastie de manière extrêmement provoca - trice, mais sur le ton de la satire des mœurs et avec beaucoup moins de complaisance érotique que l’Alcibiade (Lettera di precetti a chi pretende di tener cura di putti; Lettera d’accidente occorso ad un giovine in Roma ; Lettera metaphorica d’un pedante vitioso 4). Cette attribution était somme toute assez vraisemblable : cela ne faisait qu’un titre de plus ajouté à une liste d’œuvres fort impres - sion nante, à tous points de vue, pour un auteur uploads/Litterature/ antonio-rocco-alcibiade-enfant-a-l-x27-ecole.pdf
Documents similaires

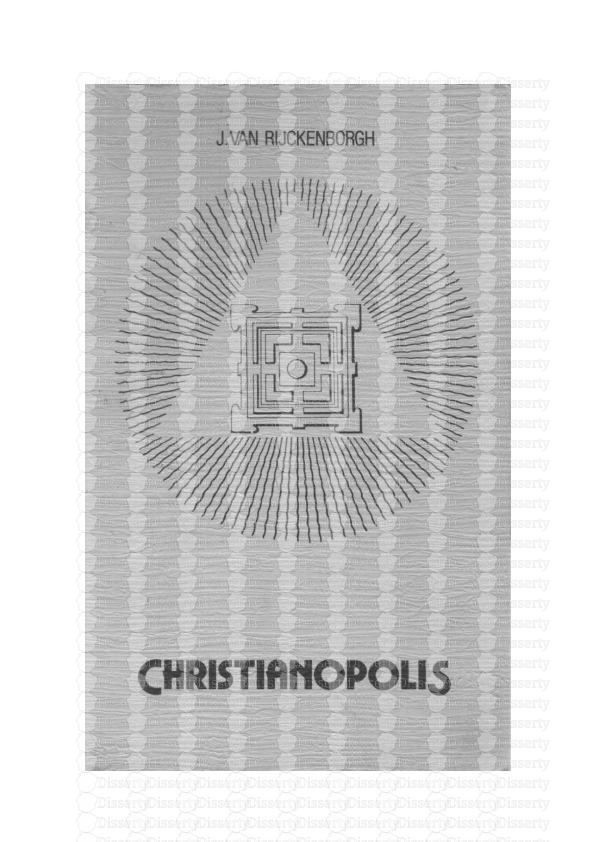








-
100
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 27, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5910MB


