Eikasia. Revista de Filosofía, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistad
Eikasia. Revista de Filosofía, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 39-A Platon, Pythagore et les pythagoriciens1 Luc Brisson Il est très difficile de parler de l’influence exercée par Pythagore et les Pythagoriciens sur Platon, et ce pour de multiples raisons, dont voici les principales: 1) Platon cite très rarement les noms de ses prédécesseurs, même lorsqu’il les utilise. 2) Pythagore et son École avaient pour particularité la pratique du secret; d’où leur refus de recourir à l’écriture et leur choix d’une transmission codée de l’information 2. 3) D’un point de vue historique 3, on sait très peu de choses sur les origines, la formation et l’activité de Pythagore. Il serait né à Samos au début du VIe siècle et aurait émigré à Crotone, où il aurait pris le pouvoir. Une révolte aurait renversé les Pythagoriciens à la fin du siècle, un peu après 510, mais l’éclipse fut de courte durée, car il semble qu’ils contrôlèrent un solide bloc de territoire entre Métaponte et Locres jusqu’en 450. Par la suite, l’influence pythagoricienne ne réapparaît qu’au début du IVe siècle à Tarente avec Archytas, à condition évidemment que celui-ci puisse être déclaré “ pythagoricien ”. On peut en effet se demander si au IVe siècle l’épithète “ pythagoricien ” n’était pas revendiquée par de fortes personnalités regroupant autour d’elles quelques disciples, au nom d’un héritage relatif à un certain idéal de science ou de vie. 1 . Cette article a être publique: “Platon, Pythagore et les Pythagoriciens”, dans Platon, source des Présocratiques. exploration, éd. par M. Dixsaut et A. Brancacci, Histoire de la philosophie, Paris (Vrin) 2003, p. 21-46. Et il a la permission de Monique Dixsaut et de la maison Vrin para se pubiquer dans cette reviste. 2. L. Brisson, “ Usages et fonctions du secret dans le Pythagorisme ancien ”, Le Secret, textes réunis par Philippe Dujardin, Lyon (C.N.R.S.-Centre régional de Publication/Presses Universitaires de Lyon) 1987, p. 87-10; repris dans Orphée et l’Orphisme dans l’Antiquité gréco-romaine, Aldershot (Variorum), 1995. Brisson, Luc: «Platon, Pythagore et les Pythagoriciens» Eikasia. Revista de Filosofía, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org 40-A 4) À cette rareté d’informations historiques concernant Pythagore et les Pythagoriciens, répond, dans l’histoire de la philosophie dans l’Antiquité, une tendance à faire de Pythagore le maître et l’inspirateur privilégié de Platon. Cette tendance prend sa source chez Aristote4, qui écrit: Après les philosophes dont nous venons de parler [Pythagoriciens et Éléates], survint Platon, dont la doctrine est en accord le plus souvent avec celle des Pythagoriciens, mais qui a aussi ses caractères propres, bien à part de la philosophie de l’École italique 5. (Mét., A 6, 987 a 29- 31) Ce jugement sera, comme on le verra, repris et illustré par un des disciples d’Aristote, Aristoxène. Né entre 375 et 360 à Tarente, où son père aurait connu Archytas6, celui-ci aurait été à Athènes le disciple d’un Pythagoricien avant de fréquenter le Lycée; il n’a pu connaître que les Pythagoriciens contemporains de Platon et d’Aristote, qui vécurent deux siècles après le maître. Il a écrit sur la musique, et il est l’auteur de biographies 7, notamment sur Pythagore et sur Archytas: ce fut un anti- platonicien farouche, refusant en particulier la mathématisation de la musique telle que la préconise Platon à la fin du passage de la République qui va être analysé dans la suite de cet article. 5) Le cas d'Aristoxène illustre à merveille la propension des auteurs antiques à prendre partie pour ou contre l'auteur dont ils présentent les opinions. Voilà pourquoi, dans l'Antiquité, on a prétendu, interprétant ainsi le jugement d'Aristote en un sens négatif ou positif, ou bien que Platon avait plagié Pythagore ou bien qu'il avait mené sa pensée à son terme. 3. Sur le sujet, voir Le monde grec et l’Orient, t. I: Le Ve siècle (510-403), par E. Will, Paris (PUF) 1972, 19893, p. 237-241; II: Le IVe siècle et l’époque hellénistique, par E. Will, C. Mossé et P. Goukowsky, Paris, PUF, 1972, 19852, 156-170 4. Aristote aurait écrit un ouvrage Contre les Pythagoriciens et un autre Sur les Pythagoriciens (D.L., V, 25). 5. Sur ce passage, voir le commentaire de H. Cherniss, Aristotle’s Criticism of Plato and the Academy [1944], New York, Russell & Russell, 1962, p. 177-184. 6. Son père avait connu personnellement Archytas (Jamblique, Vie de Pythagore § 197; voir aussi D.L. II 20, V 92. 7. Fragments réunis par F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles: II. Aristoxenos, Bâle, Schwabe & Co, 1945, 19672. Voir aussi Jamblique, La Vie de Pythagore, Paris, La Roue à Livres, Introduction, traduction et notes par L. Brisson et A.Ph. Segonds. Brisson, Luc: «Platon, Pythagore et les Pythagoriciens» Eikasia. Revista de Filosofía, 12, Extraordinario I (2007). http://www.revistadefilosofia.org 41-A 6) Suivant le principe qui prévaut dans le domaine de l’érudition et qui veut que la production savante croisse en proportion inverse de l'information disponible, la littérature secondaire sur Pythagore et les Pythagoriciens est foisonnante et difficile à maîtriser. Cela dit, la question est la suivante: comment faire la distinction entre la réalité d’une influence et la projection d’une interprétation, sinon malveillante du moins critique? Entre une information historique et une appropriation idéologique? Aussi, lorsqu’il tente d’apprécier l’influence pythagoricienne sur Platon, l’historien de la philosophie doit-il se battre sur deux fronts. Il lui faut à la fois évaluer les maigres informations historiques concernant Pythagore et les Pythagoriciens, puis s’opposer à la pythagorisation systématique de Platon, qui ne peut alors résulter que d’un cercle vicieux: pour interpréter Platon, on fait appel à un Pythagorisme reconstruit de toutes pièces à partir de Platon. Afin d’en sortir, je voudrais tenter de dresser ici un bilan, le plus objectif possible, de l’état de nos connaissances en la matière 8. I. Références chez Platon À Pythagore et aux Pythagoriciens Dans toute l’œuvre de Platon, on ne trouve que deux références à Pythagore et aux Pythagoriciens. 1. Pythagore Dans la République, probablement écrite après son voyage en Italie du Sud qui fut suivi par un séjour en Sicile auprès de Denys l’Ancien 9, Platon fait une allusion à 8. Je prends pour point de départ de cette mise au point de W. Burkert, “ Pythagoreanism in Plato and the origin in Platonism of the Pythagorean tradition ”, dans Lore and Science in Ancient Pythagoreanism [1962], transl. by E.L. Minar Jr., Cambridge [Mass], Harvard University Press, 1972, p. 83-96. 9. Ce voyage se situerait vers 388-387, et la République aurait été écrite entre 385 et 370. Cela dit, on ne peut savoir si Platon rencontra Archytas dès ce premier voyage, ou seulement au cours du second (366-367) comme le laisserait entendre la Lettre VII (338 c-d), si l’on admet que cette lettre est authentique. Sur tout cela, cf. L. Brisson, Introduction aux Lettres, attribuées à Platon, Paris, GF- Flammarion, 1987, 19992. Brisson, Luc: «Platon, Pythagore et les Pythagoriciens» Eikasia. Revista de Filosofía, 10, Extraordinario 1 (2007). http://www.revistadefilosofia.org 42-A Pythagore et une autre aux Pythagoriciens; ce sont là, il faut y insister, les deux seules références explicites dans le corpus platonicien. Le premier passage se trouve dans le livre X qui se veut une attaque contre l’imitation, jugée d’un point de vue ontologique. Dans ce livre où Homère, considéré comme le maître d’école des Grecs, est particulièrement attaqué, Platon s’en prend très ironiquement au soi-disant mode de vie homérique, en le comparant à celui instauré par Pythagore: SOCRATE – Mais sans doute, à défaut d’action sur la vie publique (demosíai), Homère, dans le domaine privé (idíai), a-t-il été selon la tradition par sa propre vie le guide pour quelques-uns de leur éducation (tisìn hegemòn paideías) 10, pour des gens qui avaient envers lui de la dévotion parce qu’ils étaient ses familiers, et qui ont transmis (parédosan) à la postérité un mode de vie homérique (hodón tina bíou) comme le fit Pythagore. Pythagore fait lui-même pour cela l’objet d’une exceptionnelle dévotion, et ses successeurs (hoi hústeroi) de nos jours encore (éti nûn) suivent une règle de vie (trópon toû bíou) qu'ils qualifient de “ pythagoricienne ” et par laquelle ils pensent se différencier du reste des hommes. GLAUCON – Sur cet autre point non plus, on ne rapporte rien de pareil sur Homère. Par le fait, il est bien possible, Socrate, que le compagnon d’Homère, Créophyle 11, se révèle, sous le rapport de l’éducation, plus risible encore que ne l’est son nom, si ce qu’on raconte d’Homère est vrai: on dit en effet que, pendant qu’il était vivant, il fut, au-delà de tout, délaissé par le personnage en question. (République, X, 600 a-b, trad. Robin modifiée) L’importance de ce passage vient de son contexte. Homère, considéré comme l’instituteur des Grecs, n’est tout compte fait qu’un imitateur. Il ne peut se targuer ni d’avoir été un législateur comme Lycurgue à Sparte, Charondas en Italie du Sud 12 ou Solon à Athènes, ni même d’avoir donné des conseils pratiques comme Thalès de Milet 13 ou comme Anarchasis le Scythe 14. Il ne peut même pas revendiquer l’honneur d’avoir été dans le domaine un guide pour l’éducation (hegemòn paideías), comme c’est le cas uploads/Litterature/ brisson-l-platon-pithagore-et-les-pithagoriciens-2007.pdf
Documents similaires







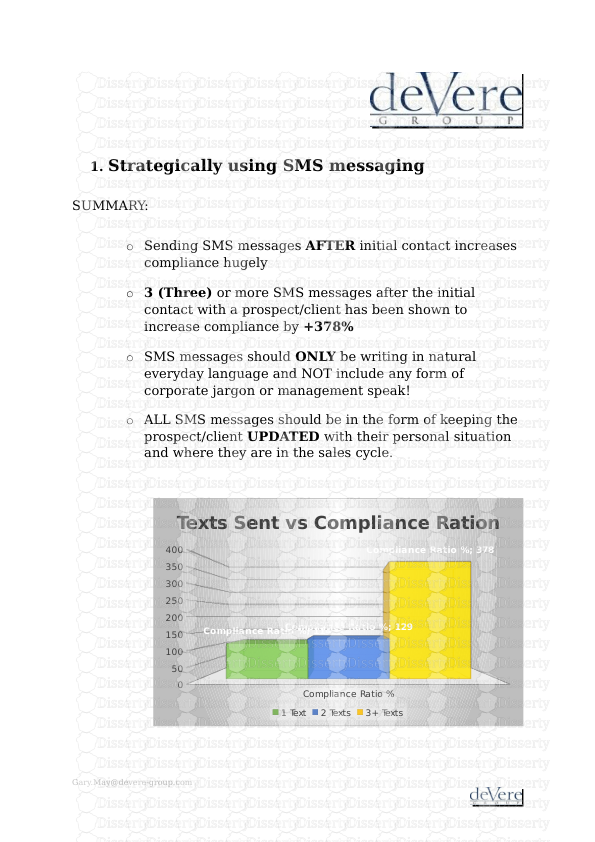


-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 09, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0981MB


