Venance Grumel Une question de liturgie et de droit canon : La prohibition des
Venance Grumel Une question de liturgie et de droit canon : La prohibition des mariages durant l'octave pascale In: Échos d'Orient, tome 35, N°183, 1936. pp. 274-279. Citer ce document / Cite this document : Grumel Venance. Une question de liturgie et de droit canon : La prohibition des mariages durant l'octave pascale. In: Échos d'Orient, tome 35, N°183, 1936. pp. 274-279. doi : 10.3406/rebyz.1936.2871 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rebyz_1146-9447_1936_num_35_183_2871 Une question de la liturgie et droit canon : La prohibition des mariages durant l'octave pascale Nul n'ignore que la distribution des lectures évangéliques dans la liturgie byzantine s'opère en suivant l'ordre du texte évangé- lique, sauf certaines exceptions imposées par le temps liturgique ou légitimées par l'importance de l'épisode qu'on a voulu mettre en relief. On sait aussi que la lecture de saint Jean, qui se trouve en tête des évangéliaires byzantins, ordre encore suivi de nos jours, a été réservée au temps pascal. L'exorde johannique se lit le jour même de la solennité, à la liturgie, le récit de l'apparition aux apôtres assemblés étant réservé à l'Hespérinos. Le deuxième jour, lundi, la lecture johan nique continue à la suite. Le troisième jour, mardi, elle s'i nterrompt pour faire place au récit de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. La péricope johannique que la suite appelait, le témoignage de Jean-Baptiste sur le baptême de Jésus, est complè tement omise et ne se lit qu'à la synaxe du Précurseur le 7 janvier. -j Le quatrième jour, mercredi, reprise de l'Évangile de saint Jean, à la suite du passage omis la veille. Le cinquième jour, jeudi, la succession régulière appelait le récit des noces dé Cana en Galilée. Or, cet épisode se lit au lundi suivant, deuxième après Pâques. Et à sa place se lit, à ce jeudi, le passage évangélique qui, normalement, appartient au samedi proche. Le sixième jour, vendredi, a gardé sa lecture évangélique normale. Le septième jour, samedi, privé de sa lecture régulière en faveur du jeudi précédent, a été pourvu de ' la lecture normale du mardi suivant, deuxième après Pâques. Passons sur le dimanche de Thomas qui suspend la série sans l'interrompre. Le lendemain, deuxième lundi de Pâques, se lit, avons-nous dit, l'épisode des noces de Cana, transféré du jeudi précédent. Et enfin, pour clore la série de ces modifications, PÉvan- gile qui appartenait régulièrement à ce lundi a été reporté au mardi suivant, dépourvu de sa lecture propre en faveur du samedi de Pâques. Résumons tous ces changements dans ce tableau que nous commençons au mercredi de Pâques. LA PROHIBITION DES .MARIAGES DURANT LOCTAVE PASCALE 2^5 Suite régulière. Ordre suivi. • Mercredi, i, 35-52 (Vocation des premiers apôtres). Idem. Jeudi, ii, i-ii (Noces de Cana). m, i-i5 (Entretien avec Nicodème). Vendredi. ii, 12-22 (Jésus chasse les vendeurs du Idem. Temple et annonce sa résurrection). Samedi. m, i-i5 (Entretien avec Nicodème). m, 22-33 (Jésus baptise et Jean lui rend témoignage). Dimanche de Thomas. Lundi. m, 16-21 (Dieu a tant aimé le monde). π, i-n (Noces de Cana). Mardi. m, 22-33 (Jésus baptise et Jean lui rend m, 16-21 (Dieu a tant aimé le monde), témoignage). A considérer le'contenu des lectures substituées dans la semaine de Pâques, on constate qu'elles sont en rapport avec cette fête considérée en tant que solennité baptismale. Notons toutefois que cette substitution ne s'imposait pas pour elle-même. On a maintenu, en effet, au mercredi le récit de la vocation des apôtres qui ne contient aucune allusion au sacrement du baptême ni au mystère de la Résurrection. Il eût suffi que le dernier jour de l'octave baptismale ait eu son Évangile approprié. Or, elle l'eût eu si l'ordre normal avait été sauvegardé : au samedi de Pâques, en effet, la suite régulière amenait l'Évangile de l'entretien avec Nicodème. D'où 1 l'on peut se demander si la première intention des changements opérés nTa pas été de fixer au deuxième lundi de Pâques le récit des noces de Cana. Les changements opérés se comprendraient ainsi beaucoup mieux, car si l'on n'avait voulu que trouver une lecture évangélique plus appropriée à la semaine pascale, il eût suffi de permuter la lecture du jeudi de Pâques avec celle du mardi suivant sans rien changer aux autres, ou même sans permutation la remplacer purement et simplement par la lecture supprimée du mardi de 270 ÉCHOS D'ORIENT Pâques qui, elle, est en rapport avec l'octave baptismale. On a procédé, au contraire, comme si l'on voulait comblée un vide, le vide fait par le renvoi au lundi suivant de l'Évangile des noces de Cana. On a poussé la lecture du samedi au jeudi, et on a choisi celle du mardi suivant pour la porter au samedi, et le mardi a reçu celle du lundi. Les péricopes avoisinant l'épisode de Cana ont été ainsi utilisées au mieux des convenances liturgiques de la semaine pascale. Il semble donc bien que le but de ces changements ait été de réserver le récit des noces de Cana au deuxième lundi de Pâques, et que les autres attributions ne se sont faites qu'en dépen dance de celle-là. Mais quelle pourrait bien être la raison d'une telle disposition? Nous n'en voyons qu'une : c'est que ce jour, vraisemblablement, ouvrait la période où l'on pouvait célébrer les mariages qui étaient défendus depuis le début du Carême. Nulle autre lecture évangélique n'était plus convenable pour une telle circonstance. Nous devons avouer ici que, dans les anciens canons de l'Église grecque, nous ne trouvons de défense expresse de contracter mariage que pour le temps du Carême. Mais en dehors des canons, édictés généralement pour remédier à des abus, il peut y avoir l'usage sur lequel, quand il n'y a pas lieu, les canons ne se pro noncent point. Toujours, il a paru inconvenant aux chrétiens de s'occuper de joies profanes et charnelles dans cette solennité suprême où toute la pensée, tout le cœur, doivent appartenir à Dieu. C'est ce que déclare le 66e canon du concile quinisexte ordonnant de passer tout le temps depuis le jour de la Résurrection jusqu'au « dimanche nouveau », c'est-à-dire toute la semaine de Pâques y compris le dimanche suivant, dans les hymnes et les cantiques spirituels, la lecture des Écritures et la fréquentation des saints mystères, et interdisant alors les jeux de l'hippodrome et tout spec tacle public (i). Ce canon ne parle pas des mariages : c'est sans doute que l'abus ne s'en était pas introduit. Mais le principe est clair. Les commentateurs Zonaras, Aristène et Balsamon ne font pas non plus l'application de ce canon au mariage, mais Balsamon et Zonaras énoncent le principe que tous les jours de la semaine de Pâques doivent être considérés comme un seul jour de fête (2), de sorte que ce qui ne se fait pas au jour même de la Résur- (1) Mansi, t. XI, 973· (2) Ρ G., t. CXXXVIII, 74·>748· LA PROHIBITION DES MARIAGES DURANT L OCTAVE PASCALE 277 rection ne doit pas se faire non plus durant toute la semaine. L'application expresse du canon au mariage n'a eu lieu que très tardivement, au xixe siècle, sous le premier patriarcat de Grégoire VI . Celui-ci fait dire au canon plus qu'il ne contient et lui attribue la défense explicite de contracter mariage pendant la semaine pas cale, de même que pendant tout le grand Carême, le jeûne de la Théotocos, les mercredi et vendredi comme jours de jeûne, et les vendredi, samedi et dimanche de la Tyrophagie (i). Mais déjà le Pédalion avait expressément déclaré que les mariages sont défendus pendant la semaine pascale en se basant apparemment sur la raison que ce sont des jours entièrement consacrés à la prière (2). Avant lui, nous trouvons parmi les articles du synode de Moscou, en 1765, un article qui fixe les temps où les mariages sont prohibés, et, parmi eux, figurent « les jours de la Résurrection », c'est-à-dire, sans contredit, la semaine pascale (3). Il n'est pas nécessaire de relever ici que la pratique des Églises slaves reflète celle de l'Église grecque. Mais il y a beaucoup mieux. Dans un manuscrit de Florence du xiie siècle (Plut, v, cod. 22), qui contient le Nomocanon des "5o titres, une main de peu postérieure a inséré un scholion sur les temps fermés aux mariages. Il n'a été relevé ni par Zhishman ni par Gortchakov. Pavlov le cite dans son ouvrage sur le 5oe chapitre de la Kormtchaja Kniga (4). Ce scholion déclare le mariage prohibé, entre autres, απο της κυριακής τοΰ άσωτου έ'ως της οκταημέρου της σωτη ρίου έγέρσεως χριστού. (5). Les huitjoursde Pâques sont évidemment compris dans la défense, autrement iln'y aurait point lieu de les mentionner. Nous avons donc une attestation, datant du xme siècle (ι) Γνώμη τοΰ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου τοΰ £"'. Ίστέον, ότι ή Διακαινήσιμος έβδομας απασα ώς μία λογίζεται, δια τούτο διορίζει ό ΞΣΤ'. Κανών της Οικουμενικής Συνόδου, ό'τι δλοι οί Χριστιανοί εις την Εβδομάδα ταΰτην, καθώς καΐ έν ό'λη τ?) 'Αγία καΐ μϊγάλη Τεσσαρακοστή, καί έν τή Νηστεία της Θεοτόκου, να μή κάμνωσι γάμους, άλλα να καταγίνωνται ε!ς ΨάλμουςκαΙ uploads/Litterature/ chestiuni-liturgico-canonice-despre-mariaj.pdf
Documents similaires
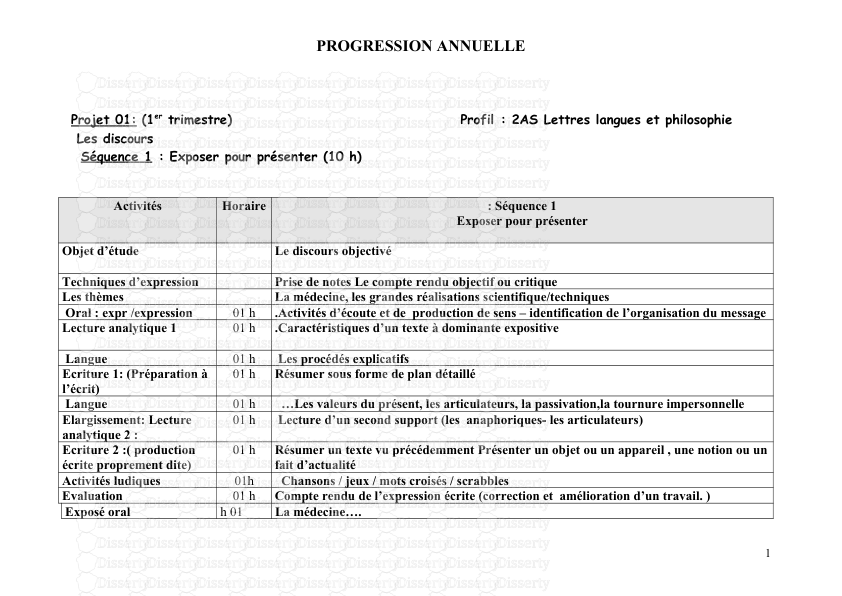









-
204
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 13, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5039MB


